Agir pour la croissance verte
Panorama des actions en faveur de la croissance verteLa généralisation du recours aux mesures fiscales
Les écotaxes
L’approfondissement de politiques sectorielles ciblées
Secteur du bâtiment, de la construction
Secteur automobile, transports
Politique de la ville
Politique de l’emploi : les emplois verts
Un recours croissant aux nouvelles technologies vertes dites « green-tech »
Énergies renouvelables
Les « clean-tech » et « green-tech »
L’émergence des marchés de droits, permis d’émission et fonds carbone
Au niveau international : le protocole de Kyoto
Des initiatives nationales
Bibliographie
« The Green Rebound », HSBC, janvier 2.
Avant-propos
Politiques, experts et entrepreneurs s’efforcent aujourd’hui de définir une nouvelle voie permettant de concilier l’activité humaine avec la protection de la planète. Une réponse pertinente réside dans la jeune notion de
« croissance verte ». Une prise de conscience écologique est à l’œuvre dans le public, pour partie grâce aux progrès de la connaissance et pour partie sous l’effet des prises de position spectaculaires au ton parfois alarmiste (le prix Nobel Al Gore et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC –, le film Home). La crise économique a contribué à placer au cœur du débat l’idée d’une nécessaire évolution des modes de production et des habitudes de consommation. Une certaine préoccupation écologique conduit même à revendiquer une remise en cause des mécanismes de l’économie de marché comme en témoignent une écologie politique radicale ou encore le film de Nicolas Hulot, Le Syndrome du Titanic, plus anticapitaliste et altermondialiste qu’écologique.
Si l’activité économique et l’innovation scientifique sont souvent dénoncées pour leur rôle dans la dégradation de notre environne- ment, l’une et l’autre représentent pourtant les éléments essentiels de la réponse au défi que constitue une croissance économique durable- ment compatible avec le progrès humain. C’est sur ce paradoxe apparent que repose l’idée de « croissance verte ». Celle-ci désigne les différentes actions permettant la création de richesse par une nouvelle logique protectrice de l’environnement. En France, le Grenelle de l’environnement, lancé à l’initiative du président Nicolas Sarkozy en 2007, a permis d’importantes avancées en la matière. Le Grenelle de l’environnement constitue pour le moins le programme le plus ambitieux jamais lancé en France.
La croissance économique traditionnelle (fondée sur la production, l’exploitation des ressources naturelles et la consommation) est devenue génératrice d’externalités qu’il s’agit d’intégrer grâce à un modèle fondé sur l’innovation technologique et scientifique et l’encouragement à de nouvelles habitudes de consommation. La croissance verte se distingue radicalement de la décroissance, qui vaut pour répudiation pure et simple de la logique économique des sociétés humaines. L’idée de « décroissance » entre même potentiellement en contradiction avec l’idée de « développement » durable, celui-ci est difficile à concevoir sans croissance et, pour le moins, avec l’économie de marché dans son ensemble. Notion encore en construction et aux contours flous, la croissance verte peut désigner de nombreuses actions et initiatives nationales ou locales, telles que le recours aux énergies renouvelables, la promotion des emplois verts ou encore des transports propres.
Enjeu de la prochaine conférence de Copenhague, qui se tiendra en décembre 2009, la croissance verte doit, au-delà des initiatives isolées, se poser en objectif partagé du commerce international et de l’activité mondiale.
À ce titre, si de plus en plus de pays se dotent d’instruments « verts » pour construire leur croissance de demain, certains grands acteurs internationaux restent toutefois à la marge de ces évolutions. Au premier rang de ceux-ci figurent les États-Unis et la Chine, plus gros pollueurs de la planète et, jusqu’à récemment, réticents à réorienter leur politique de croissance en faveur de l’environnement.
On peut cependant espérer une amorce de changement, au vu de la composition des plans de relance américain et chinois. Ainsi, selon un rapport de la banque HSBC de janvier 20091, la Chine aurait prévu 34% d’« investissements verts » dans son plan de relance, soit 198 milliards de dollars.
Eu égard au classement par pays2 créé par les universités Yale et Columbia, le Environmental Performance Index (EPI) – qui permet d’identifier les performances économiques vertes –, on note la large avance européenne en la matière, mais également de nombreux exemples de poli- tiques volontaristes sur chaque continent (Costa Rica, Nouvelle-Zélande).
Il est probable que ces pays vont veiller à l’universalisation des contraintes nouvelles, pour ne pas porter seuls le poids d’une telle réorientation au risque de transformer une juste préoccupation en un lourd handicap économique et commercial.
La croissance verte, encore à l’aube de sa réalisation, tente donc la réconciliation de l’écologie et de l’économie par le biais d’actions innovantes et d’outils efficaces (fiscalité, droits d’émission, investissements en nouvelles technologies vertes, énergies renouvelables).
La présente note vise ainsi, de manière non exhaustive, à dresser un panorama des actions en faveur de la croissance verte au regard des pays, régions ou villes à l’avant-garde de procédés innovants, permettant de croire à la réalisation du plus grand défi du xxie siècle : la mise en place d’un système économique et social viable.
Valérie Morron,
Déborah Sanchez,
La généralisation du recours aux mesures fiscales
Dans la plupart des pays, la croissance verte s’appuie largement sur des politiques fiscales ciblées. La fiscalité, levier privilégié, favorise en effet la modification durable des habitudes de production et de consommation. Si les écotaxes comme la taxe carbone figurent au premier rang de l’éventail fiscal vert, dans certains secteurs particuliers on observe le développement d’outils spécifiques volontaristes (crédits d’impôt ou de prêts verts en matière de logement).
Les écotaxes
D’après le nom de l’économiste Arthur Pigou.
La taxe carbone est la principale écotaxe, même s’il existe de nombreuses autres mesures de ce type plus implicites, comme la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) en France, ou encore des accises sur les hydrocarbures au Royaume-Uni. La taxe carbone est une taxe dite « pigouvienne3 », puisqu’elle vise, au moyen d’une imposition, à modifier à terme les comportements de consommation. Il s’agit donc d’une application du principe du pollueur-payeur, où l’on taxe les émissions polluantes. Cela permet alors la génération d’un double dividende, la réduction de la pollution et une recette fiscale pouvant financer des projets écologiques ou sociaux. Une taxe carbone a en ce sens été mise en place dans plusieurs pays européens, comme le Danemark, la Suède, la Norvège, mais également au Canada (province de la Colombie-Britannique).
Tableau 1 : Classement EPI des principaux pays par continent (2008)

M. Court, « Taxe carbone : en Suède, les entre- prises sont exonérées, pas les ménages », Le Figaro, 10 septembre 2009.
Les pays scandinaves ont en effet été pionniers en matière de taxe carbone. La Finlande a été le premier pays à avoir mis en place une telle taxe, en 1990. Celle-ci est aujourd’hui d’environ 20 euros la tonne de CO2. La Suède se place ensuite parmi les premiers exemples observés, avec une taxe carbone introduite dès 1991. La tonne de CO2, fixée à l’origine à 27 euros, a progressivement augmenté. Elle atteint aujourd’hui 108 euros. Touchant principalement les ménages (de nombreuses entreprises restant exonérées), la taxe carbone suédoise représentait une recette de 2,5 milliards d’euros en 2008. Par ailleurs, il est estimé que, sans la taxe carbone, les émissions suédoises de CO2 seraient plus élevées de 20% que leur niveau actuel4.De même, le Danemark a rapidement mis en place une taxe sur les produits énergétiques, entièrement modulée. Créée en 1992, elle est aujourd’hui d’environ 12 euros la tonne de CO2.
Face à ces exemples précurseurs, de nombreux pays ont entrepris eux aussi la création d’une taxe carbone. Les exemples les plus récents sont ceux du Canada et de la Suisse. La province canadienne de la Colombie-Britannique a mis en place, en juillet 2009, une taxe carbone d’un montant de 15 dollars canadiens (environ 9,61 euros) la tonne de CO2, qui devrait augmenter progressivement de 5 dollars par an, pour atteindre 30 dollars (environ 19,23 euros) en 2012. Cette taxe sera par ailleurs entièrement compensée par un crédit d’impôt. De même, la Suisse a mis en place une taxe carbone en 2008, atteignant aujourd’hui le montant de 24 francs (15,81 euros) la tonne de CO2.
On trouve également des dispositifs similaires de taxe carbone en Italie, en Norvège ou aux Pays-Bas.
Fiscalité écologique : l’exemple allemand
La réforme fiscale écologique (RFE) a été lancée en Allemagne en 1999. Son but, particulièrement ambitieux, était la mise en place d’une nouvelle utilisation raisonnable de l’énergie produite et la promotion des énergies renouvelables. L’emploi et la compétitivité devaient dans le même temps ne pas être pénalisés.
La réforme a été réalisée par la mise en place d’une « green tax » sur l’électricité, la diminution des charges sociales et une augmentation annuelle des taxes sur l’essence.
On peut parler de double dividende au sujet de la RFE : le premier effet de cette réforme fiscale a été de diminuer la surconsommation d’énergies polluantes ; le second effet, de générer un revenu pour l’État, capable de financer des plans d’économie d’énergie, de production d’énergies renouvelables ou encore des réductions d’impôts.
La RFE allemande est montrée en exemple en Europe, en raison de son succès : depuis le début des années 2000, l’Allemagne est le pays où les réductions de gaz à effet de serre sont les plus importantes.
Cette large fiscalité verte a été renforcée en 2007 puis en 2009 dans le plan de relance allemand.
L’approfondissement de politiques sectorielles ciblées
Secteur du bâtiment, de la construction
http:// www. plandaction. gc. ca/ f ra/ media. asp?id=1691
http://www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy-ecoenergie/ faq-2-frcfm.
La croissance verte doit promouvoir les énergies renouvelables (solaire, éolienne), notamment par des facilitations fiscales (crédit d’impôt vert, éco-prêt à taux zéro en France), mais également par une politique volontariste (subventions). Ainsi le Canada, outre des mesures temporaires de crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire, a mis en place un plan ambitieux à travers le programme Écoénergie5 : 1,48 milliard de dollars canadiens pour l’électricité renouvelable et 36 milliards de dollars pour le chauffage renouvelable. Cela se traduit concrètement par des subventions à la rénovation des maisons, en faveur d’une amélioration de l’efficacité énergétique6
Secteur automobile, transports
M. Flam, « Green New Deal Stimulus Package », in « Les relances vertes dans le monde », ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
Dans la mesure où l’on considère que le pétrole et plus généralement les énergies fossiles sont non seulement hautement polluantes, mais aussi épuisables – c’est-à-dire vouées à disparaître –, il devient rationnel de garantir l’accès à de nouvelles sources d’énergie tout en promouvant des transports plus « propres ». L’industrie automobile est ainsi le premier secteur à tenter d’amorcer une révolution complète. La croissance verte s’appuie sur des infrastructures routières et des véhicules à l’empreinte écologique moindre. Cela s’observe dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis (plus grand nombre d’automobiles), où ces mutations sont prévues par le plan de relance du président Obama (février 2009). Le gouvernement prévoit ainsi des crédits d’impôt allant jusqu’à 7.500 dollars pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables7.
De façon générale, la croissance verte devra s’appuyer sur un système de transports propres, c’est-à-dire fonctionnant à l’aide d’énergies renouvelables (trains, tramways, bus et voitures électriques, réseaux et infrastructures routières innovants, véhicules hybrides). En Corée du Sud, le « Green Growth Path » (partie du plan de relance coréen) insiste ainsi sur des investissements dans les transports écologiques (trains à grande vitesse ; transport rapide par autobus, pistes cyclables) à hauteur de 7 milliards de dollars8.
Le plan de relance coréen : le pari de la croissance verte
Le plan de relance coréen semble être le plus « vert » de tous. En effet, selon le rapport « The Green Rebound », de la banque HSBC, la Corée du Sud consacrerait près de 69% de son plan de relance à des mesures vertes, se plaçant ainsi devant la Chine (38%) et les États-Unis (12%).
S’il peut paraître surprenant de la part de la Corée du Sud (ce pays n’avait en effet pas signé le protocole de Kyoto), ce plan de relance vert a été salué internationalement, en particulier par l’OCDE. Les investissements verts coréens, atteignant 36 milliards de dollars, se focaliseront sur les énergies renouvelables, les technologies vertes ou encore la construction d’infrastructures de transports écologiques.
Politique de la ville
Futura-Sciences.
Technologies vertes.
Conférence européenne sur le plan stratégique européen en matière de technologie et d’énergie, « EU’s Strategic Energy and Technology Plan ».
« 30 villes pionnières de l’Europe propre », La Tribune.fr.
Le Monde, 23 septembre 2009.
Rapport PNUE, « Emplois verts », septembre 2008.
Flam, « Les relances vertes dans le monde », op. cit.
Plusieurs pays ou villes ont pris l’initiative de réduire de façon drastique leurs émissions de CO2.
À cet égard, Abu Dhabi s’est lancée dans un projet révolutionnaire de ville entièrement verte, c’est-à-dire « zéro carbone ». L’émirat d’Abu Dhabi, va en effet investir 15 milliards de dollars dans la construction de la ville la plus écologique du monde. Cette ville, baptisée Masdar, sera construite en plein désert et devrait compter 50.000 habitants en 2015. Entièrement sans émissions de carbone, Masdar n’utilisera que des technologies propres (solaire photovoltaïque et thermique, énergie éolienne, géothermie, agro- carburants, transports et bâtiments propres, recyclage de l’eau et de la totalité de ses déchets)9.
Des initiatives plus modestes fleurissent dans de nombreux pays, notamment concernant la gestion des déchets.
En Europe, plusieurs villes se sont engagées sur cette voie et recourent de plus en plus aux « green-tech10 ». Lors d’une conférence européenne spéciale qui se déroulera à Stockholm les 21 et 22 octobre 200911, la Commission européenne proposera de désigner 25 à 30 villes pilotes sur le territoire de l’UE, où seront installés des projets exemplaires en matière de technologies vertes12. Certaines villes européennes sont par ailleurs déjà largement avancées en la matière, comme Malmö, en Suède, ou encore la municipalité de Copenhague, qui a lancé en mars dernier un plan « zéro émission » pour l’horizon 2025.
Aux États-Unis, un effort considérable a également été effectué par plusieurs États ou villes. La référence en la matière est la ville de San Francisco, largement en avance en matière d’efficacité énergétique et de faible empreinte carbone, comme en témoignent ses réglementations strictes dans les domaines du bâtiment et des transports. De façon générale, la Californie est en train de développer un parc d’énergie solaire important. Sa capacité globale de production solaire devrait en effet atteindre 350 MW d’ici à la fin 2009, soit un gain de 120% par rapport à 2008. Le Colorado, qui vise un objectif de « zéro déchet », prévoit l’agrandissement de son complexe de recyclage pour un montant de 8 millions de dollars (5,4 millions d’euros)13.
Le Brésil peut également être cité en exemple, notamment en matière de recyclage. Selon le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur les « emplois verts »14, le Brésil est en effet le leader mondial en matière de recyclage de boîtes en aluminium (10,5 milliards de boîtes ont été collectées en 2006). Ce recyclage permet au pays d’économiser les 1.976 GWh annuels d’électricité normalement requis pour produire de nouvelles quantités d’aluminium, soit un volume d’électricité suffisant pour alimenter une ville de plus d’un million d’habitants pendant une année.
Le plan de relance de la Corée du Sud est dans cette même lignée, puisqu’il s’appuie sur des mesures de recyclage des déchets à hauteur de 675 millions de dollars15.
Politique de l’emploi : les emplois verts
Les emplois verts sont des emplois qui réduisent l’impact sur l’environnement des entreprises et des secteurs économiques. Ces emplois contribuent à la préservation ou au rétablissement de la qualité de l’environnement, en réduisant notamment l’utilisation d’énergie, de matières premières polluantes ainsi que la production de déchets.
Selon le rapport « Emplois verts » du PNUE (septembre 2008), des millions d’emplois verts existent déjà dans les pays industrialisés comme dans les économies émergentes et les pays en développement. Ainsi, plus de 2,3 millions d’emplois verts ont été créés ces dernières années dans le secteur de l’approvisionnement énergétique : le secteur de l’énergie éolienne emploie environ 300.000 personnes, celui de l’énergie solaire photovoltaïque emploie quant à lui environ 170.000 personnes, et celui de l’énergie solaire thermique emploie plus de 600.000 personnes, dont une grande partie en Chine. Par ailleurs, les pays mettant en œuvre des politiques encourageant les énergies renouvelables ont vu l’emploi augmenter fortement dans ce secteur. En Allemagne, par exemple, le nombre d’emplois a quasi quadruplé, atteignant le nombre de 260.000 en moins d’une décennie.
Enfin, en ce qui concerne les transports, si des efforts sont entrepris pour réduire l’empreinte carbone des automobiles, ce sont les systèmes de transport public qui produisent moins d’émissions et offrent davantage d’emplois verts. Ainsi, seulement 250.000 emplois dans la fabrication d’automobiles économes en carburant, peu polluantes et à faible émission peuvent être qualifiés d’emplois verts, contre plus de 5 millions d’emplois dans les chemins de fer, et ce seulement en Chine, en Inde et dans l’Union européenne. Concernant le domaine de l’énergie, notamment dans le bâtiment et la construction, environ 4 millions d’emplois verts existent déjà dans l’ensemble de l’économie, en particulier aux États–Unis et dans certains pays européens.
Aux États-Unis, on peut noter que le plan de relance de Barack Obama (février 2009) prévoit la création de 5 millions de « green collar jobs » sur une période de dix ans.
Un recours croissant aux nouvelles technologies vertes dites « green-tech »
Énergies renouvelables
Les promoteurs des énergies renouvelables se fondent sur le postulat que les ressources utilisées actuellement sont épuisables et souvent hautement polluantes. La croissance verte doit donc s’appuyer sur des énergies nouvelles, comme l’éolien, le solaire ou encore l’hydroélectricité, afin de réduire l’empreinte carbone de l’activité humaine tout en rendant la croissance plus pérenne. De nombreux pays rénovent en profondeur leurs activités afin d’y intégrer puis d’y substituer ces nouveaux types d’énergie propre.
L’Union européenne axe plus particulièrement ses efforts sur la réglementation. La directive « EuP » du 6 juillet 2005 relative à l’éco-conception16, vise en effet à imposer des produits conçus pour réduire leur empreinte carbone. Elle met en place un comité élaborant des règlements ponctuels, d’application directe et immédiate dans les États membres. On peut citer l’exemple du règlement concernant les modes de veille adopté le 17 décembre 200817, dont le but est de réduire de 75% la consommation des veilles d’ici à 2020.
L’action au sein de l’Union européenne s’inscrit dans le Plan d’action pour une consommation, une production et une industrie durables (lancé en juin 2008), qui s’articule autour de l’écoconception, de l’étiquetage énergétique, des labels écologiques et de la promotion des marchés publics écologiques.
Aux États-Unis, le plan de relance, qui consacre une part d’investissements verts de 12% (soit environ 112 milliards de dollars), place les économies d’énergie au cœur de ces investissements, à hauteur de 43% (soit 48 milliards de dollars). Il s’appuie largement sur les énergies renouvelables (29%), ou encore sur la gestion de l’eau et le traitement des déchets (14%)18.
Au Portugal, une politique innovante met en place un parc éolien et photovoltaïque important. On trouve ainsi dans ce pays de nouvelles sortes de fermes agricoles. Une ferme solaire, tout d’abord, ouverte en 2008 dans l’extrême sud du Portugal, équipée de plus de 2.500 panneaux solaires dont la production d’énergie est suffisante pour alimenter 30.000 foyers. Une « ferme à vagues » ensuite, première dans son genre, installée à 10 km du rivage au nord du pays, constituée de trois engins semi-submersibles de 120 m de long récupérant l’énergie marémotrice à hauteur de 2,25 MW par an. Le Portugal étant actuellement dans la moyenne européenne en matière de consommation d’énergie, ces nou- veaux programmes devraient lui permettre d’ici à 2020 de générer 31% de son énergie19.
Au Costa Rica, pays modèle d’Amérique latine, les parcs nationaux représentent 25% de la superficie du pays. La taxe carbone existe depuis plus de dix ans, les sommes perçues sont reversées à un fonds qui subventionne 7.000 fermiers et propriétaires terriens afin de les aider à conserver leurs terres. La gestion « intelligente » des ressources du pays se traduit notamment par le dernier plan Paz con la Naturaleza, « Paix avec la nature ». Ce plan innovant prévoit de faire du Costa Rica le premier État au monde à atteindre en 2021 la neutralité climatique (en termes de c02) par différentes mesures, dont :
- une production de 95% d’« électricité verte » ;
- une politique active de reboisement ;
- une mise en valeur des eaux provenant des parcs nationaux qui devraient alimenter les centrales électriques, pour un bénéfice estimé à 400 millions de dollars d’énergie électrique.
Source : Le Nouvel Observateur, 3 septembre 2009
Les « clean-tech » et « green-tech »
Flam, « Les relances vertes dans le monde », op. cit.
Les nouvelles technologies sont un des leviers les plus puissants de la croissance verte. En effet, elles permettent le développement à grande échelle de techniques innovantes dans les domaines de l’informatique ou des télécommunications.
Premièrement, le green computing (green information technology) vise à diminuer la facture énergétique élevée de nos économies, largement en hausse sous l’effet des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
À ce titre, aux États-Unis, une évolution majeure se dessine. Depuis 1992, Energy Star, développé également en Europe, est un programme gouvernemental chargé de promouvoir les économies d’énergie, qui prend la forme d’un label apposé sur une multitude de produits qui respectent les normes environnementales.
Plus largement, les technologies vertes sont développées dans plusieurs pôles de compétitivité dans le pays. Ainsi, la Silicon Valley se transforme actuellement en « Green Valley ». La Californie est devenue un pôle de développement majeur des technologies propres, sous l’impact de nouvelles législations et d’initiatives privées favorisant le passage du high-tech au clean-tech (énergies propres) et au green-tech (technologies propres). À cet égard, le nombre de brevets dans les clean-tech a été augmenté de 70% en Californie sur la période 2002-2007, par rapport aux années 1990. Les investissements en green- tech ont d’ailleurs augmenté de 100% en 2007- 2008 (environ 3,3 milliards de dollars en 2008). L’exemple du solazyme, premier biocarburant diesel, développé dans la « green valley », est un signe avant-coureur des nombreuses innovations vertes à venir20.
L’émergence des marchés de droits, permis d’émission et fonds carbone
La croissance verte appelle, outre des actions ciblées, une réponse politique globale, nationale ou internationale. C’est ce que visent les marchés de droits « à polluer », véritables bourses du carbone, qui permettent de valoriser les effets écologiquement néfastes des activités économiques et de les internaliser aux coûts de production des entreprises ou industries.
D’ampleur croissante, le marché du carbone s’élevait à 100 milliards de dollars en 2008, constitué pour deux tiers de titres européens EUA (European Union Allowances) et pour un tiers de titres internationaux crédits de réduction d’émissions (CER).
Au niveau international : le protocole de Kyoto
Signé en 1997, le protocole de Kyoto a mis en place un marché du carbone lié aux crédits d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, par le système du mécanisme de développement propre (MDP), les entreprises de pays riches financent des projets de réduction d’émissions dans des pays pauvres et reçoivent en échange des CER qu’ils peuvent négocier.
Au niveau régional : le marché de l’Union européenne, le marché le plus abouti
Grâce au marché Emmision Trading System (ETS), mis en place en 2005, grandes compagnies électriques et industrielles s’échangent des quotas d’émission en fonction d’un plafond défini. La monnaie de ce marché est l’EUA.
Des initiatives nationales
La Nouvelle-Zélande a lancé en 2008 un système d’échange de quotas d’émission de carbone.
Le Royaume-Uni a mis en place le Carbon Fund, premier fonds spéculatif (hedge funds) consacré au marché du carbone, lancé début 2009. L’opérateur est la firme CF Partners, consultante dans le carbone depuis 2006. Ce fonds jouera sur les différences de prix entre EUA et CER, ainsi que sur les différences entre prix des matières premières énergétiques et prix du carbone.
Bibliographie
Rapports
« 2008 Environmental Performance Index », Yale Center for Environmental Law and Policy, Center for international earth science information network (CIESEN), Columbia university, 2008.
Flam, « Les relances vertes dans le monde », Commissariat général au développement durable, ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, 2009.
« The Green Rebound: Clean Energy to Become an Important Component of Global Recovery Plans », HSBC Global Research, 2009.
« Emplois verts : pour un travail décent dans un monde durable à faibles émission de carbone », Programme des Nations unies pour l’environnement, 2008.
« Low Carbon Jobs for Europe: Current Opportunities and Future Prospects », WWF, 2009.
« New Hampshire’s Green Economy and Industries : Current Employement and Future Opportunities », Wittemore school of business and economics, University of New Hampshire, 2009.
« Energy sector jobs to 2030 : a global analysis », Institute for sustainable futures, 2009.
« The New Zealand Emissions Trading Scheme: A Step in the Right Direction? » Institute of Policy studies, working paper, 2009.
« Sustainable development », NSW Parliamentary Library Research Service, Briefing paper, 2009.
« China, Copenhagen and Beyond: The Global Necessity of a Sustainable Energy Futures for China », Netherlands Institute of International Relations, 2009.
Articles de presse
G. Allix, « Dans le Colorado, le “zéro déchet” est en passe devenir réalité », Le Monde, 23 septembre 2009.
P. Boulet-Gercourt, « Costa Rica, paradis vert », Le Nouvel Observateur, 3 septembre 2009.
C. Calla, « Dix ans après, un bilan plutôt positif en Allemagne », Le Monde, 11 septembre 2009.
M. Court, « Taxe carbone : en Suède, les entreprises sont exonérées, pas les ménages », Le Figaro, 10 septembre 2009.
C. Morris et N. Hopkins, « Les renouvelables en Europe, un jus très maison », L’État de la planète, n° 31, mai-juin 2008.
P. de Rougemont, « Allemagne, une réforme fiscale écologique pour respecter et dépasser le Protocole de Kyoto », L’État de la planète, n° 19, janvier-février 2005.
« 30 villes pionnières de l’Europe propre », La Tribune.fr, 25 septembre 2009.

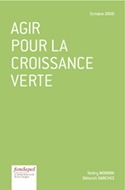











Aucun commentaire.