Souveraineté économique : entre ambitions et réalités
Souveraineté économique : entre ambitions et réalités
22 idées
Introduction
Autarcie et mercantilisme
La tentation de l’autarcie et de l’autonomie stratégique
Du mercantilisme à l’obsession de la balance commerciale
Une politique de relocalisation ?
De la délocalisation à la relocalisation
Les conditions d’une politique de relocalisation réussie
Une politique de rattrapage technologique ?
Les fondements théoriques d’une politique de rattrapage
Les conditions de succès d’une politique de rattrapage
Conclusion
Résumé
La pandémie de Covid-19 a conduit à un retour au premier plan de la question de la souveraineté économique, tout particulièrement en France. L’enjeu est de savoir quel contenu exact donner à cette notion. Cet exercice apparaît doublement nécessaire, car il permet tout à la fois d’éviter les écueils d’une politique de repli massif et de définir les contours d’une politique réaliste et efficace de souveraineté.
Dans une acception maximaliste, la souveraineté économique conduirait à préconiser un retour à une certaine autarcie : pour ne dépendre de personne, un pays devrait en quelque sorte se mettre « hors du monde ». Nous montrons qu’une telle politique conduit à une impasse et qu’elle est même quasiment impossible. Une politique d’inspiration mercantiliste, qui viserait à réduire les importations, aurait quant à elle des effets opposés à ceux recherchés.
En définitive, autarcie comme mercantilisme peuvent jouer contre les performances de l’économie et se révéler contradictoires avec un objectif de souveraineté économique.
Dès lors que l’on écarte ces deux visions, la souveraineté économique consiste pour l’essentiel à s’assurer de la disponibilité de certaines productions jugées essentielles. Elle peut justifier, sous certaines conditions, de mener des politiques actives de relocalisation de produits jugés stratégiques, mais aussi d’engager une politique industrielle de rattrapage technologique.
Emmanuel Combe,
Professeur des universités, professeur à la Skema Business School, vice-président de l’Autorité de la concurrence.
Sarah Guillou,
Économiste, directrice du département Innovation et Concurrence de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), chercheuse associée à la Skema Business School.

Relocaliser la production après la pandémie ?

Relocaliser en France avec l'Europe

Europe : la transition bas carbone, un bon usage de la souveraineté

Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat

Relocaliser en décarbonant grâce à l'énergie nucléaire

L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (1)

L’Europe face aux nationalismes économiques américain et chinois (2)

L'Europe face aux nationalismes économiques américains et chinois (3)

Les géants du numérique (1) : magnats de la finance

Les géants du numérique (2) : un frein à l'innovation ?

Avant le Covid-19, le transport aérien en Europe : un secteur déjà fragilisé
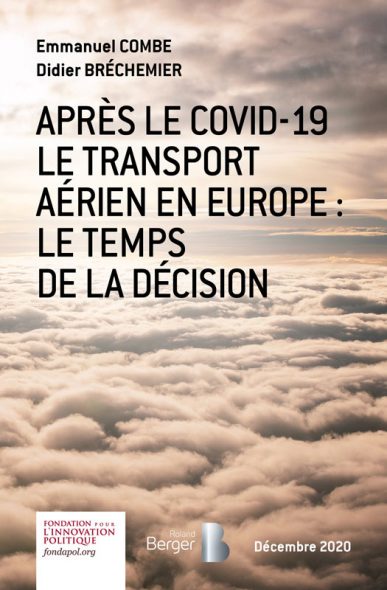
Après le Covid-19, le transport aérien en Europe : le temps de la décision
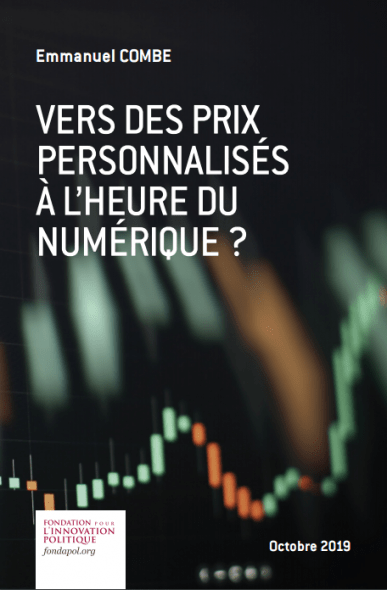
Vers des prix personnalisés à l'heure du numérique ?
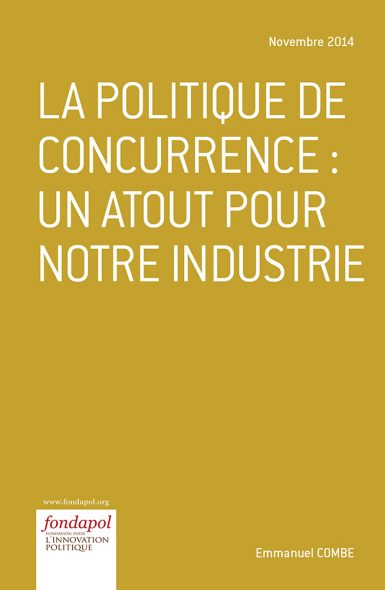
La politique de concurrence : un atout pour notre industrie

Pouvoir d’achat : une politique
Souveraineté économique : entre ambitions et réalités
22 idées
Idée 1 : Le désir d’autarcie se construit sur le « mythe du potager », consistant à vouloir tout faire soi-même.
Idée 2 : Le désir d’autarcie se construit aussi sur une demande de proximité géo- graphique, qui peut se révéler coûteuse pour un pays.
Idée 3 : Aucun pays ne possède la totalité des ressources dont il a besoin. Il doit donc accepter une forme de dépendance.
Idée 4 : L’autonomie stratégique, version moderne de l’autarcie, suppose de définir au préalable les contours de ce qui est «stratégique ».
Idée 5 : La politique de l’autonomie stratégique peut se retourner contre la souve- raineté elle-même.
Idée 6 : La seconde liaison dangereuse de la souveraineté économique est le mer- cantilisme. Sa version contemporaine estl’obsession pour le déficit de la balance commerciale.
Idée 7 : Importer permet d’exercer le privilège de l’acheteur.
Idée 8 : Les importations ne révèlent qu’une partie de la dépendance à un fournisseur.
Idée 9 : Les importations et les exportations sont deux phénomènes joints et s’auto-entretenant.
Idée 10 : Quelle que soit l’ampleur de la politique menée, il est illusoire d’espérer un mouvement massif de relocalisations, dans lamesure où les entreprises françaises ont peu délocalisé.
Idée 11 : Même sans mener une politique active, il y aura un mouvement « naturel » mais limité de relocalisation.
Idée 12 : Si les pouvoirs publics veulent mener une politique de relocalisation et d’attractivité du territoire, le levier le plus efficace setrouve du côté des réformes structurelles, mais ce levier est peu visible et difficile à mettre en œuvre.
Idée 13 : Une politique d’aide ciblée à la relocalisation est préférable. Elle consiste pour les pouvoirs publics à identifier des bienset services essentiels, pour lesquels le stockage et la diversification des approvisionnements ne constituent pas des solutionssuffisantes ou possibles.
Idée 14 : Une fois identifiés les produits dont la relocalisation est essentielle, les pouvoirs publics devraient apprécier le coût d’unepolitique de relocalisation et en informer l’opinion publique.
Idée 15 : Une fois prise, la décision de relocaliser doit être mise en œuvre suivant un processus d’appel d’offres.
Idée 16 : Une aide publique (ou une protection) peut se justifier temporairement si elle permet à l’industrie de descendre le long de lacourbe d’expérience et de rattraper son retard.
Idée 17 : Outre les économies d’expérience, une politique de rattrapage peut se justifier par la présence d’économies d’échelleexternes. L’enjeu est alors d’accroître la taille du marché intérieur en procédant à une plus forte intégration.
Idée 18 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que l’innovation technologique dans le secteur soit mature et n’expose pas au risque d’avoir toujours un « train de retard ».
Idée 19 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que les acteurs soient convaincus que la politique d’aide sera limitéedans le temps.
Idée 20 : Le succès d’une politique de rattrapage est d’autant plus probable que le secteur n’est pas en situation de monopole sur lemarché domestique.
Idée 21 : Le cloud constitue un bon exemple d’activité essentielle nécessitant un rattrapage des Européens.
Idée 22 : Toute politique de rattrapage implique un coût d’opportunité pour la collectivité. Il est nécessaire que les pouvoirs publicsl’explicitent.
Introduction
Voir, par exemple, Guillemette Petit, « La mondialisation fait-elle l’unanimité en France et à l’international ? », 24 novembre 2016.
Dominique Reynié (dir.), Démocraties sous tension, I, « Les enjeux », Fondation pour l’innovation politique/International Republication Institute, 2019, p. 50.
Voir David Todd, L’Identité économique de la France. Libre-échange et protectionnisme 1814-1851, Grasset, 2018.
Louis Le Fur, État fédéral et Confédération d’États, Marchal et Billard, 1896, p. 443.
La pandémie de Covid-19 a conduit à un retour de la question de la souveraineté au premier plan des débats économiques. En effet, au pic de la pandémie, l’insuffisance de l’offre mondiale face à une demande démultipliée de produits et d’équipements de production médicale a déclenché des pénuries et des tensions politiques pour en assurer l’approvisionnement. La pandémie a mis en évidence que l’ordre économique mondial pouvait être incompatible avec l’ordre politique, tant ce dernier se révélait non coopératif face à la gestion d’un choc pourtant commun.
Dans un contexte de tensions géopolitiques déjà fortes, notamment en raison des relations commerciales sino-américaines tendues, la pandémie a alimenté un discours de repli sur des stratégies nationales de sortie de crise et sur l’impératif de « souveraineté économique ». Le sujet de la souveraineté économique reçoit un accueil particulièrement favorable en France, dans la mesure où il s’ancre dans un terreau de défiance vis-à-vis de la mondialisation. À cet égard, les résultats de nombre d’enquêtes vont tous dans le même sens : la France occupe une position atypique au sein des pays riches, affichant l’un desplus forts taux de rejet de la mondialisation 1.
Selon une récente étude internationale, si à l’échelle de l’Union européenne une nette majorité (59%) de citoyens perçoivent la globalisation comme une opportunité, seuls 44% des Français abondent dans ce sens 2. L’opinion française vis-à-vis de la mondialisation s’exprime également par le sentiment très fréquent selon lequel elle renforcerait les inégalités sociales.
Cette défiance entre en résonance avec le discours politique dominant, de gauche comme de droite, qui affiche une certaine bienveillance à l’égard du protectionnisme et porte une vision mercantiliste du commerce international. L’expression « importer moins, exporter plus » fait quelque peu figure de mantra chez nombre de décideurs politiques. Comme l’a montré l’historien David Todd, depuis le XVIIIe siècle, Colbert a supplanté Turgot comme saint patron des ministres de l’Économie successifs, et ce quelle que soit leur couleur politique 3.
Pour autant, la thématique de la « souveraineté économique » ne se réduit pas à un simple discours protectionniste. Certes, souveraineté et protectionnisme incarnent une même volonté de « reprise en main » d’une mondialisation dont les citoyens et les décideurs politiques ont le sentiment qu’elle leur échappe, mais ces deux thèmes prennent également appui sur un même sentiment : la mondialisation opérerait une sorte de déracinement, en éloignant la consommation des lieux de production.
Cependant, le débat sur la souveraineté économique connaît des inflexions nouvelles. Tout d’abord, alors que le discours protectionniste cible en général un pays (le Japon dans les années 1980, la Chine aujourd’hui), le discours sur la « souveraineté » va plus loin et considère que la menace est diffuse et globale. Ce n’est plus seulement la Chine qui est montrée du doigt mais également les entreprises multinationales, coupables d’avoir fragilisé les approvisionnements en délocalisant et en organisant des chaînes de valeur mondiale (CVM). De même, le débat sur la souveraineté économique fait une large place en Europe aux inquiétudes sur la dépendance numérique : l’Europe serait devenue une simple « colonie numérique » vis-à-vis des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Cette inquiétude est d’autant plus forte que l’Europe apparaît isolée, la Chine ayant constitué de son côté, avec les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), sa propre réplique aux GAFAM américains.
Ensuite, alors que le discours usuel sur le protectionnisme met en avant la défense de l’emploi domestique face à la croissance des importations, le discours sur la souveraineté insiste à présent sur la dépendance du pays concernant certaines productions jugées « essentielles » ou « stratégiques ». L’enjeu est de retrouver une forme d’indépendance, en rétablissant un lien de proximité entre production et consommation, et en renforçant la résilience des chaînes de valeur.
Enfin, le remède proposé se rapproche plus d’une politique industrielle offensive que d’une politique défensive, consistant à instaurer des droits de douane ou des quotas pour contenir les importations. La souveraineté économique remet à l’honneur l’idée de relocalisation, de construction d’avantages comparatifs, de politique industrielle et de rattrapage.
Mais quel contenu exact donner à cette notion de « souveraineté économique » ? La question mérite d’autant plus d’être posée que la souveraineté n’est pas un concept usuel en économie. Cette notion nous vient du champ politique, juridique et militaire, et se définit, littéralement, comme le fait et le droit d’exercer une autorité absolue sur un territoire donné. Elle s’applique tout particulièrement dans le domaine des relations politiques internationales, en désignant le fait qu’un État ne soit « obligé ou déterminé que par sa propre volonté 4 ». La souveraineté d’un pays est alors très proche de la notion d’indépendance : un pays souverain est un pays qui n’est pas dépendant des autres et fait ses choix librement, sans aucune contrainte extérieure.
Transposée stricto sensu au champ économique, cette notion de souveraineté conduit à préconiser un retour plus ou moins prononcé à une forme d’autarcie. Pour ne dépendre de personne, un pays devrait en quelque sorte se mettre « hors du monde », à l’image de ce que préconisent certains souverainistes. Sortir de la globalisation, ce serait ainsi taxer fortement toutes les importations, sortir de l’Europe et de l’euro, répudier sa dette, fermer les frontières à l’immigration ou bien encore instaurer le contrôle des capitaux.
Nous montrerons dans une première partie qu’une telle politique maximaliste conduirait inéluctablement à une impasse, pour ne pas dire à une quasi-impossibilité. Comme les pays sont structurellement dépendants les uns des autres, que ce soit par le biais du commerce international, des investissements directs, des flux de capitaux ou des migrations, le retour à l’autarcie aurait un coût économique exorbitant, ce qui rend ce choix peu probable et crédible. De même, mais de manière moins excessive, une politique de souveraineté d’inspiration mercantiliste, qui viserait à réduire les importations, aurait des effets opposés à ceux recherchés. En définitive, autarcie comme mercantilisme peuvent jouer contre les performances de l’économie et se révéler contradictoires avec l’objectif de souveraineté économique (partie I).
Dès lors que l’on écarte ces deux visions maximalistes du retour à la souveraineté, le débat se pose en des termes plus réalistes. Ce qui préoccupe aujourd’hui la majorité des décideurs politiques, c’est le défaut de souveraineté économique constaté sur quelques productions jugées « essentielles ». C’est dans cette acception plus étroite du sujet que nous poserons les termes du débat dans les deuxième et troisième parties de la présente note. Cette demande de souveraineté « exceptionnelle » s’est notamment exprimée durant la pandémie de Covid-19 sur certains produits et équipements de protection médicale. Les tensions sur leur approvisionnement ont mis au jour la fragmentation de la production mondiale et l’importance incontournable de certains fournisseurs. Les citoyens des pays riches ont été sidérés par la révélation des pénuries tant ils étaient habitués à l’abondance et au confort de la supériorité de leur pouvoir d’achat à l’échelle mondiale. Au-delà de l’épisode de la crise sanitaire, le sentiment d’une dépendance structurelle de l’Europe à l’égard des États-Unis – et même de la Chine dans les équipements pour la 5G – se manifeste aussi dans des secteurs tels que le numérique ou des technologies d’avenir telles que les batteries électriques. Ce défaut de souveraineté conduit aujourd’hui les pouvoirs publics à prôner la relocalisation des entreprises qui ont quitté le territoire (partie II), mais aussi le rattrapage technologique, au travers de la construction d’avantages comparatifs dans certaines productions (partie III).
Autarcie et mercantilisme
La souveraineté économique s’est invitée dans le débat public et s’y déploie avec l’aisance d’une idée devenue incontournable. Pourtant, ce concept ne va pas de soi si l’on cherche à le définir et à en identifier les tenants et aboutissants. Pour comprendre ce qu’est la souveraineté économique, il est nécessaire de repartir de ses origines idéologiques : l’autarcie et le mercantilisme. Ces racines aident à comprendre les limites du concept.
La tentation de l’autarcie et de l’autonomie stratégique
Voir Richard Baldwin, The Great Convergence. Information Technology and the New Globalisation, The Belknap Press of Harvard UniversityPress, 2016
Voir Joseph Davis et Douglas A. Irwin, « Trade Disruptions and America’s Early Industrialization », NBER Working Paper, n° 9944, août 2003, et Douglas A. Irwin, « The Welfare Cost of Autarcy: Evidence from the Jeffersonian Trade Embargo, 1807–09 », Review of International Economics, vol. 13, n° 4, septembre 2005, p. 631-645.
Dans son acception littérale, la souveraineté économique est associée à l’idée que tout ce qu’un pays consomme doit être produit par lui-même. Or vouloir produire soi-même tout ce que l’on consomme revient à prôner peu ou prou l’autarcie. C’est la première liaison dangereuse de la souveraineté économique.
L’autarcie est bien évidemment une option radicale, rarement plébiscitée dans sa version stricte. À vrai dire, elle n’a jamais vraiment existé dans l’histoire contemporaine. Avant même les premières théories économiques démontrant les gains à l’échange, les peuples commerçaient entre eux et les marchés étaient un mode de coordination des activités économiques entre des territoires plus ou moins éloignés. L’histoire de la globalisation révèle plutôt le découplage progressif entre lieux de production et lieux de consommation. La sédentarisation s’est accompagnée progressivement d’une spécialisation de la production. En devenant sédentaires, les peuples ont réduit la diversité de leur consommation et l’échange est né de cette spécialisation. Les femmes et les hommes se sont mis à consommer des biens produits beaucoup plus loin que leur lieu d’habitation. On a aussi mis en évidence un deuxième découplage, consistant en l’éparpillement des lieux de production d’un même bien avec différents maillons de la chaîne de valeur distribués à travers le monde 5. Il anticipe une troisième étape du découplage, celle où les technologies numériques rendront le mouvement des idées (et donc des innovations) encore plus global et affranchi de tout ancrage territorial.
On peut toutefois déceler quelques épisodes d’autarcie partielle dans l’histoire contemporaine. Ainsi, les États-Unis en ont fait momentanément l’expérience, entre 1807 et 1815, lorsque le président Thomas Jefferson a décrété l’embargo vis-à-vis du principal partenaire du pays, le Royaume-Uni et son empire, dans le contexte tendu de l’indépendance américaine 6. Aujourd’hui, on peut considérer que les politiques d’embargo constituent également une forme partielle d’autarcie « contrainte » : elles sont utilisées comme une arme géopolitique dans le but de « punir » un autre pays, en l’appauvrissant et en ne lui donnant pas les moyens de se développer.
| Idée 1 : Le désir d’autarcie se construit sur le « mythe du potager », consistant à vouloir tout faire soi-même. |
Dans le débat sur la souveraineté économique, la question de la perte d’autonomie de production est récurrente. Elle se base sur l’idée que si l’on ne produit pas soi-même, on perd en autonomie et donc en souveraineté. La rhétorique est assez simple : si l’on manque de certains produits, c’est parce qu’on manque de producteurs nationaux. C’est ainsi que durant la crise du Covid-19, au plus fort de l’épidémie, la comparaison avec l’Allemagne, pays plus manufacturier que la France, a conduit à associer les difficultés françaises d’approvisionnement en produits médico-sanitaires avec la désindustrialisation française. C’est une analyse économiquement discutable puisqu’elle revient à ne pas considérer le principe même de division internationale du travail.
Pour mieux saisir l’essence d’une telle affirmation, une analogie peut être faite avec le choix d’un individu de cultiver ou non son potager. Le « mythe du potager » consiste à affirmer que si l’on ne peut pas consommer de tomates, c’est qu’on n’en cultive pas soi-même dans son jardin. Il apparaît à première vue évident que la proximité de la production (ici, dans le jardin) offre l’assurance de ne pas manquer de fruits ou de légumes. Et, pourtant, la plupart des individus ont renoncé à cultiver leur potager pour se nourrir, tout simplement parce que cultiver son propre potager a un coût, aussi bien en termes de temps, d’argent ou de variété et de qualité de la consommation. Il en va ainsi du potager comme de l’ensemble de la production.
Ce « mythe du potager » est réapparu depuis le début de la pandémie, au motif que la maîtrise de la production domestique aurait écarté les risques de pénurie ou d’insuffisance de l’offre. Tout un chacun sait pourtant que la capacité à manger des tomates repose plutôt sur le pouvoir d’achat et sur la disponibilité des tomates chez les fournisseurs. Ce qui vaut pour les tomates vaut aussi pour les masques ou les ventilateurs. Pour les trois productions, on peut envisager d’échanger ce que l’on a pour obtenir des produits fabriqués par autrui ; dans les trois cas, s’il y a pénurie chez autrui ou une incapacité à faire voyager les produits, l’impossibilité de consommer se produira. Tout dépend, d’un côté, du pouvoir d’achat et, de l’autre, des capacités de production et du pouvoir de marché des propriétaires de ces capacités. Ainsi, bien que les producteurs de ventilateurs soient européens, et non asiatiques, donc plus proches de nous, la pénurie est pourtant apparue, tout autant que celle portant sur les masques essentiellement importés d’Asie.
| Idée 2 : Le désir d’autarcie se construit aussi sur une demande de proximité géographique, qui peut se révéler coûteuse pour un pays. |
Si la plupart des individus ont renoncé au potager dans leur jardin, nombre d’entre eux continuent toutefois de soutenir qu’il est préférable que celui-ci soit situé à proximité des lieux de consommation. Mais en quoi la proximité constitue-t-elle un avantage ?
Bien entendu, l’un des premiers avantages est un coût de transport inférieur et un impact environnemental du transport des marchandises plus faible. Ce premier avantage devrait se traduire par un prix compétitif pour le consommateur, surtout pour des denrées périssables. Un autre avantage est celui de la proximité avec la demande, qui peut être un argument de qualité du produit. On pense là, par exemple, aux différents services de proximité.
Mais il existe également des forces économiques contraires, qui poussent à ne pas tout avoir à proximité. Il existe en effet des gains d’agglomération : le but est alors de se localiser près des intrants, qu’il s’agisse des compétences, des matières premières ou des biens intermédiaires, ou à proximité des infrastructures qui permettent le déploiement à l’étranger (ports, aéroports, gares). L’économie géographique a bien montré qu’un processus d’agglomération pousse à la concentration géographique et donc contrevient à la logique de dispersion des activités sur un territoire. La localisation optimale des activités repose ainsi sur un arbitrage entre les avantages de la proximité et ceux de la localisation dans des zones qui réduisent les coûts de production ou qui augmentent l’efficacité.
Toutefois, il est vrai que la proximité, lorsqu’elle conduit à localiser la production sur le territoire national, permet d’exercer une forme de contrôle sur les producteurs. Et avoir des producteurs locaux est tout d’abord un moyen de s’assurer que ceux-ci produisent selon les normes sanitaires et réglementaires, voire culturelles, du pays. De plus, cela permet au gouvernement, à tout moment, de pouvoir imposer des quotas d’exportation, de fixer des prix plafonds, même de réquisitionner la production.
Ce sont là des arguments légitimes, souvent au cœur des ambitions souverainistes, mais dont la portée est relative. Le premier argument vacille, quand on réalise que des normes peuvent aussi être imposées aux fournisseurs étrangers et que c’est la force du marché interne qui conduira à l’imposition de ces normes, ce qui explique l’intérêt de l’intégration réglementaire du marché européen. De plus, l’idée de fixer des quotas d’exportation ou des prix plafonds ne peut être mobilisée que dans des situations exceptionnelles et ne peut tenir en régime normal, au risque sinon d’inciter les entreprises à ne pas investir. Enfin, la possibilité de réquisition ne résout pas la gestion des tensions sur l’offre en cas de choc externe, comme une pandémie par exemple.
| Idée 3 : Aucun pays ne possède la totalité des ressources dont il a besoin. Il doit donc accepter une forme de dépendance. |
Voir Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, 2018.
Voir Paul-Adrien Hyppolite, Relocaliser la production après la pandémie ?, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.
Un pays ne peut pas posséder l’ensemble de ses ressources, en particulier de ses ressources naturelles. L’échange naît justement de ces différences de dotations naturelles. Une partie de nos échanges et de notre dépendance vis-à-vis de fournisseurs vient de ce que ces derniers sont les seuls à posséder une ressource rare. Ainsi, par exemple, la plupart des vaccins nécessitent l’addition d’adjuvants. Parmi eux, l’un des plus élaborés est obtenu à partir d’une substance naturelle issue d’un arbre d’Amérique du Sud, notamment du Chili, le Quillaja saponaria, et la Suède en est le plus grand transformateur via son entreprise Isconova-Novavax (rachetée par l’américain Novavax en 2013). L’importation du Chili ou de Suède est donc incontournable pour les autres pays.
Un autre exemple est celui de la production d’iPhone. Une hypothétique relocalisation de l’ensemble des étapes de la production aux États-Unis serait tout simplement impossible techniquement. En effet, un iPhone incorpore pas moins de 75 éléments de la table périodique. Or tous ne sont pas présents, physiquement ou dans des conditions économiques rentables, sur le sol américain. Par exemple, les États-Unis ne disposent pas de grandes mines de bauxite, matière première utilisée pour faire de l’aluminium. Près des trois quarts des réserves connues de ce minerai se situent dans cinq pays : Australie, Brésil, Chine, Inde et Guinée. De même, les terres rares sont produites à 85% en Chine. Les États-Unis n’ont donc pas d’autre choix que de les importer s’ils veulent produire des composants comme l’objectif de la caméra du iPhone (nécessitant du lanthane)ou les transistors du iPhone (utilisant du hafnium).
Cet état de fait crée pour chaque pays une « dépendance nécessaire » sur certaines matières premières, ce qui peut devenir problématique tant d’un point de vue économique que géopolitique. En effet, comme l’a montré le journaliste Guillaume Pitron, la capacité des pays riches à poursuivre leur transformation numérique et écologique repose sur la disponibilité en terres rares, massivement sous le contrôle de la Chine 7.
Il en est aussi ainsi de toutes les énergies renouvelables, des éoliennes aux batteries, de l’ensemble de l’électronique utilisant des semi-conducteurs 8, mais aussi de certaines armes de défense. Toutes ces technologies nécessitent des métaux rares, aux puissances énergétiques majeures, du très parlant prométhium au plus connu lithium.
Le besoin en métaux et en terres rares démontre, d’une part, que l’autarcie est impossible et, d’autre part, que l’interdépendance, c’est-à-dire la dépendance réciproque, reste l’instrument politique et géopolitique le plus efficace à court terme pour gérer les tensions économiques liées à cette dépendance. En effet, lorsque la dépendance à un seul fournisseur ne peut être contournée, il est opportun de mutualiser le risque sur l’ensemble des relations économiques que l’on a avec le pays de ce fournisseur.
| Idée 4 : L’autonomie stratégique, version moderne de l’autarcie, suppose de définir au préalable les contours de ce qui est « stratégique ». |
Si l’autarcie au sens strict n’existe pas ou plus, une version contemporaine et allégée de l’autarcie, l’« autonomie stratégique », consiste à vouloir produire non pas tout, mais des biens et services jugés « stratégiques ». Mais comment définir ces productions dites stratégiques ? La notion de bien ou d’activité stratégique est couverte par de nombreux textes de droit, et ce dans la plupart des pays. Le dénominateur commun à ces définitions est constitué par les notions régaliennes de sécurité et d’indépendance nationale : il existerait des biens pour lesquels l’absence de contrôle sur la production mettrait en péril la sécurité nationale et/ou l’indépendance nationale.
Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoient d’ailleurs elles-mêmes ce motif exceptionnel. L’article XXI de son règlement général envisage la possibilité de protection commerciale pour des motifs de sécurité nationale. Comme pour les clauses d’exemption à l’application des traités sur les droits de douane, les États doivent mettre dans la loi les critères qui définissent le régime d’exception. Mais cet article XXI a été prévu pour des situations de guerre. La vertu de ces lois d’exception réside dans la définition ex ante de ce qui relève de la sécurité et de l’indépendance nationale :le périmètre des produits « stratégiques » est clairement identifié. La définition des biens stratégiques doit donc être trèsprécisément encadrée. C’est un prérequis pour la sécurité juridique, sans laquelle l’attractivité du territoire ne peut se construire, mais aussi pour que les entreprises ne gaspillent pas leur énergie et leurs ressources à capturer des protections et autres subventions.
A contrario si la définition n’est pas stricte ou si elle est évolutive, il existe un risque réel d’instrumentalisation de la notion de produit stratégique. Les entreprises vont tenter d’influencer les décideurs politiques sur la définition de ce qui est stratégique, afin d’être protégées de la concurrence étrangère. L’administration Trump a excellé dans cette logique politique, en utilisant une loi de 1962 qui autorise le gouvernement américain à mettre en place des droits de douane s’il existe des menaces sur la sécurité nationale. Jusqu’à présent, cette loi avait été rarement utilisée. Elle a été sollicitée à partir de 2018 pour mettre en place des droits de douane sur l’acier et l’aluminium.
Dans la même veine, il est intéressant d’analyser le glissement opéré en France sur le périmètre des activités stratégiques, telles qu’elles sont appréhendées lors du contrôle des investissements étrangers. Au départ, l’article L151-3 du Code monétaire et financier a instauré un principe général de contrôle pour les « activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ». Ce mécanisme est bien présenté comme dérogatoire au principe général, énoncé dans l’article L151-1 du même code, selon lequel « les relations financières entre la France et l’étranger sont libres ». Puis, au fil du temps, des secteurs ont été ajoutés, sous la forme d’une liste. Ainsi, le décret Villepin de 2005 puis, en 2014, le décret Montebourg et, enfin, en 2018, la loi Le Maire ont progressivement étendu le champ de ce qui est stratégique, au point d’inclure à présent une très grande diversité d’activités et d’entreprises. On peut se demander quel est le sens véritable d’une politique qui considère que la majorité des activités sont « stratégiques » : plus la liste s’élargit, plus la notion se vide de son sens. Quand tout devient stratégique, plus rien ne l’est véritablement.
| Idée 5 : La politique de l’autonomie stratégique peut se retourner contre la souveraineté elle-même. |
Voir Thierry Mayer et Gianmarco Ottaviano, « The Happy Few: The internationalisation of European New facts based on firm-level evidence », Bruegel Blueprint Series, n° 3, 2007.
L’autonomie stratégique revient à fermer le marché domestique à des producteurs étrangers pour quelques productions jugées essentielles. Cette politique entraîne en général une riposte immédiate des pays concernés par la restriction d’accès. Ils ferment à leur tour leur propre marché domestique au pays qui se protège de cette façon. Il s’agit d’un principe classique en théorie des jeux non coopératifs : si un pays A décide de se protéger à l’encontre d’un pays B, la meilleure réponse du pays B est de riposter en se protégeant à son tour. Tout le gain anticipé du protectionnisme est alors réduit à néant : ce que le pays A gagne en diminution des importations est compensé par une perte de débouchés à l’exportation vers B. Et c’est exactement ce qui s’est passé dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le déficit commercial américain avec la Chine, qui devait être réduit grâce au protectionnisme, a atteint un niveau record de 419 milliards de dollars en 2018, notamment parce que les exportations américaines vers la Chine ont chuté.
Il convient de noter que les décisions protectionnistes sur une production ont une incidence sur les productions non protégées dans la mesure où les représailles s’étendent au-delà du seul produit protégé : les partenaires cherchent à frapper un secteur important pour le pays qui se protège, sinon les représailles n’auraient aucun poids. Par exemple, un pays étranger ne va pas taxer les importations de paracétamol venant de France, puisqu’elles n’existent pas, mais il va cibler les produits français du secteur du luxe, les alcools et spiritueux, les automobiles, le nucléaire ou l’aéronautique civile et de défense. Les représailles affaiblissent les secteurs pour lesquels le pays dispose d’un fort avantage comparatif.
Au-delà des représailles, le protectionnisme peut également conduire à renforcer le positionnement du partenaire commercial en le rendant plus autonome. Ainsi, la volonté de l’administration Trump de découpler l’économie américaine des exportations chinoises et de limiter les exportations américaines d’intrants électroniques et numériques vers la Chine conduit paradoxalement à renforcer cette dernière. En effet, la politique américaine accélère la politique chinoise consistant à s’autonomiser sur un plan technologique et renforce sa souveraineté numérique vis-à-vis des États-Unis, faisant perdre à ces derniers des leviers de négociations.
De plus, le retour à une forme d’autarcie partielle réduit l’accès à des marchés d’exportation, ce qui est une stratégie coûteuse pour le pays. En effet, les études ont montré que les entreprises exportatrices sont les plus productives ; ce sont elles qui tirent l’essentiel des gains de productivité. Dans tous les pays, les entreprises exportatrices sont plus grandes, plus productives, plus profitables, plus rémunératrices et plus innovantes 9. Le graphique suivant met en évidence les surcroîts de productivité du travail des entreprises exportatrices relativement à leurs consœurs non exportatrices. Pour la France, l’estimation est que les entreprises françaises exportatrices sont en moyenne 18% plus productives que les autres sur la période 2004-2007.
Ce phénomène s’explique par le fait que pour exporter il faut être plus productif que la moyenne, afin de supporter le coût fixe de pénétration des marchés étrangers. De plus, le fait d’exporter améliore les effets d’apprentissage. L’accès au marché étranger est donc un moteur puissant de gains de productivité.
Surcroît de productivité des exportateurs par pays
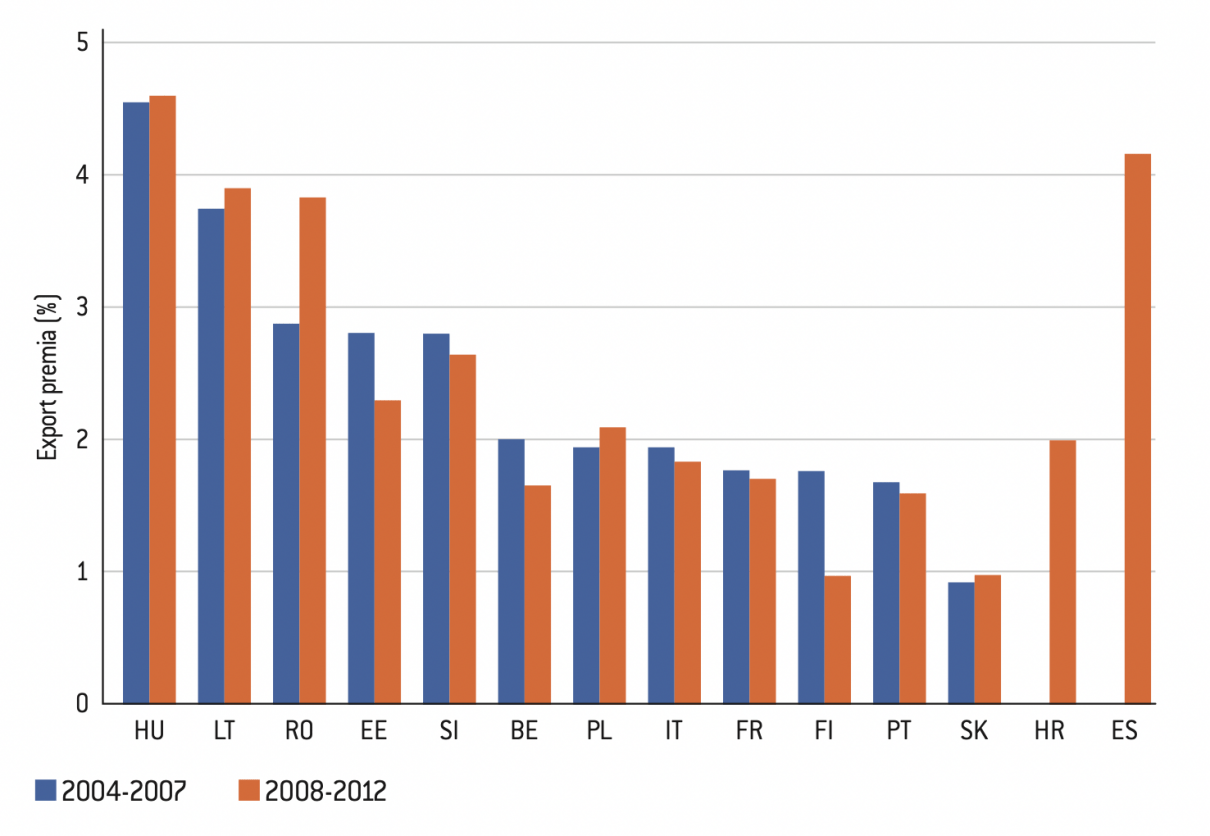
Source :
Antoine Berthou et al., « Assessing European firms’ exports and productivity distributions: the CompNet trade module », ECB Working Paper Series, n° 1788, mai 2015, p. 24.
Note : « Export premia » signifie le surcroît (ou prime) de productivité en pourcentage. Ainsi en France (FR), sur la période 2004-2007, si les exportateurs ont une productivité 18% supérieure que les non-exportateurs, cette prime baisse à 17% sur la période 2008-2012. Les autres pays analysés sont la Hongrie (HU), la Lituanie (LT), la Roumanie (RO), l’Estonie (EE), la Slovénie (SI), la Belgique (BE), la Pologne (PL), l’Italie(IT), la Finlande (FI), le Portugal (PT), la Slovaquie (SK), la Croatie (HR) et l’Espagne (ES).
Voir Robert Baldwin, « The Political Economy of Trade Policy », Journal of Economic Perspectives, vol. 3, n° 4, Automne 1989, p. 119-135.
Enfin, le dernier risque d’une politique d’autonomie stratégique est celui d’être capturée par certaines entreprises à leur propre profit. L’économie politique de la politique commerciale montre que les facteurs politiques (captation des votes et des financements de campagne) et les intérêts partisans (associations d’industriels, lobbying…) s’avèrent déterminants lorsque l’on veut comprendre des décisions protectionnistes 10. La définition de ce qui relève de la souveraineté économique appartient par essence au peuple, à qui seul revient le choix d’établir la liste des produits stratégiques. Si tel n’est pas le cas, la souveraineté économique risque de se construire au profit d’un petit nombre d’entreprises, conduisant en réalité à un détournement de souveraineté.
Du mercantilisme à l’obsession de la balance commerciale
Si l’argument de l’autarcie reste peu mobilisé dans les débats, il n’en va pas de même d’un autre discours qui, lui, s’inspire plus ou moins explicitement de la doctrine mercantiliste. Le mercantilisme, doctrine économique née au XVIIe siècle, était basé à l’origine sur la recherche d’une balance du commerce extérieur excédentaire, c’est-à-dire telle que les exportations dépassent les importations afin d’accumuler des entrées d’or et de favoriser la production domestique. De fortes restrictions aux importations furent alors mises en place. Les importations étaient honnies car elles se traduisaient par une sortie de métaux précieux et se substituaient à la production locale. En revanche, le développement des exportations était simultanément fortement encouragé par l’octroi de droits de monopole et autres soutiens à l’exportation. Ainsi, on fait souvent référence à Colbert en tant que premier homme d’État français incarnant la défense et la promotion des industries nationales, et de nombreux ministres de l’Industrie ou de l’Économie s’en réclament encore de nos jours.
| Idée 6 : La seconde liaison dangereuse de la souveraineté économique est le mercantilisme. Sa version contemporaine est l’obsession pour le déficit de la balance commerciale. |
Voir Sarah Guillou, Caroline Mini et Rémi Lallement, L’investissement français est-il efficace ?, Presses des Mines, 2018.
Même si l’économie de notre XXIe siècle n’a pas grand-chose à voir avec celle du XVIIe siècle, il reste encore aujourd’hui une certaine fascination en France pour le discours mercantiliste, qui s’exprime notamment au travers de la promotion des champions nationaux qui conquièrent les marchés étrangers (et qui sont de facto multinationaux) et d’une certaine méfiance à l’égard des importations. Cependant, contrairement au XVIIe siècle, cette méfiance n’est plus fondée sur la sortie de capital monétaire mais sur la croissance des importations, qui serait source de perte de compétitivité et de dépendance.
De nombreux observateurs voient dans le déficit de la balance commerciale française la marque d’un déficit de puissance économique, voire d’un déclin industriel. Pourtant, nul ne tire les mêmes conclusions quant à l’économie américaine, alors même que celle-ci cumule un déficit commercial de 3% de son PIB (contre moins de 1% pour la France avant la crise du Covid-19). En réalité, l’état de la balance commerciale révèle l’équilibre investissement/épargne d’une économie. Un déficit commercial exprime avant tout un excès d’investissement et de consommation par rapport à l’épargne.
Dans le cas de la France, la croissance est majoritairement tirée par la consommation des ménages. Or la consommation est un moteur puissant des importations, ce qui signifie qu’une économie qui consomme beaucoup importe ipso facto beaucoup. De plus, la propension à consommer d’un pays dépend elle-même de l’âge de la population : une population jeune consomme plus, en proportion de son revenu, qu’une population âgée (Allemagne, Japon…). L’épargne est un comportement de l’âge mature. Un autre facteur joue également : le déficit public, qui affecte négativement l’épargne publique tout en contribuant à augmenter les importations. Du côté des exportations, une économie qui se tertiarise connaîtun ralentissement de la dynamique de ses exportations. À l’inverse, plus une économie est industrialisée, plus elle exporte. Or la structure de l’investissement des entreprises en France est davantage orientée vers les investissements immatériels (R&D, logiciels…) comparativement aux autres pays européens 11.
Autrement dit, de multiples éléments structurels (tant à l’importation qu’à l’exportation) expliquent l’état de la balance commerciale, sans que l’on puisse en tirer de conclusions normatives sur l’état de souveraineté d’une économie. En outre, un déficit commercial est soutenable à partir du moment où les entrées de capitaux financent les importations – à défaut d’épargne suffisante –, sans que ces entrées de capitaux n’exercent de tensions sur le marché financier et monétaire. Or des entrées de capitaux sont le signe de l’attractivité du territoire et des promesses de rendements futurs. La question est donc moins l’état de la balance commerciale que le risque qu’exerce cet état sur les capacités de financement de l’économie. Si, comme c’est le cas des États-Unis et de la France, mais aussi du Royaume-Uni, le déficit est financé par des entrées de capitaux (investissement direct ou achat d’obligations d’État, par exemple), sans tension sur les taux de change ou les taux d’intérêt, alors le déficit commercial est soutenable.
| Idée 7 : Importer permet d’exercer le privilège de l’acheteur. |
Voir Patricia Nilsson et Emiko Terazono, « Can fast fashion’s $2.5tn supply chain be stiched back together? », ft.com, 15 mai 2020.
Eurostat, « International trade in goods », ec.europa.eu, 2020.
Voir « Près de la moitié des échanges réalisés avec les pays frontaliers », Études et Éclairages, n° 71, janvier 2017.
Importer, c’est d’abord le privilège d’être l’acheteur et donc de choisir le moment, la quantité et la qualité de ce que l’on veut acheter. Prenons l’exemple de l’industrie textile en Asie. Les pays riches importent 80% de leur textile, ce qui semble suggérer une certaine dépendance. Mais qui, des acheteurs ou des producteurs, a le plus souffert de la pandémie de Covid-19 dans cette industrie ? Les consommateurs européens ou les employés asiatiques des usines textiles en manque de travail ?
Les ouvrières du Bangladesh ou du Vietnam ont ainsi particulièrement souffert de la mise à l’arrêt des commandes des pays riches 12. On peut également faire la même analyse à l’égard des pays producteurs de pétrole, puisque notre dépendance au pétrole a pour symétrique leur vulnérabilité à l’arrêt de nos achats et à la chute des prix qui s’ensuit. Ainsi le confinement des pays riches a tari la demande de pétrole et fait plonger le prix du baril à moins de 20 dollars, mettant en grande difficulté les producteurs algérien, russe et du Moyen-Orient. Même le fonds « souverain » norvégien voit vaciller sa « souveraineté ».
Par ailleurs, importer reflète un choix qualitatif autant que quantitatif. Cette opportunité de choix est offerte par l’accès à unportefeuille diversifié de fournisseurs étrangers. C’est ce choix qualitatif qui augmente le bien-être des consommateurs finaux et qui contribue à la qualité des produits domestiques qui reposent sur des intrants importés.
Comme nous l’avons vu, l’échange repose sur des différences, qui relèvent très souvent de la différenciation des produits, alors même que les dotations en facteurs de production et en ressources des pays sont assez semblables. Ainsi en est-il de la plupart des échanges intra-européens, qui atteignent 60 à 65% des échanges des États membres pris individuellement 13. Ils se composent surtout d’échanges intra-branches, c’est-à-dire de biens et services qui appartiennent à la même industrie. Personne ne s’étonne, en effet, qu’on importe des voitures d’Allemagne et que la France y en exporte aussi. C’est également vrai pour d’autres industries. Ce qui surprend davantage est que l’on importe ce que l’on produit soi-même. L’intérêt qu’on y trouve est de pouvoir disposer du choix et de la variété.
Il est vrai que parfois le nombre de fournisseurs peut être restreint, au point de renverser le privilège de l’acheteur – nous reviendrons sur ce point crucial dans la troisième partie –, mais ne perdons pas de vue que 80% des échanges sont intra-branches et correspondent d’abord à des échanges de variétés 14.
| Idée 8 : Les importations ne révèlent qu’une partie de la dépendance à un fournisseur. |
Voir « Les importations de biens intermédiaires dopent les performances à l’exportation », Études et Éclairages, n° 45, janvier 2014.
Ibid., p. 2.
Si le développement des échanges intra-branches s’est accéléré depuis les années 1960, les années 1990 ont connu le développement puis l’accélération, en 2000, de la fragmentation des chaînes de valeurs mondiales (CVM) suite à l’entrée de la Chine dans l’OMC. En conséquence, les importations brutes ne sont souvent que des maillons d’une chaîne jusqu’au produit final. Si les importations permettent d’identifier le point de départ de la dépendance, elles ne renseignent directement que sur le dernier vendeur et ne disent rien de la chaîne des dépendances qui peut être bien plus critique en amont des importations.
On peut ainsi importer de Belgique des substances actives médicamenteuses et être dépendant des Indiens sans importer pourtant directement d’Inde (par exemple, si les Belges importent des Pays-Bas qui, eux-mêmes, importent d’Inde). On peut importer du textile de Chine mais dépendre du Vietnam ou du Cambodge, car c’est de là que proviennent les tissus.
L’imbrication des CVM peut même conduire à des allers-retours dans les flux de commerce : la France importe des produits dont elle a pu fabriquer une partie du contenu qu’elle aura préalablement exportée. Autrement dit, une partie des importations peut avoir du contenu en production (bien ou service) domestique.
La fragmentation de la production sur de multiples localisations à travers le monde a fortement augmenté à partir des années 1990. Elle n’a ralenti que depuis la crise de 2008. En France, une étude des douanes sur le commerce de marchandises a établi qu’en 2012 les importations de biens intermédiaires représentaient la moitié des achats et que le contenu en importation des exportations pour les marchandises atteignait 40% il y a dix ans 15. L’étude des douanes concluait : « Un tel constat rompt évidemment avec les théories mercantilistes qui stigmatisent les importations. Il conduit aussi à se montrer prudent dans l’interprétation du solde commercial 16. »
Part en pourcentage du commerce de composants intermédiaires dans le total des échanges (1970-2015)
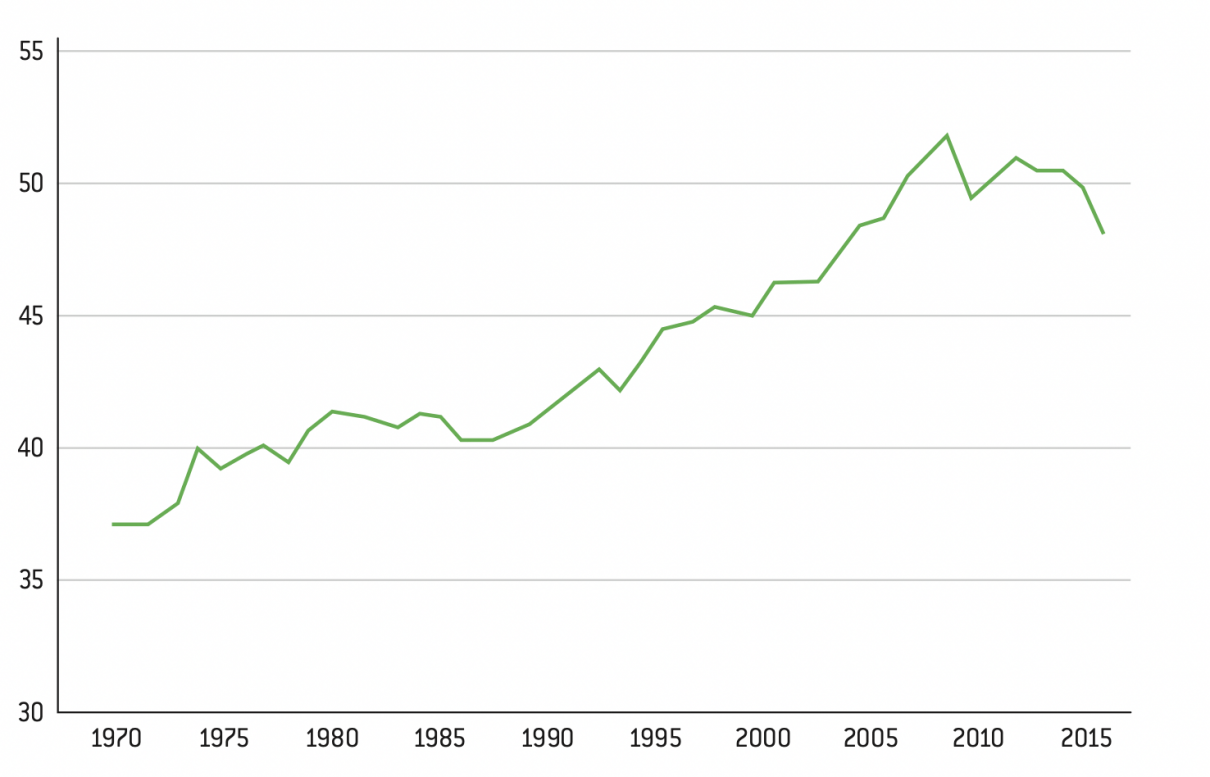
Source :
World Bank Group, World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains, 2020, p. 19 (téléchargeable).
Voir Raphaël Chiappini et Sarah Guillou, « Échanges commerciaux des produits et équipements de protection médicale. Quels enseignements de la pandémie de Covid-19 ? », OFCE Policy Brief, n° 77, 1er octobre 2020.
En définitive, compte tenu de l’importance des CVM, importer ne révèle qu’une partie de la chaîne de la dépendance technique. Autrement dit, si l’on se fonde sur l’origine première des importations, on risque d’établir un mauvais diagnostic sur la dépendance aux fournisseurs.
C’est parce que ce type d’échanges s’est fortement développé que, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, le confinement en Chine puis des autres pays a paralysé le commerce mondial. La centralité de la Chine dans la production manufacturière des produits et équipements de protection médicale a conduit à de fortes tensions sur l’offre 17, mais c’est en fait des fournisseurs en cascade en lien avec la Chine qui ont dû se réorganiser.
Les CVM créent beaucoup d’interdépendances entre les pays dans certains secteurs. Cela complexifie la compréhension des chaînes de dépendance et aussi des sources des ruptures d’approvisionnement. Certains secteurs sont fortement exposés à ce type d’échange (voir graphique page suivante). Il s’agit avant tout des secteurs de haute technologie (équipements de transport, équipements électriques, optiques et électroniques, et chimie-pharmacie), dont l’organisation de la production se fait en chaînes de valeur complexes (plus de deux frontières traversées avant l’obtention du bien final). Dans ces secteurs, l’organisation en CVM est la contrepartie ainsi que le moteur du progrès technique. Dans ces secteurs, y renoncer pourrait être très coûteux.
Cette organisation mondiale de la production montre deux choses : d’une part, que les importations sont un indicateur trompeur de la dépendance ; d’autre part, que la relocalisation à visée autarcique (totale maîtrise de la filière) ne revient pas simplement à se substituer à un fournisseur étranger mais à une multiplicité de fournisseurs spécialisés, chacun concourant à la réalisation du produit fini.
Participation aux chaînes de valeur mondiale par secteur (1995-2011)
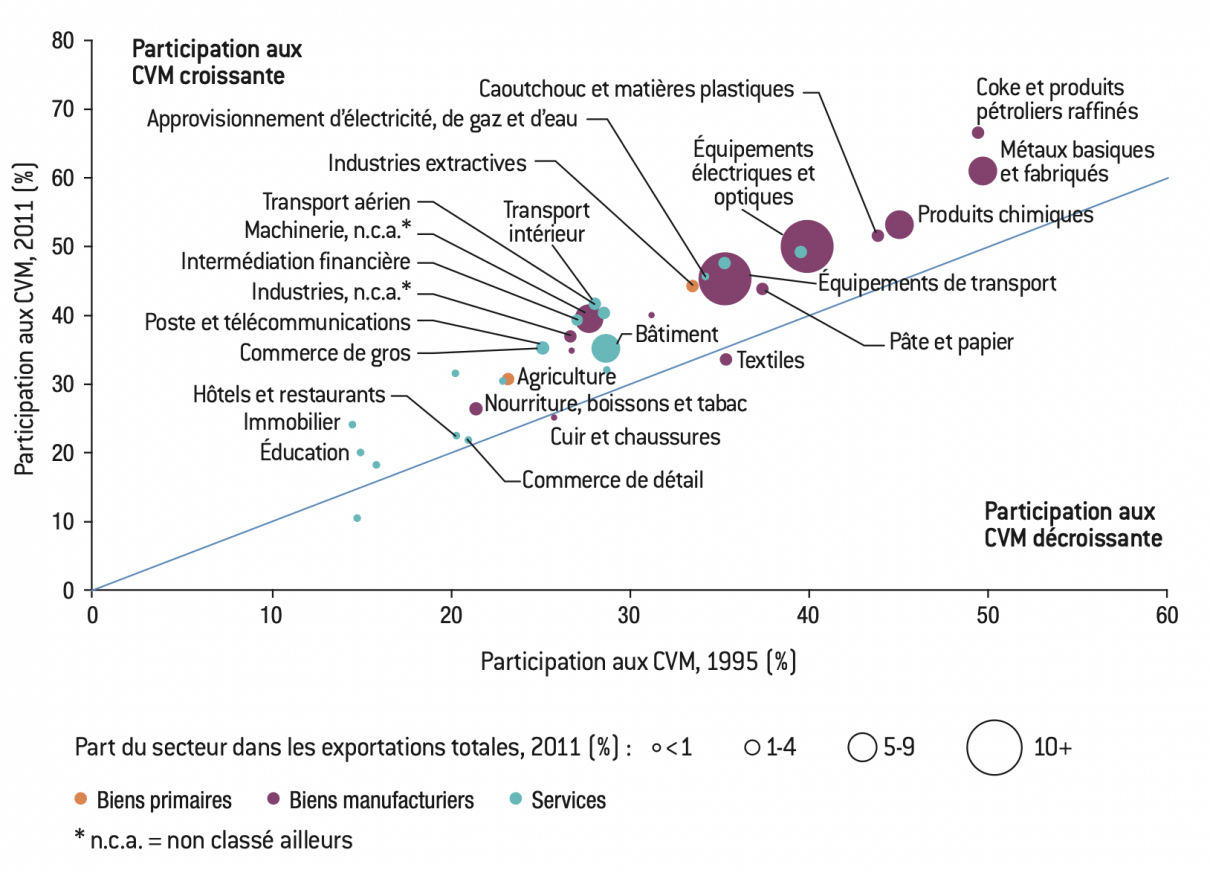
Source :
World Bank Group, World Development Report 2020. Trading for Development in the Age of Global Value Chains, 2020, p. 27.
Note : le graphique met en relation la participation aux CVM en pourcentage, en 1995 en abscisse et en 2011 en ordonnée. Les cercles représentent des secteurs de l’économie et leur diamètre est proportionnel à la taille de l’industrie dans les exportations mondiales. Tous les cercles au-dessus de l’axe bleu ont connu un accroissement dans leur participation aux chaines de valeur mondiales entre 1995 et 2011.
| Idée 9 : Les importations et les exportations sont deux phénomènes joints et s’auto-entretenant. |
Insee, Les Entreprises en France, édition 2016 (téléchargeable).
Ces ratios peuvent être bien plus élevés pour certains pays et dans certains Par exemple, en Chine, la moitié des exportations de produits des technologies de l’information et des télécommunications sont encore le fait d’entreprises étrangères.
OCDE, « Import content of exports », ocde.org, 2020.
Les importations constituent souvent le complément des exportations. Tout d’abord, le dynamisme des exportations est alimenté par les accords commerciaux qui ouvrent les marchés étrangers. Or, dans un univers d’État-nations indépendants, un accord commercial suppose de la réciprocité et donc d’ouvrir son marché aux exportations du partenaire, ce qui revient à importer davantage.
Ensuite, les exportateurs sont très souvent des importateurs, et ce pour trois raisons :
- l’insertion internationale résultant du fait d’exporter augmente la capacité de l’entreprise à nouer des relations avec les entreprises étrangères, ce qui augmente à son tour la probabilité qu’elle se mette à importer ;
- de nombreux exportateurs sont des filiales d’entreprises étrangères qui, par définition, ont des relations avec leur maison mère ou les autres filiales de leur groupe ; selon l’Insee, en 2014, on dénombre 22.571 entreprises qui sont des filiales de groupes étrangers, représentant 12% de l’emploi salarié hors agriculture, secteur financier et administration 18. Ces filiales contribuent à hauteur de près de un cinquième de la production marchande française et assurent 30% des exportations 19 ;
- les exportateurs importent pour devenir plus compétitif, c’est la logique qui est sous-jacente aux CVM.
La possibilité d’importer à bas prix des composants ou des matières premières permet à notre industrie d’être plus compétitive et donc d’exporter ensuite plus et mieux : importations à bas prix et performances à l’exportation sont étroitement liées. Le contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations a tendanciellement augmenté depuis vingt ans dans la plupart des pays. Dans le cas de la France, ce contenu est de l’ordre de 22% en 2015 et se révèle assez stable depuis dix ans ; cette part atteint même 27% si l’on tient compte des dépendances en abîme 20. On notera également la forte variance selon les secteurs – très fort dans les « matériels de transports » ou le textile et assez faible dans les services.
Le contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations françaises en 2005 et 2015 (par industrie et en %)
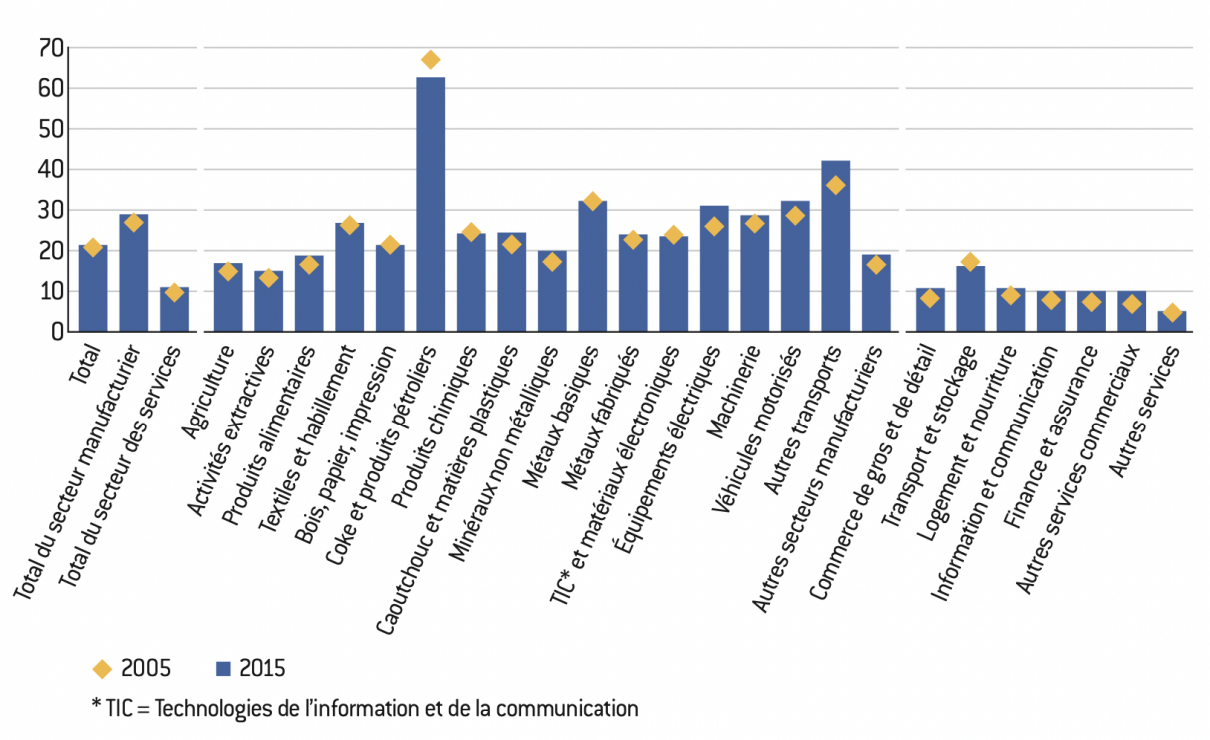
Source :
OCDE, « Import content of exports », ocde.org, 2020.
Lecture : ce graphique indique la part de la valeur ajoutée étrangère, c’est-à-dire le contenu en intrants étrangers, dans la production de chaque secteur.
Voir Maria Bas et Vanessa Strauss-Kahn, « Does Importing more Inputs Raise Exports? Firm Level Evidence from France », Review of World Economics, vol. 150, n° 2, mai 2014, p. 241-275.
Voir Pol Antràs, Teresa Fort et Felix Tintelnot, « The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms », American Economic Review, vol. 107, n° 9, septembre 2017, p. 2 514-2 564.
L’étude du contenu en valeur ajoutée étrangère des exportations montre la forte dépendance des deux phénomènes (importations à bas prix et performance des exportations), dépendance qui s’est accentuée avec la montée de la fragmentation mondiale de la production et de l’insertion dans les CVM.
Ajoutons que l’insertion dans les CVM et les importations ne sont pas seulement motivées par l’accès à des intrants à bas coûts. D’autres gains peuvent être identifiés. Ainsi, une étude a montré sur les données françaises que l’augmentation des importations d’intrants générait des gains de productivité pour les entreprises en raison de meilleures complémentarités entre les intrants et de transferts de technologies 21. Dans la même veine, d’autres chercheurs ont montré que les entreprises américaines qui avaient augmenté leurs importations en provenance de Chine entre 1997 et 2007 avaient également augmenté leurs approvisionnements domestiques 22.
Comme la demande d’intrants domestiques nécessite des travailleurs domestiques, on peut en conclure que le processus de globalisation a tiré la demande locale d’emplois vers le haut.
Pour conclure cette partie, l’appréciation de la souveraineté économique d’un pays ne peut se fonder à titre principal sur sa balance commerciale. Un déficit commercial ne peut s’interpréter ipso facto comme le signe d’une perte de souveraineté économique.
Cette première partie appelle donc à la prudence dans la mise en place d’une politique de souveraineté économique. Si l’autarcie et le mercantilisme sont des cas limites, ils restent néanmoins une source d’inspiration pour la mise en place de politiques d’autonomie stratégique. En dehors de cela, il reste un espace pour une politique de souveraineté économique. Ce qui préoccupe aujourd’hui nombre de décideurs politiques, c’est le défaut de souveraineté économique constaté sur quelques productions jugées essentielles. C’est dans cette acception plus étroite du sujet que nous poserons les termes du débat. Ce défaut de souveraineté conduit aujourd’hui les pouvoirs publics à prôner la relocalisation des entreprises qui ont quitté le territoire mais aussi le rattrapage technologique, au travers de la construction d’avantages comparatifs dans certaines productions.
Une politique de relocalisation ?
La relocalisation est souvent perçue par l’opinion publique et présentée par les décideurs politiques comme un vecteur important d’indépendance économique, permettant de disposer à nouveau sur le territoire de capacités de production d’entreprises qui l’avaient quitté.
En réalité, le fait de disposer d’unités de production sur son territoire ne rend pas nécessairement plus souverain. La territorialisation de la production est une condition nécessaire mais non suffisante de la souveraineté. En effet, contrairement à l’intuition première, ce n’est pas parce qu’une entreprise produit sur le territoire qu’elle servira forcément la demande locale en priorité et dans sa totalité. En économie de marché, une entreprise est, par principe, libre de choisir ses clients. Elle peut, par exemple, faire le choix d’exporter la totalité de sa production fabriquée sur son territoire. À cet égard, le pouvoir d’achat des clients jouera un rôle central : si le prix que sont prêts à payer les clients étrangers est bien supérieur à celui des clients en France, l’entreprise sera naturellement portée à exporter.
En réalité, du point de vue de la souveraineté économique, ce qu’autorise la territorialisation, et donc la relocalisation, c’est la possibilité pour l’État de procéder à la réquisition de la production en situation d’urgence et de forte demande domestique. Ce privilège de la souveraineté peut être également perçu comme une menace par les entreprises, qui peut devenir rédhibitoire si elle est permanente ou utilisée sans garde-fou. Face à cette menace radicale, privilège de l’État souverain, les entreprises ne manqueront pas de négocier des conditions et des règles avant de choisir de relocaliser ou de s’implanter enFrance.
De la délocalisation à la relocalisation
Pour bien comprendre en quoi consiste une relocalisation, on peut partir de son symétrique, la délocalisation. Ce terme désigne le fait qu’une entreprise produisant en France transfère la totalité ou une partie de sa production dans un pays étranger afin de réduire les coûts de production. Il s’agit donc d’une logique de substitution de localisation. Délocaliser, au sens strict, signifie que l’entreprise continue à « faire elle-même » mais dans une localisation différente ; au sens large, délocaliser peut également signifier que l’entreprise « fait faire », c’est-à-dire externalise à l’étranger sa production ou une étape de la chaîne de valeur, par exemple en recourant à de la sous-traitance internationale.
La délocalisation peut ne porter que sur le maillon de la chaîne de valeur qui est intense en travail non qualifié, le reste étant produit dans le pays d’origine. L’entreprise procède alors à une division internationale des tâches, qui suit le principe de la smiling curve (« courbe du sourire ») : les étapes les plus créatrices de valeur, situées en amont et en aval dans le processus de production (en amont, dans la R&D et la conception/design du produit ; en aval, dans le marketing, la publicité et les services après-vente), restent localisées dans le pays domestique. Il s’agit principalement d’activités de services. À l’inverse, les fonctions d’assemblage, assez peu créatrices de valeur, sont confiées à des pays à bas coût (voir graphique ci-dessous). L’ouverture des frontières et l’essor des technologies de l’information ont d’ailleurs favorisé depuis les années 2000 l’« approfondissement » de la smiling curve, en permettant de délocaliser les tâches peu intenses en valeur ajoutée et en travail qualifié dans les pays émergents. Ainsi, à titre d’exemple, dans la pharmacie, les pays riches ont délocalisé la production des substances actives et ont gardé la recherche sur les vaccins.
La courbe du sourire
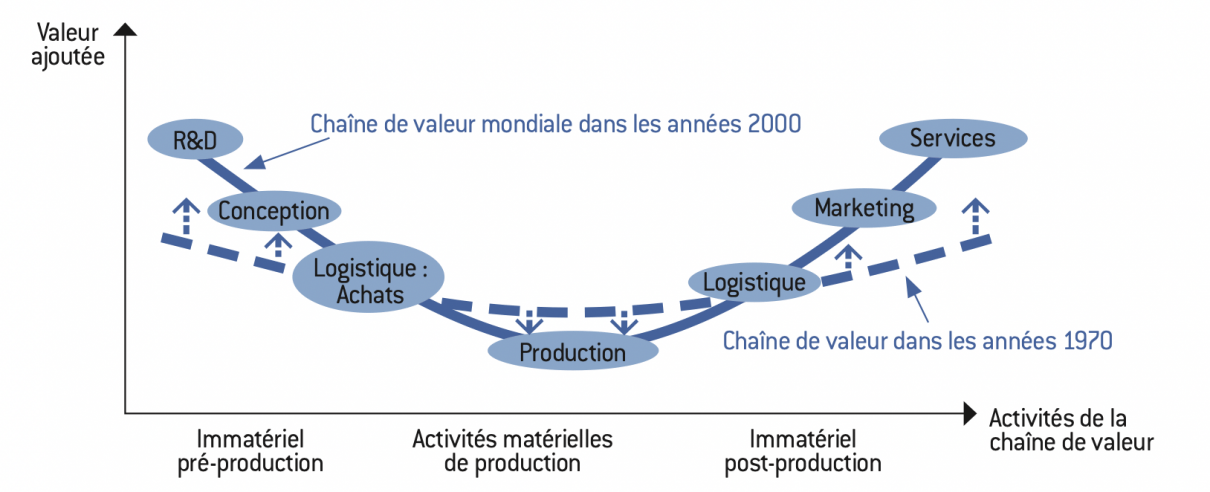
Source :
OCDE, « Economies interconnectées : comment tirer parti des chaines de valeur mondiale ». 2014.
Sans nier l’existence d’un potentiel de relocalisation, nous montrerons qu’il ne faut pas en surestimer l’ampleur. Plutôt que de mener une politique globale et indifférenciée d’incitation à la relocalisation, qui n’a jamais fait jusqu’ici la preuve de son efficacité, nous préconisons une politique très ciblée de retour sur le territoire de quelques produits jugés essentiels. Nous énonçons alors les conditions de sélection de ces produits et les conditions d’efficacité d’une politique de relocalisation.
| Idée 10 : Quelle que soit l’ampleur de la politique menée, il est illusoire d’espérer un mouvement massif de relocalisations, dans la mesure où les entreprises françaises ont peu délocalisé. |
Voir Lionel Fontagné et Aurélien D’Isanto, « Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d’abord vers l’Union européenne », Insee Première, n° 1451, juin 2013. Un constat assez similaire peut être fait au niveau des PME françaises : au cours de la période 2014-2016, moins de 2% des PME implantées en France ont délocalisé des activités et 2,6% l’ont envisagé sans le faire. Il s’agit surtout d’entreprises exportatrices ou de multinationales qui délocalisent via leurs filiales. Les délocalisations se font pour l’essentiel vers l’Union européenne (63% des cas).
Ibid.
Ces conclusions rejoignent d’autres, plus anciennes, sur la période 1995-2001, marquée par l’essor de la Chine : les pertes d’emplois dans l’industrie manufacturière dues aux délocalisations étaient estimées à l’époque des faits entre 9.000 et 20.000 par an (voir Patrick Aubert et Patrick Sillard, « Délocalisations et réductions d’effectifs dans l’industrie française », document de travail G 2005/03, Insee, Direction des études et synthèses économiques, avril 2005).
En 2013, il y aurait eu 68.458 destructions d’emplois (voir France Industrie & Emploi [FIE]- Kurt Salmon RH Management, « Créations et destructions d’emplois en France en Attractivité des territoires », mai 2014, p. 23).
Contrairement à une idée reçue, les délocalisations représentent une part assez modeste des investissements français à l’étranger. Environ 4% des entreprises implantées en France auraient procédé à des délocalisations 23. Certes, dans l’industrie manufacturière et les services de l’information et de la communication, les chiffres peuvent atteindre jusqu’à 9%, mais le phénomène reste assez limité. La France se retrouve d’ailleurs loin derrière d’autres pays européens comme le Danemark ou la Finlande en matière de délocalisations.
Ce constat se retrouve assez logiquement dans les statistiques sur les causes des destructions d’emplois dans l’industrie 24 : les délocalisations auraient détruit de l’ordre de 20.000 emplois entre 2009 et 2011, soit 7.000 emplois par an 25. Cela équivaut à un peu plus de 10% des destructions totales d’emplois dans l’industrie française, si l’on prend 2013 comme année de référence 26. Si les délocalisations restent un phénomène limité en France, que ce soit en nombre ou en emplois détruits, il reste à expliquer pourquoi l’opinion publique considère qu’il s’agit d’un phénomène massif. Deux éléments de réponse peuvent être avancés :
- les délocalisations prennent souvent la forme de la fermeture d’une usine dans un lieu précis : une partie de la main-d’œuvre se retrouve en situation de chômage, dans un bassin d’emploi où il n’y a pas toujours d’alternatives. L’effet médiatique d’un tel événement est alors fort. On a tous présent à l’esprit la délocalisation de l’usine Whirlpool, après celle de Goodyear, située à Amiens et qui est partie en Pologne ;
- la délocalisation est parfois confondue avec une autre opération, la multinationalisation, qui consiste pour une entreprise française à s’étendre à l’étranger, en ouvrant une filiale, sans pour autant fermer celle en L’essentiel des investissements français à l’étranger relève d’une logique d’implantation à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés.
Dans la mesure où les délocalisations d’entreprises françaises sont assez limitées, il est illusoire d’espérer, même avec une politique volontariste, un mouvement massif de relocalisation sur le territoire.
| Idée 11 : Même sans mener une politique active, il y aura un mouvement « naturel » mais limité de relocalisation. |
Frédéric Gonand, Relocalisations : laisser les entreprises décider et protéger leur actionnariat, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2020.
Insee, Les Entreprises en France, édition 2019, 132 (téléchargeable).
La délocalisation d’une entreprise n’est pas un phénomène univoque et définitif. Une entreprise peut délocaliser sa production à un moment donné puis la relocaliser par la suite. C’est par exemple ce qu’a fait le fabricant de skis Rossignol qui, après avoir délocalisé sa production à Taïwan en 2007, l’a rapatrié à Sallanches, en Haute-Savoie, son berceau historique, en 2010.
La relocalisation est d’autant plus aisée qu’elle porte sur un maillon terminal de la chaîne globale de valeur (l’assemblage final, par exemple) : l’entreprise peut reprendre la main sur cette étape du processus de production en la rapatriant dans le pays domestique, sans désorganiser l’ensemble de la chaîne de valeur en amont. De même, lorsqu’une entreprise a délocalisé en confiant la production à un sous-traitant, elle peut reprendre plus facilement en interne ce qu’elle a externalisé.
Pour comprendre pourquoi une entreprise décide de relocaliser, il faut d’abord s’interroger sur les causes principales d’une délocalisation.
Les délocalisations sont principalement motivées par la recherche d’une baisse des coûts de production, notamment du coût salarial dans les industries intenses en main-d’œuvre peu qualifiée 27. Une enquête montre ainsi que, pour les PME françaises, dans 72% des cas, le motif de la délocalisation est la diminution des coûts de main d’œuvre 28.
Mais la baisse des coûts de production résultant d’une délocalisation n’est pas toujours au rendez-vous. La délocalisation peut entraîner elle-même des « coûts cachés », qui peuvent compenser la baisse des coûts salariaux. Ces coûts cachés peuvent être de différentes sortes :
- des difficultés à « manager » une filiale à distance ;
- la mauvaise ou l’inégale qualité des produits, et il s’agirait même là du premier facteur qui pousse à la relocalisation (voir graphique ci-dessous) ;
- la qualification insuffisante de la main-d’œuvre, qui vient amoindrir l’avantage de coût salarial dans la mesure où la productivité horaire est plus faible que dans le pays domestique ;
- le manque de réactivité à la demande des filiales ou des sous-traitants, compte tenu de l’éloignement géographique ;
- la multiplication des risques liés à l’approfondissement des chaînes de valeur : plus la chaîne de valeur est fragmentée, plus elle est vulnérable à un choc sur un maillon ;
- les barrières juridiques ou administratives dans le pays d’accueil, ainsi que l’instabilité politique et économique qui peut y régner ;
- le risque de non-respect de la propriété intellectuelle et de pillage des technologies par des concurrents.
Principaux motifs de relocalisation, en % (2010 jusqu’à mi-2012)Source : Bernhard Dachs et Christoph Zanker, « Backshoring of Production Activities in European Manufacturing », Bulletin European Manufacturing Survey, n° 3, décembre 2014, p. 7.
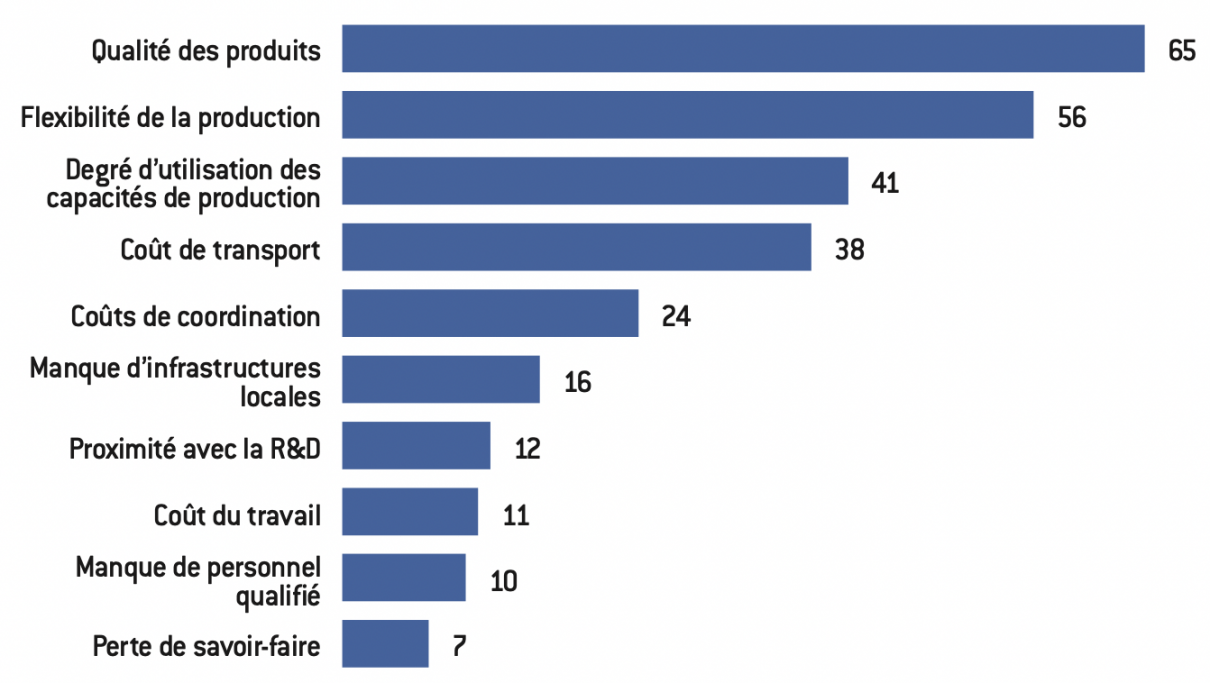
Source :
Bernhard Dachs et Christoph Zanker, « Backshoring of Production Activities in European Manufacturing », Bulletin European Manufacturing Survey, n° 3, décembre 2014, p. 7.
Note : les données prises en compte sont celles de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse et de la Slovénie.
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), Relocalisations d’activités industrielles en France : revue de la littérature, Paris, décembre 2013.
Voir Astrid Krenz, Klaus Prettner et Holger Strulik, « Robots, Reshoring, and the Lot of Low-Skilled Workers », CEGE Discussion Papers, n° 351, juillet 2018, p. 3. Voir aussi Koen De Backer, Carlo Menon, Isabelle Desnoyers-James et Laurent Moussiegt, « Reshoring: myth or reality? », OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, n° 27, 2016. On peut noter à cet égard que la relocalisation va plutôt conduire à créer dans le pays domestique des emplois qualifiés, qui sont complémentaires du robot. L’ étude de Krenz et al. montre aussi que les relocalisations sont associées à une hausse de l’emploi et des salaires pour les travailleurs qualifiés.
On notera toutefois que l’entreprise peut faire le choix également de ne pas relocaliser dans le pays domestique mais de relocaliser son usine à proximité du pays domestique (nearshoring). Ainsi, par exemple, dans le cas de l’automobile, les constructeurs américains de pièces détachées ont déplacé les usines de la Chine vers le Mexique.
Reshoring Initiative 2020 Data Report, reshorenow.org
U.S. Bureau of Labor Statistics, « Employment by major industry sector », Employment Projections, septembre 2020.
Une autre raison tient au fait que le paramètre du coût salarial peut devenir moins important au cours du temps si l’entreprise peut automatiser, robotiser, recourir au numérique ou à l’impression en 3D. À titre d’exemple, la part des coûts salariaux dans le coût d’assemblage des puces électroniques est passée de 30 à 40% dans les années 1970 à moins de 4% dans les années 1980 grâce à la robotisation 29. De même, dans les secteurs à « matières solides », comme la mécanique, l’automobile ou l’électronique, il n’y a plus de véritable obstacle technique à la robotisation. En revanche, dans des secteurs tels que l’habillement ou la chaussure, lorsque les matières manipulées sont souples, le travail occupe encore près des deux tiers du coût total dans l’assemblage. Aux États-Unis une augmentation du nombre de robots de 1 pour 1.000 travailleurs est associée à une hausse de 3,5% des relocalisations 30.
Par ailleurs, le coût salarial d’un pays émergent ou en développement peut dériver au fil du temps, rendant la délocalisation moins pertinente. À titre d’exemple, les salaires réels ont quasiment doublé en Asie au cours de la période 2001-2011 (contre une hausse de 5% dans les pays développés).
Une dernière raison tient au comportement des consommateurs dans les pays riches. Ils exigent une plus grande réactivité des entreprises, que ce soit en termes de délais de fabrication, de livraison ou de capacité à renouveler très vite les produits. Ainsi, dans l’habillement, certaines séries de vêtements connaissent des durées de vie de l’ordre de trois à quatre semaines seulement, alors qu’il faut au moins un mois pour qu’un conteneur soit acheminé depuis la Chine vers l’Europe.
Face à toutes ces conditions, une entreprise va devoir arbitrer entre une baisse des coûts de production mais une localisation éloignée (au Vietnam pour des vêtements, par exemple) et des coûts de production plus élevés sur son territoire mais une réactivité plus grande par rapport à la demande locale. Si le critère de la réactivité devient prépondérant, l’entreprise peut avoir intérêt à relocaliser, en dépit de la hausse des coûts de production que cela engendre (et donc de la hausse du prix de vente), surtout si elle est positionnée sur une compétitivité hors-prix 31.
D’autre part, les consommateurs développent aujourd’hui un discours en faveur du « consommer local », du « développement durable » et du « made in », tout particulièrement dans l’agroalimentaire, qui peut inciter les entreprises à relocaliser pour accompagner cette attente des clients et à communiquer sur les critères de responsabilité ESG (environnement, social et gouvernance). Toutefois, au-delà du discours, il reste à prendre la mesure empirique de cette attente dès lors qu’elle se traduit par des hausses du prix de vente.
Ces différents facteurs peuvent donc conduire des entreprises à relocaliser leur production, sans même que soit menée une politique publique. Ce phénomène, s’il est réel, reste toutefois assez limité sur un plan empirique, si l’on en croit les (rares) études statistiques disponibles qui portent sur les emplois créés par des relocalisations ou sur le nombre de projets de relocalisation.
Ainsi, dans le cas des États-Unis, la Reshoring Initiative estime que les relocalisations d’entreprises sur le sol américain auraient permis de créer 400.000 emplois au cours de la période 2010-201932. Ce chiffre doit être toutefois considéré avec prudence dans la mesure où il porte sur des annonces de création d’emplois et non sur les emplois effectivement créés à la suite d’une relocalisation. Même en prenant ce chiffre pour argent comptant, il reste somme toute assez modeste à l’échelle des États-Unis : le nombre total d’emplois s’élevait en 2019 à 162,7 millions sur le sol américain (selon le Bureau of Labor Statistics), ce qui fait que les emplois relocalisés représenteraient 0,25% de l’emploi total. Si l’on raisonne sur le seul secteur manufacturier, particulièrement affecté par les délocalisations, il employait en 2019 12,8 millions de travailleurs ; la part des emplois relocalisés représenterait donc 3,1% de l’emploi total dans l’industrie manufacturière 33.
Au niveau européen, l’European Reshoring Monitor, soutenu par l’Union européenne, fait état de 253 cas de relocalisation entre 2014 et 2018, dont un tiers de filiales implantées en Chine. Ces relocalisations ont pris la forme d’un retour dans le pays d’origine (backshoring) mais aussi d’un retour au sein de l’Union européenne, sans impliquer pour autant une relocalisation dans le pays d’origine (nearshoring). S’il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces données, on peut toutefois relever que les proportions restent assez modestes en valeur absolue, se chiffrant dans le meilleur des cas à quelques dizaines de projets de relocalisation sur une période de 5 ans.
Nombre de cas de relocalisation des entreprises européennes par pays (2014-2018)
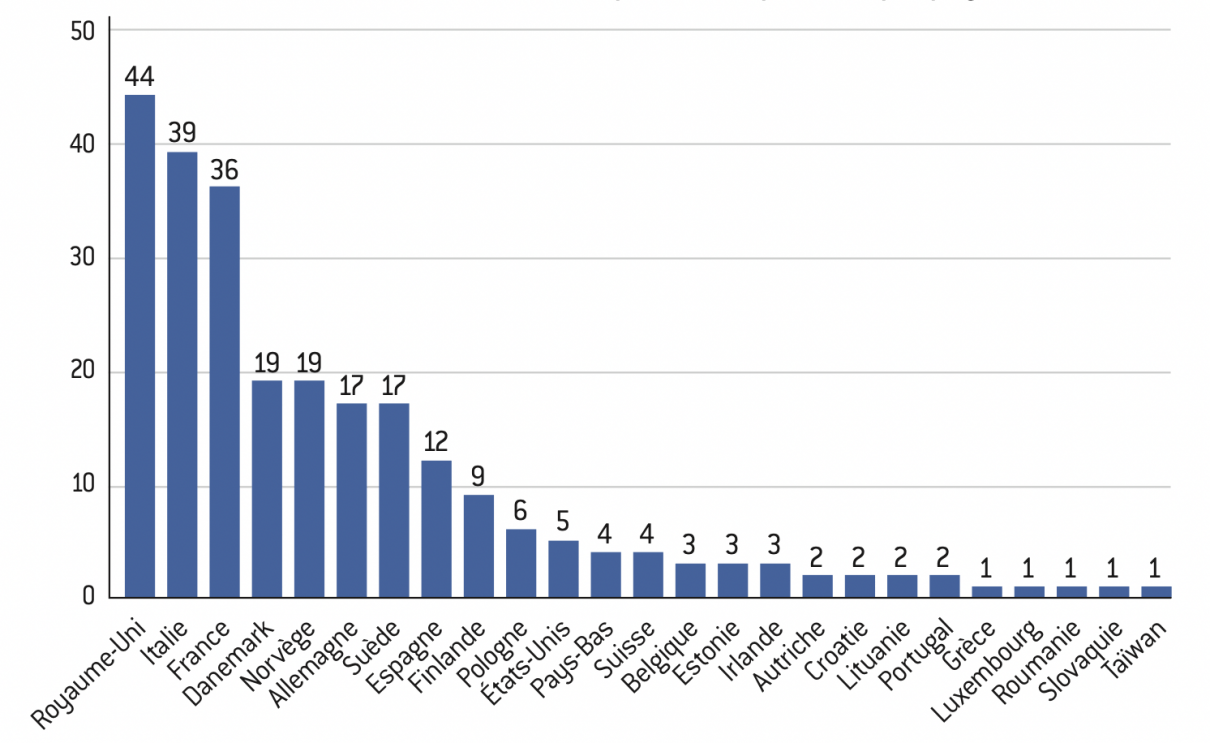
Source :
Eurofound, « The future of manufacturing in Europe », Office of the European Union , 2019.
Florian Lécrivain et Noémie Morénillas, « Les PME de 50 salariés ou plus qui délocalisent : principalement vers l’UE et via leurs filiales », Insee Première, n° 1760, juin 2019, p.1.
Une étude de Lécrivain et Morénillas indique que 0,9% des PME françaises de 50 salariés ou plus ont relocalisé en France des activités réalisées à l’étranger, tandis que 1,9% d’entre elles disent avoir délocalisé leur production entre 2014 et 2016 34 (voir graphique ci-dessous). Le mouvement de relocalisation des PME françaises serait donc réel mais inférieur à la part des entreprises qui délocalisent.
Proportion de PME françaises ayant délocalisé et relocalisé (2014-2016)
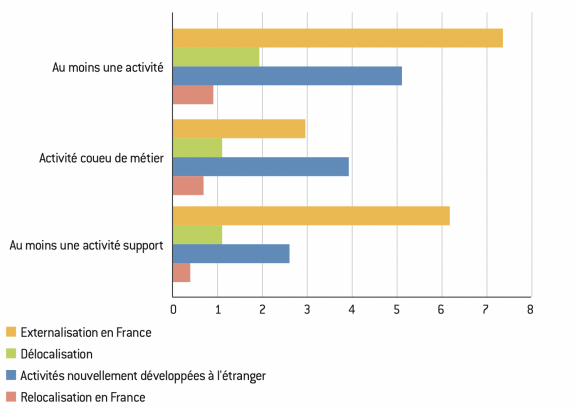
Source : Florian Lécrivain et Noémie Morénillas, « Les PME de 50 salariés ou plus qui délocalisent : principalement vers l’UE et via leurs filiales », Insee Première, n° 1760, juin 2019, p. 1.
Périmètre des PME : PME marchandes non agricoles et non financières de 50 salariés ou plus implantées en France.
| Lecture : 1,9% des PME de 50 salariés ou plus ont délocalisé au moins une de leurs activités entre 2014 et 2016, une entreprise pouvant délocaliser à la fois son activité cœur de métier et une ou plusieurs de ses activités support. |
Même en l’absence d’une politique volontariste de relocalisation, il y aura toujours un flux naturel de relocalisations, dont l’ampleur reste toutefois très limitée et inférieure au flux de délocalisations.
Les conditions d’une politique de relocalisation réussie
| Idée 12 : Si les pouvoirs publics veulent mener une politique de relocalisation et d’attractivité du territoire, le levier le plus efficace se trouve du côté des réformes structurelles, mais ce levier est peu visible et difficile à mettre en œuvre. |
Voir Emmanuel Combe, Résister à la tentation protectionniste, Altermind Institute, juin 2018.
Josh Zumbrun et Anthony DeBarros, « U.S. Grants Apple 10 Exemptions from Tariffs on Chinese Imports », The Wall Street Journal, 20 septembre 2019.
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), « Relocalisations d’activités industrielles en Synthèse », décembre 2013, p. 105.
« Les relocalisations : une démarche multiforme qui ne se réduit pas à la question du coût de la main- d’œuvre », Le 4 pages de laDGCIS, no 30, mars 2014, p. III.
Ibid.
Josh Zumbrun et Anthony DeBarros, art. cit.
Au-delà du flux naturel de relocalisations que nous venons d’identifier, les pouvoirs publics peuvent vouloir accélérer le processus, en mobilisant différentes politiques.
Une première politique consiste à pratiquer une forme de « relocalisation forcée », en imposant des droits de douane prohibitifs sur les importations en provenance de pays dans lesquels les entreprises ont délocalisé leurs usines d’assemblage. Cette politique est celle que Donald Trump avait proposée durant sa campagne présidentielle de 2016, à l’encontre de la Chine. L’idée n’était pas seulement de taxer les produits chinois mais aussi les entreprises américaines assemblant leurs produits en Chine, notamment Apple. Le président américain sortant a d’ailleurs réitéré cette menace de taxation des importations en mai 2020, mais cette fois-ci à l’encontre des produits importés d’Inde après qu’Apple ait annoncé son intention de délocaliser vers l’Inde une partie de sa production de d’iPhone réalisée en Chine.
Cette option très dirigiste semble toutefois hautement improbable en France sur un plan pratique, dans la mesure où la politique douanière relève des prérogatives de l’Union européenne. De plus, une telle politique risque de manquer son objectif. Les entreprises implantées dans un pays émergent ne vont pas nécessairement revenir sur le marché domestique ; elles vont plutôt s’implanter dans un autre pays émergent, non soumis aux taxes à l’importation. Il s’agit d’une politique assez classique de contournement du protectionisme 35. Enfin, comme toute politique protectionniste, cette politique va se traduire par des hausses de prix sur le marché domestique, les entreprises reportant la taxe sur les consommateurs. Une telle politique risque d’être très mal perçue par l’opinion publique.
On remarquera d’ailleurs qu’outre-Atlantique la politique de taxation annoncée n’a finalement pas été appliquée aux entreprises américaines. Si Donald Trump a bien mis en place des droits de douane sur les importations chinoises, la taxe de 15% prévue sur les iPhone assemblés en Chine n’a pas été imposée. Les producteurs américains ont mené un intense travail de lobbying dans le but d’obtenir des exemptions sur la liste des produits chinois taxés 36.
Une deuxième politique publique consiste à utiliser des incitations fiscales non ciblées pour faire revenir les entreprises sur le territoire français. Une telle politique a déjà été mobilisée en France au moins à trois reprises :
- en 2005, avec le crédit impôt relocalisation « Breton » (en référence à Thierry Breton) ;
- en 2010, dans le cadre des États généraux de l’industrie, avec une prime à la relocalisation d’un montant total de 200 millions d’euros ;
- en 2013, avec Arnaud Montebourg qui avait lancé le logiciel Colbert 2.0 permettant aux entreprises de faire un diagnostic sur les gains et les coûts d’une relocalisation en France, et d’être accompagnées dans un « parcours de relocalisation », avec un interlocuteur désigné par l’État, les fameux « commissaires au redressement productif ».
Rétrospectivement, le bilan semble assez maigre. Selon la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), au cours de la période 2005-2013, seuls 100 cas de relocalisation avaient été officiellement recensés en France, souvent sous la forme d’opérations de petite taille, ce qui a limité leur impact sur l’économie nationale et les territoires concernés 37. Paradoxalement, nombre d’entre elles n’ont pas bénéficié d’aides publiques, alors que celles-ci étaient pourtant disponibles, ce qui témoigne du faible intérêt porté par les entreprises éligibles aux dispositifs gouvernementaux visant à encourager les relocalisations. La DGCIS explique que ce mouvement de relocalisation s’est révélé « trop limité pour avoir des conséquences fortes sur l’emploi 38 ». Les trente cas de relocalisation qu’elle a étudiés en 2013 totalisaient seulement 800 nouveaux emplois 39.
Dans le cas particulier de la politique mise en œuvre par Arnaud Montebourg, le bilan est aussi limité. En l’absence d’évaluation, les rares informations mentionnent deux usines revenues de Chine (une usine de Vélosolex à Saint-Lô en Normandie et une fonderie à Dreux, qui a fait faillite six mois plus tard). Dans le cas de l’usine Vélosolex, 38 salariés ont été embauchés à la suite d’un prêt de la région de 4 millions d’euros. Au total, entre 2010 et 2015, on estime que 2.000 emplois auraient été rapatriés 40.
Au vu de ces expériences concrètes, on peut légitimement douter de l’efficacité d’une politique de subvention non ciblée à la relocalisation. En effet, comme nous l’avons vu, la motivation profonde d’une relocalisation est souvent liée à un facteur structurel et jugé pérenne, tel qu’un processus d’automatisation ou une importance accrue de la réactivité à la demande. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, une politique d’aides publiques (par exemple subventions ou crédit d’impôt) aura peu d’effet, sauf si elle parvient à combler le différentiel de coût de production avec un pays à bas salaire. C’est loin d’être évident dans des activités d’assemblage, qui mobilisent beaucoup de travail peu qualifié, lequel reste bon marché dans les pays émergents.
Réciproquement, si les facteurs structurels à la relocalisation sont réunis, la politique d’aides aura simplement un effet d’aubaine. Elle peut même encourager les comportements de « chasseurs de primes », en particulier dans les productions qui sont facilement mobiles. Une entreprise reviendra le temps de l’exonération fiscale mais quittera le territoire une fois cette exonération terminée.
Une troisième politique publique consiste à agir en amont sur l’environnement domestique dans lequel évoluent les entreprises, dans le but d’améliorer la compétitivité par les coûts. La politique de relocalisation ressemble alors fortement à une politique d’attractivité du territoire, dans la droite lignée des recommandations de réformes structurelles internationales d’organisation telles que préconisées par l’OCDE ou le World Economic Forum. On ne reviendra pas ici sur les réformes proposées : baisse des impôts de production, stabilité réglementaire et fiscale, baisse du coût du travail peu qualifié, élévation des qualifications, etc.
Ces politiques d’attractivité sont cependant à la fois difficiles et longues à mettre en œuvre, compte tenu de leur faible acceptabilité politique. Qui plus est, elles ne sont pas « visibles », dans la mesure où leurs effets ne se font sentir que progressivement, le temps que les entreprises réagissent et s’ajustent aux nouvelles incitations. Autant dire que ces politiques structurelles ne peuvent répondre à l’urgence de la demande politique en matière de relocalisation.
Enfin, les politiques d’aides publiques non ciblées de relocalisation n’ont pas donné jusqu’ici des résultats très concluants. En revanche, des politiques d’attractivité du territoire sont efficaces mais leurs résultats sont longs et diffus, ce qui ne répond pas à l’attente politique du moment.
| Idée 13 : Une politique d’aide ciblée à la relocalisation est préférable. Elle consiste pour les pouvoirs publics à identifier des biens et services essentiels, pour lesquels le stockage et la diversification des approvisionnements ne constituent pas des solutions suffisantes ou possibles. |
Gouvernement français, « Relocaliser », 19 novembre 2020.
Plutôt qu’une politique d’aide globale incitant à la relocalisation, dont nous avons montré qu’elle n’avait pas fait jusqu’ici ses preuves, une politique ciblée sur quelques produits (biens ou services) jugés stratégiques ou essentiels doit être préférée, dans la lignée de la décision prise par le gouvernement français en mai 2020, à l’occasion de la crise du Covid-19. En effet, dans le cadre du plan « France Relance », une enveloppe de 720 millions d’euros sera consacrée à la relocalisation de « maillons manquants des chaînes de production stratégiques » 41 et au renforcement de capacités de production nationales. Il s’agit en particulier de conforter notre « résilience sanitaire » et de soutenir des investissements dans cinq secteurs stratégiques (la santé, l’agro-alimentaire, l’électronique, les intrants essentiels et la 5G). Les premières annonces, faites en novembre 2020, font état de 31 projets retenus, pour une enveloppe de subventions publiques de 140 millions d’euros ; ces 31 projets devraient permettre la création de 1.800 emplois directs.
Pour être couronnée de succès, cette politique ciblée doit suivre un processus rigoureux, organisé en plusieurs étapes (voir graphique « Processus de décision de relocalisation d’un bien essentiel », plus bas). Dans une première étape, le décideur politique, au terme d’un débat transparent, doit établir une liste de quelques produits qu’il considère comme essentiels ou stratégiques, et qui ont pu être délocalisés par des entreprises présentes auparavant sur le sol français. Dans une deuxième étape, la part des importations dans la demande totale de ce bien essentiel doit être estimée : si elle est limitée (inférieure à 20%), il est toujours possible, plutôt que de relocaliser, de subventionner les opérateurs présents sur le territoire national pour qu’ils augmentent leurs capacités de production, quitte à ne les solliciter qu’en cas de crise.
Dans une troisième étape, la plus importante, il faut apprécier le degré de dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. La dépendance ne se base pas seulement sur le fait qu’un bien soit massivement importé, car importer ne rend pas dépendant s’il existe de multiples choix et que les fournisseurs n’ont pas pléthore de clients. La dépendance se définit comme le fait que l’acheteur (ici la France) est à la merci d’un seul pays fournisseur (ou d’une seule entreprise) et qu’il ne puisse pas en changer rapidement, alors même que le fournisseur ne dépend pas exclusivement ou majoritairement de l’acheteur. Elle se mesure par la conjugaison de plusieurs critères cumulatifs :
- la forte concentration des fournisseurs à l’achat (on peut, par exemple, utiliser des indicateurs simples, tels que la part de marché des quatre premiers pays fournisseurs) ;
- la faible dépendance du fournisseur au client car disposant d’un large portefeuille de clients (il n’est donc pas dépendant des achats français) ;
- l’absence de sources d’approvisionnement alternatives (si elles sont nombreuses et qu’il n’y a pas de coût de transfert, l’acheteur n’est pas réellement dépendant du dit-fournisseur) ;
- l’importance des coûts de changement de fournisseur (s’ils sont élevés, l’acheteur est alors fortement dépendant du fournisseur habituel, en dépit de l’existence de fournisseurs alternatifs). Ces coûts se mesurent notamment en délais pour changer de fournisseur, par exemple en cas de rupture dans la chaîne d’approvisionnement.
Si les fournisseurs sont nombreux et localisés dans des pays différents, il peut être alors préférable de mener une politique de diversification géographique des pays et des entreprises-fournisseurs plutôt que de vouloir à tout prix relocaliser. En effet, l’avantage de diversifier ses approvisionnements est de réduire le risque géographique qui existe si tout est produit sur un seul territoire : en cas de choc en France, le fait de tout produire chez soi peut devenir un handicap. A contrario, une politique de diversification ne permet pas, en cas de crise, de procéder à la réquisition des unités de production puisqu’elles ne sont pas situées sur le territoire national.
Si le nombre de fournisseurs est faible, la constitution de stocks stratégiques peut être préférable à une relocalisation, dans la mesure où elle permet de bénéficier de l’avantage de coût (qui résulte souvent d’économies d’échelle) dont bénéficient de grands producteurs étrangers. Toutefois, la politique de stockage présente le risque d’un mauvais calibrage : comme il est difficile de prévoir ex ante le niveau de la demande, le niveau des stocks risque d’être soit insuffisant soit surdimensionné par rapport au besoin.
Ce n’est finalement que si la diversification des approvisionnements ou le stockage ne sont pas des solutions possibles ou suffisantes qu’il faut envisager en dernier recours une relocalisation de la production sur le territoire du bien essentiel.
Processus de décision de relocalisation d’un bien essentiel
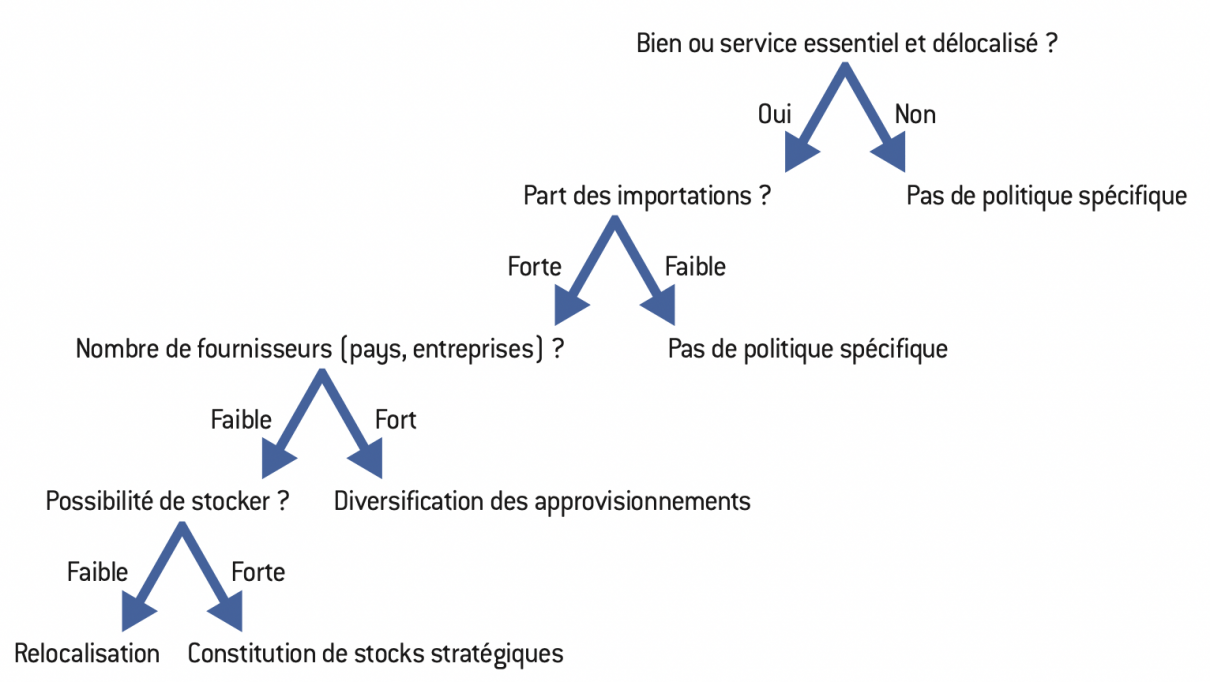
Source :
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2021.
Christophe Bonneau et Mounira Nakaa, « Vulnérabilité des approvisionnements français et européens », Trésor Eco n°274, 17 décembre 2020.
Nous avons supposé jusqu’ici que la réflexion sur les biens essentiels se cantonnait à ceux qui avaient été délocalisés. L’enjeu est alors de les faire revenir sur le territoire français. Le débat peut être toutefois élargi : un bien peut être considéré par les pouvoirs publics comme essentiel sans pour autant qu’il ait fait l’objet d’une délocalisation au préalable. Dans ce cas, la politique à mener ne peut pas être une politique de relocalisation par définition, il s’agit plutôt de construire une base productive sur le territoire en opérant un « rattrapage ». Cette politique peut nécessiter de faire appel, pour des raisons de compétences, à des investisseurs étrangers. On aboutit alors à une situation pour le moins paradoxale : la souveraineté économique sur des biens essentiels conduit à renforcer l’insertion du pays dans la globalisation, au travers d’investissements directs entrants.
Une approche alternative consiste à ne pas définir à priori une liste de produits considérés comme essentiels ou stratégiques mais à la déduire d’une grille d’analyse rigoureuse. Telle est l’approche retenue par la Direction Générale du Trésor dans une étude récente 42.
Pour identifier les biens « vulnérables », les auteurs de l’étude analyse les importations françaises de 4.927 produits en provenance de pays extra-européens, selon deux critères cumulatifs, assez proches de ceux que nous avons identifiés précédemment :
- La concentration des importations de chaque produit sur un nombre réduit de fournisseurs hors UE ;
- L’existence ou non d’alternatives pour se fournir en provenance d’autres pays.
Au terme de leur analyse, les auteurs définissent un périmètre assez étroit des produits qui présentent pour la France une certaine « vulnérabilité » : si 121 produits sur 4.927 se caractérisent par une forte concentration des importations, seuls 12 d’entre eux présentent un faible potentiel de diversification des approvisionnements, soit 0,24% de l’échantillon (voir graphique ci-dessous). Les produits vulnérables ne sont d’ailleurs pas toujours ceux que l’on croit : il s’agit par exemple des lampes LED, la Chine étant le principal fournisseur pour l’ensemble du monde.
Les auteurs se livrent également à une analyse comparative de la « vulnérabilité » de la France par rapport à d’autres pays européens. Il apparaît que la France est moins exposée que des pays comme l’Espagne, l’Italie ou les Pays-Bas.
Classification des importations française selon leur vulnérabilité
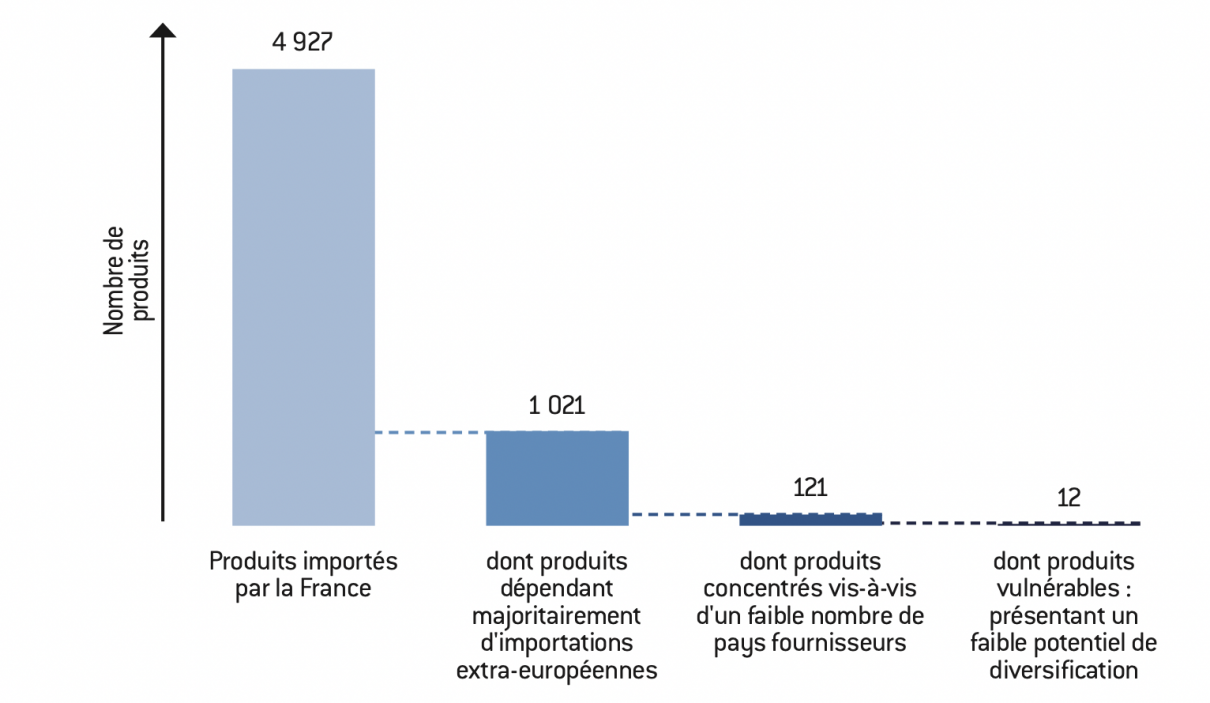
Source :
Christophe Bonneau et Mounira Nakaa, « Vulnérabilité des approvisionnements français et européens », Trésor Eco n°274, 17 décembre 2020.
Une fois que les biens essentiels ont été identifiés, il est nécessaire de mener une réflexion sur le moyen le plus efficace d’en sécuriser la disponibilité, ce qui ne passe pas nécessairement par une relocalisation.
| Idée 14 : Une fois identifiés les produits dont la relocalisation est essentielle, les pouvoirs publics devraient apprécier le coût d’une politique de relocalisation et en informer l’opinion publique. |
Une fois que la relocalisation a été déterminée comme solution souhaitable, les pouvoirs publics vont devoir financer par une subvention le retour des entreprises concernées : la relocalisation a donc un coût direct en termes de finances publiques. Si la subvention ne couvre pas la totalité de la hausse des coûts de production, une partie du surcoût sera alors supportée par les consommateurs, sous la forme d’une hausse du prix.
Le différentiel de coûts de production entre une production délocalisée et une production relocalisée va dépendre de multiples paramètres, notamment :
- de l’intensité de la main-d’œuvre dans le processus de production et des possibilités éventuelles d’automatisation/robotisation : si l’activité est très intense en main-d’œuvre peu qualifiée, le différentiel de coût de production risque d’être important, à moins que l’activité ne puisse être en partie automatisée en France ;
- de la taille de l’unité de production relocalisée et des perspectives de marché : pour exploiter les économies d’échelle, il serait préférable de disposer d’une unité de production qui soit à la taille minimale optimale (celle qui minimise le coût unitaire de production), et si cette taille est supérieure à celle du marché domestique, il est nécessaire de trouver des débouchés à l’exportation ;
- de l’ampleur de la relocalisation par rapport au fractionnement de la chaîne globale de valeur : si un seul maillon de la chaîne de valeur est relocalisé – l’assemblage final par exemple – l’effet sur le coût sera plus limité que si la relocalisation porte sur toute la chaîne de valeur ;
- du positionnement de la relocalisation dans la chaîne de valeur : plus ce positionnement est situé en aval de la chaîne, moins il est problématique, dans la mesure où il ne remet pas en cause l’organisation amont ;
- de la complexité de la chaîne globale de valeur : si la chaîne est très longue, le risque est qu’une relocalisation implique que l’entreprise doive déconstruire la totalité de sa chaîne de valeur, établie à l’échelle mondiale (voir encadré plus bas) ;
- de la récurrence ou non de la demande domestique pour le produit : si la demande est temporaire (à l’image des masques), la relocalisation risque d’être très coûteuse, sauf si l’entreprise parvient à trouver des débouchés alternatifs ou à l’exportation.
Dans la mesure où l’impact d’une relocalisation sur les finances publiques ou le prix payé par les consommateurs ne sont pas forcément anecdotiques, il nous semble utile que les décideurs politiques organisent la transparence des débats sur ce sujet. Les citoyens doivent avoir conscience que la politique de relocalisation d’un bien essentiel aura un prix. Ce prix peut être important : ainsi, à titre d’exemple, une (hypothétique) relocalisation de la production d’iPhone aux États-Unis pourrait avoir un impact compris entre 5 et 13% sur son prix final (voir encadré plus bas). Dans le cas du paracétamol, les premières déclarations des industriels font état d’une possible hausse de prix du médicament de 10%, sans compter les subventions perçues pour construire les usines.
Une évaluation ex post du coût de la relocalisation devra également être conduite, portant à la fois sur le coût direct en termes de subvention mais aussi sur le coût indirect en termes de hausse des prix pour les consommateurs. Elle est rendue possible par le fait que le ciblage du produit relocalisé est précis. Cette évaluation devrait être confiée à une commission d’experts indépendants, spécialistes de l’évaluation des politiques publiques.
Pour conclure, une relocalisation a de fortes chances d’entraîner une hausse des coûts de production et, possiblement, du prix de vente : les citoyens doivent avoir conscience que c’est le prix à payer pour avoir accès sur le territoire à une production de biens essentiels, auparavant importés.
| Idée 15 : Une fois prise, la décision de relocaliser doit être mise en œuvre suivant un processus d’appel d’offres. |
Une fois prise la décision de relocaliser, nous recommandons aux pouvoirs publics de mettre en œuvre un processus d’appel d’offres. Ce mécanisme permet de comparer les volumes de production projetés, le coût unitaire et le prix de vente envisagés par chaque candidat. La comparaison des offres permettra au décideur public d’avoir une idée, même approximative, de l’ampleur de la subvention à accorder à l’entreprise qui sera choisie pour être relocalisée en France.
À cet égard, on peut s’interroger sur le fait, par exemple, que le gouvernement ait choisi sans appel d’offres les trois entreprises qui vont produire en France le paracétamol (à savoir Sanofi, Upsa et Seqens), au motif qu’elles le distribuent déjà : en l’absence d’information fiable sur les coûts, le risque est que ceux-ci soient surestimés, compte tenu de l’asymétrie d’information entre les décideurs publics et les laboratoires.
Pour que l’appel d’offres soit le plus concurrentiel possible, il doit être ouvert à tous les producteurs européens. L’enjeu est qu’une entreprise européenne localise sa production en France, qu’elle soit française ou non. Pour les entreprises hors Union européenne, il n’y a pas de raison de les exclure a priori, sauf s’il est démontré qu’elles sont détenues ou influencées dans leurs décisions par des États non européens.
Il sera également nécessaire de se coordonner au niveau européen entre pays pour éviter des duplications et permettre, le cas échéant, des économies d’échelle dans la production.
| Le coût de relocalisation de l’iPhone aux États-Unis*
Que se passerait-il, concrètement, si les États-Unis forçaient Apple à rapatrier la production de ses iPhone sur le territoire américain ? L’impact d’une telle décision sur les coûts et le prix de l’iPhone peut être simulé en distinguant deux scénarios principaux de relocalisation. Scénario 1 Scénario 2 * D’après Konstantin Kakaes, « The All-American iPhone », technologyreview.com, 9 juin 2016. ** Ibid. |
Impact de deux scénarios de relocalisation forcée de l’iPhone 6
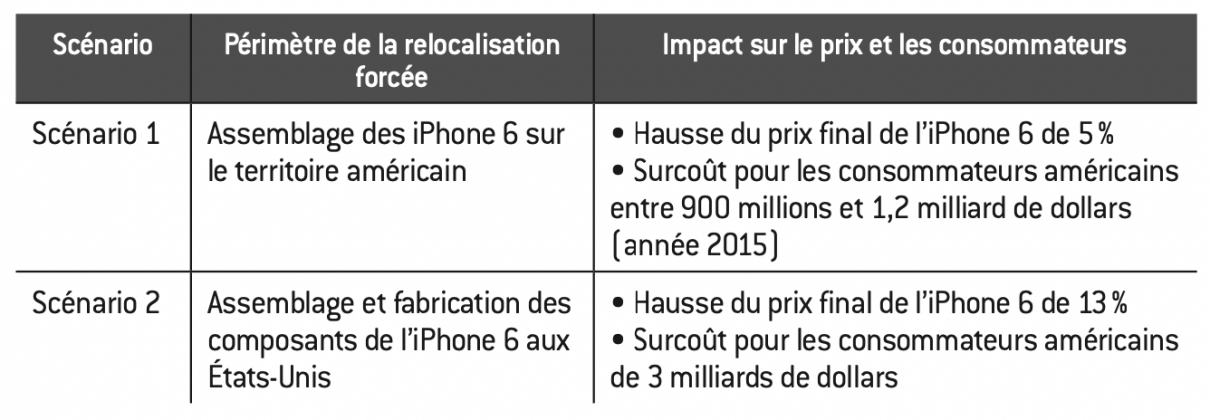
Source :
Fondation pour l’innovation politique, janvier 2021 ; d’après Konstantin Kakaes, « The All-American iPhone », technologyreview.com, 9 juin 2016.
Une politique de rattrapage technologique ?
Voir Cyrielle Gaglio et Sarah Guillou, « L’Europe numérique : entre singularités, faiblesses et promesses », Revue de l’OFCE, n° 158, décembre 2018, p. 14-36.
Une politique de relocalisation permet certes de rapatrier sur le territoire des compétences et des productions parties à l’étranger, mais elle ne résout pas un autre problème majeur : un pays peut ne pas disposer de compétences dans certaines productions, qui ne sont donc pas relocalisables, tout simplement parce qu’elles n’ont jamais existé en France ou ont disparu depuis longtemps. Le pays n’a alors pas d’autre choix que de recourir à des importations (d’entreprises étrangères) pour combler ces compétences manquantes.
Comme nous l’avons vu dans la première partie, le fait d’importer n’est pas en soi problématique et participe même à la compétitivité du pays et à ses performances à l’exportation. Mais, dans certains cas, un pays peut considérer, par exemple pour des raisons de sécurité nationale, qu’il doit disposer dans un secteur donné de sa propre production de biens et services essentiels plutôt que de recourir aux importations d’entreprises étrangères.
À cet égard, de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour exiger que l’Europe dispose d’une véritable base productive dans le numérique et ne soit plus une « colonie numérique » des États-Unis. Force est de constater que l’Europe n’existe pas véritablement en tant que puissance dans l’économie des plateformes numériques, comparativement aux États-Unis et à la Chine. En effet, quel que soit le segment de marché retenu – à l’exception des logiciels de gestion, avec SAP –, les Européens ne disposent pas d’un géant à la mesure de ce que l’on peut trouver dans ces deux pays : que ce soit dans les services de cloud, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche généralistes, l’intelligence artificielle, les plateformes vidéo, le commerce en ligne ou la blockchain, l’Europe ne fait jamais la course en tête 43.
Les fondements théoriques d’une politique de rattrapage
AFP, « Automobile : un marché de la batterie verrouillé par l’Asie », Le Point Automobile, 2 mai 2019.
Commission européenne, « La Commission autorise une aide publique de 3,2 milliards € dans le secteur des batteries », europa.eu, 9 décembre 2019.
Voir Valérie Faudon, Relocaliser en décarbonant grâce à l’énergie nucléaire, Fondation pour l’innovation politique, janvier 2021.
Voir Tim Greene, « Top 500 novembre 2020 : le Fugaku de Fujitsu assoit sa domination », lemondeinformatique.fr, 17 novembre 2020.
Derek Perrotte, « Supercalculateurs : l’Europe met 8 milliards d’euros sur la table », Les Echos, 18 septembre 2020.
Pour combler le retard avec les leaders d’un secteur, les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre une politique dite de « rattrapage », visant à rejoindre la frontière technologique des pays leaders. Dans le passé, cette politique a été menée avec succès en Europe en matière aéronautique : face à l’américain Boeing, l’Europe a décidé de lancer le consortium Airbus à partir des années 1970, dans le but de mettre fin à une situation de quasi-monopole des États-Unis sur les avions gros porteurs. Nous verrons également que cette politique a été menée avecsuccès par le Japon dans les années 1960 dans l’automobile et l’électronique grand public.
Aujourd’hui, une politique similaire est mise en œuvre par sept États européens (dont la France et l’Allemagne), au travers d’un projet nommé « Airbus des batteries électriques », initié en 2019. L’enjeu est de rattraper le retard européen en la matière. Alors que le nombre de véhicules électriques est appelé à croître fortement, plus de 80% des batteries sont actuellement fabriquées en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Ce composant est d’autant plus stratégique qu’il représente entre 30 et 40% de la valeur d’une voiture électrique 44. Le projet consiste, dans un premier temps, à construire une usine pilote – sur le terrain de l’usine Saft, à Nersac, en Charente, pour un montant de 200 millions d’euros – visant à mettre au point une batterie électrique haute performance. Une fois le produit développé, la seconde phase consistera à investir dans plusieurs usines de fabrication à grande échelle, avec l’ambition de produire 1 million de batteries par an à l’horizon 2030, soit 10 à 15% du marché européen. Ce projet a été autorisé en décembre 2019 par la Commission européenne au titre des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC). Son budget total est estimé à 8,2 milliards d’euros, dont 3,2 milliards provenant de fonds publics 45.
À la suite de cette initiative réussie, les pays européens ont décidé en novembre 2020 d’étendre leur coopération à l’hydrogène ; des annonces de politique commune devraient être faites en ce sens par la Commission européenne en 2021. Pour l’heure, seul les gouvernements allemands et français ont adopté des plans d’investissements dans l’hydrogène : 9 milliards d’euros pour l’Allemagne, dans le cadre de son plan de relance ; 7 milliards d’euros d’ici 2030 pour la France 46.
Dans un tout autre domaine, l’Europe entend également combler son retard dans les supercalculateurs, ces machines permettant de réaliser des calculs à haute performance et utilisés notamment dans la recherche médicale ou les simulations numériques. La course technologique est largement dominée jusqu’ici par la Chine, les États-Unis et le Japon. Seul le français Atos, qui a racheté Bull, existe véritablement sur ce marché en Europe. En novembre 2020, l’Europe ne comptait aucun supercalculateur parmi les cinq premiers mondiaux 47. Pour rattraper le retard, la Commission européenne a annoncé, en septembre 2020, qu’elle allait financer 8 milliards d’euros d’investissement dans ce secteur d’activité au cours des six prochaines années 48. Cette initiative vient compléter celle lancée en 2018 par douze pays de l’Union européenne, dont la France et l’Allemagne, à travers une entreprise commune, EuroHPC, dotée de 1 milliard d’euros et chargée de déployer une infrastructure de calcul à haute performance de classe mondiale.
Cette politique de rattrapage s’apparente à une thèse bien connue en économie internationale : la doctrine des « industries naissantes », ébauchée à la fin du XVIIIe siècle par Alexander Hamilton aux États-Unis, puis dans les années 1840 par Friedrich List en Allemagne. Cette thèse repose sur l’idée selon laquelle le protectionnisme ou une politique de soutien public au moyen de subventions permet à un pays de créer un avantage comparatif, qui le rend capable ensuite de s’insérer dans le commerce international. En protégeant ou subventionnant l’industrie domestique, le pays renonce à des importations pourtant meilleur marché au profit d’une production domestique au départ plus coûteuse ; il accepte que le prix payé par les consommateurs soit temporairement plus élevé. Par ailleurs, la protection ou la subvention permet d’accroître la production domestique, donc le surplus des producteurs.
Le protectionnisme éducateur est un bon calcul économique si la hausse du surplus des producteurs fait plus que compenser la perte de surplus des consommateurs. La question est alors de savoir par quel mécanisme une protection temporaire ou une subvention peut avoir un effet bénéfique et durable sur la compétitivité d’une industrie domestique. En effet, le fait de protéger ou de subventionner une industrie n’est pas en tant que telle une condition suffisante pour qu’elle devienne compétitive. L’intervention publique ne se justifie que si elle permet de changer durablement la configuration de l’industrie, en diminuant par exemple le coût unitaire de production domestique.
Deux situations particulières peuvent justifier la mise en place d’un soutien public temporaire à l’industrie :
- la présence d’économies d’apprentissage ;
- la présence d’économies d’échelle externes.
| Idée 16 : Une aide publique (ou une protection) peut se justifier temporairement si elle permet à l’industrie de descendre le long de la courbe d’expérience et de rattraper son retard. |
Une politique de subvention ou de protection temporaire peut se justifier lorsqu’il existe dans une industrie des économies d’apprentissage ou d’expérience. Une économie d’expérience apparaît lorsque le coût unitaire de production diminue avec la quantité cumulée produite (c’est-à-dire la somme des quantités produites au cours du temps) : plus une entreprise produit depuis longtemps, plus elle a acquis de l’expérience dans la manière de produire et d’organiser sa production, ce qui lui permet d’avoir un coût unitaire plus bas. Les économies d’expérience sont importantes dans des secteurs à fort contenu technologique comme l’aéronautique ou les semi-conducteurs.
À l’inverse, une entreprise qui entre dans un secteur après les autres est pénalisée par le fait qu’elle n’a pas encore commencé à produire et n’a donc pas pu accumuler suffisamment d’expérience. Son coût unitaire de production sera donc plus élevé que celui de ses concurrents. Pour remédier à ce désavantage temporel, les pouvoirs publics peuvent subventionner ou protéger l’entreprise domestique, le temps qu’elle descende le long de la courbe d’expérience (learning curve). Une fois qu’elle a atteint un coût unitaire proche de celui des concurrents, l’industrie domestique n’a plus besoin d’être subventionnée pour combler l’écart de coût de production.
| Idée 17 : Outre les économies d’expérience, une politique de rattrapage peut se justifier par la présence d’économies d’échelle externes. L’enjeu est alors d’accroître la taille du marché intérieur en procédant à une plus forte intégration. |
En dehors des économies d’expérience, la présence d’économies d’échelle externes peut justifier la mise en place d’une politique de soutien à l’industrie. Une économie d’échelle externe apparaît lorsque le coût unitaire de production d’une entreprise diminue avec la taille du secteur d’activité (mais pas nécessairement avec la taille de l’entreprise). Ce phénomène provient du fait que l’augmentation de la taille du secteur permet aux entreprises de s’approvisionner à un coût moindre, par exemple en regroupant leurs achats. De même, le fait d’être nombreux dans un secteur (et à proximité les uns des autres) permet de bénéficier d’externalités de connaissances : les entreprises peuvent acquérir des savoirs informels au contact des concurrents (songeons, par exemple, à des méthodes de production plus efficaces). Il est à noter que les économies d’échelle externes sont parfaitement compatibles avec une structure de marché concurrentielle.
| Les économies d’expérience
Le graphique ci-après représente une courbe d’expérience à 90 et à 80%. Si l’on prend le cas de la courbe à 90% (en vert), cela signifie que chaque fois que la production cumulée de l’entreprise double, le coût unitaire diminue de 10%, grâce à l’expérience acquise. Supposons que l’entreprise fabrique une seule unité de produit par période de temps : lorsque l’entreprise est à la deuxième période, elle a donc produit au total deux unités et son coût unitaire aura baissé de 10% par rapport à la première unité. Lorsqu’elle aura produit quatre unités (au bout de quatre périodes), son coût unitaire sera égal à (0,9)^², soit 0,81 du coût de la première unité. Dans le cas d’une courbe à 80% (en bleu), chaque fois que la production cumulée double, le coût unitaire diminue de 20%. Nous pouvons appliquer le principe de la courbe d’expérience à une situation dans laquelle l’industrie domestique se trouve en retard par rapport à ses concurrentes étrangères. Supposons, par exemple, que l’industrie domestique soit présente depuis quatre périodes seulement dans un secteur qui présente une courbe d’expérience de 10% : son coût unitaire de production est donc égal à 81% de celui de la première unité. Les entreprises étrangères sont quant à elles présentes dans le même secteur avec la même technologie mais depuis 32 périodes : leur coût unitaire de production est égal à (0,9)^5, soit 59% de celui de la première unité. L’entreprise domestique supporte donc un désavantage de coût par rapport à ses concurrentes étrangères qui résulte uniquement de son entrée plus tardive sur le marché. |
Le rôle des économies d’expérience
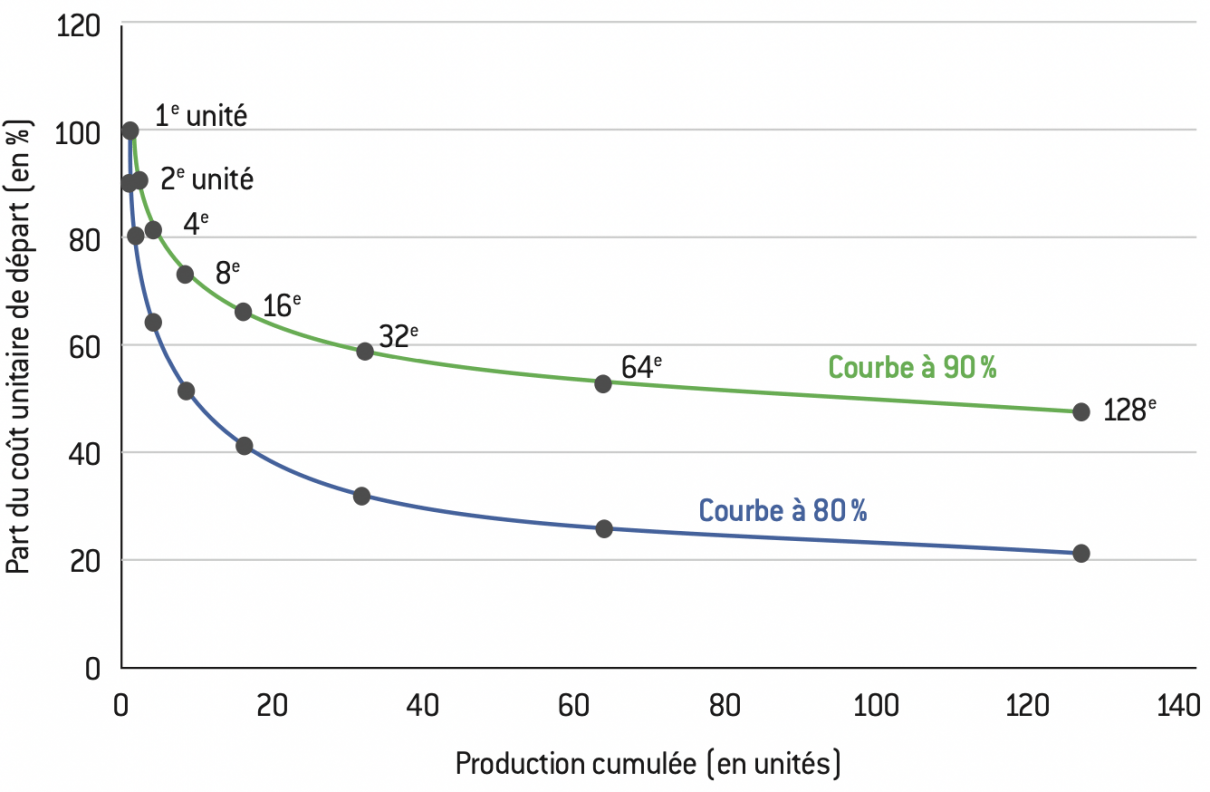
Source :
« Original Theory », maxwideman.com.
| Les économies d’échelle externes*
Nous pouvons appliquer le principe des économies d’échelle externes à une situation dans laquelle nous avons deux pays qui ne sont pas encore ouverts au commerce international : l’un, de petite taille (en termes de demande), ne bénéficie pas d’économie d’échelle externes et a donc un coût unitaire élevé. Dans le graphique ci-contre, le petit pays produit la quantité QA au coût unitaire CA : compte tenu de la concurrence sur le marché, le prix est égal au coût unitaire, soit PA. À l’inverse, le grand pays dispose d’une vaste demande intérieure et bénéficie donc d’économies d’échelle externes plus importantes : il produit la quantité QB, ce qui lui permet d’atteindre un coût unitaire CB et un prix PB plus faibles. Si les deux pays s’ouvrent au commerce, celui qui dispose d’un grand marché domestique va pouvoir conquérir des parts de marché dans le petit pays, puisque son coût unitaire (donc son prix de vente) sera inférieur. Dans un cas limite, il va même faire sortir du marché l’entreprise du petit pays. * À partir de Paul Krugman, Maurice Obsfeld et Marc Melitz, Économie internationale, chap. 7, « Économies d’échelle externes, spécialisation et commerce international », 10e éd., Pearson, 2015, p. 147-164. |
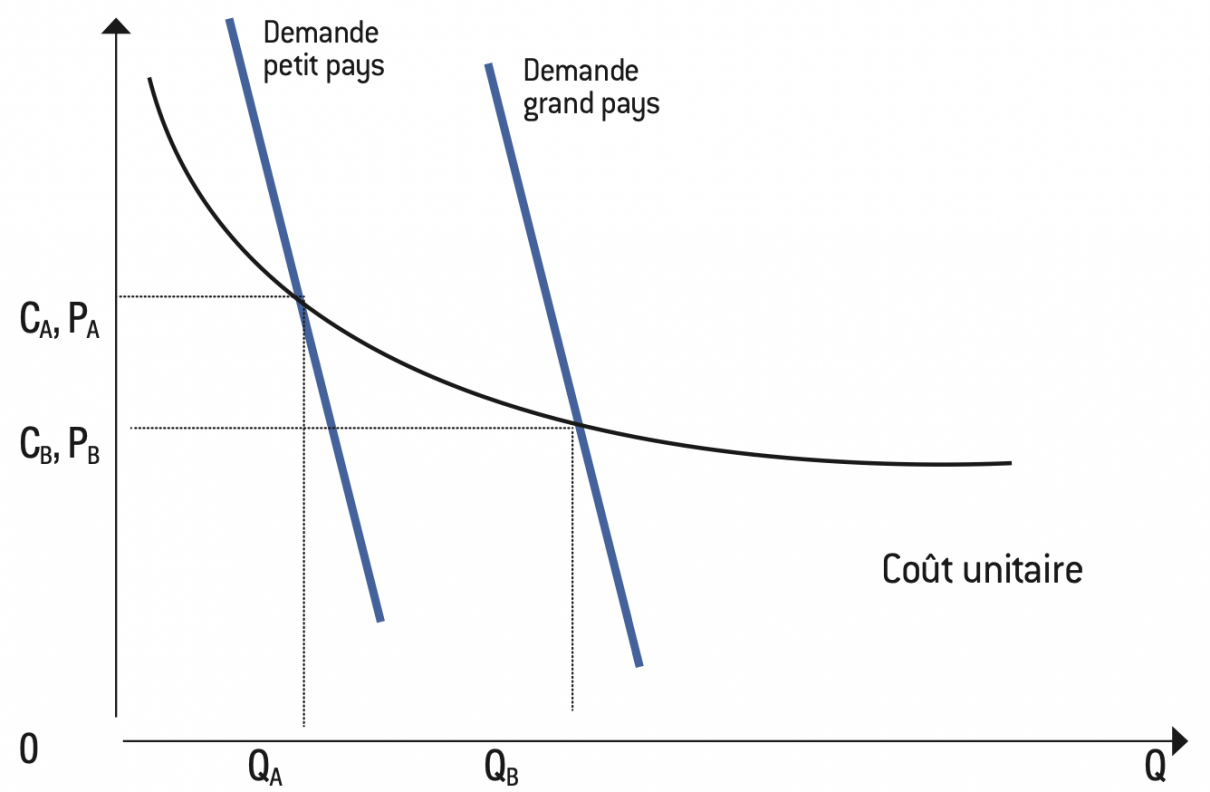
Source :
À partir de Paul Krugman, Maurice Obsfeld et Marc Melitz, Économie internationale, chap. 7, « Économies d’échelle externes, spécialisation et commerce international », 10e éd., Pearson, 2015, p. 147-164.
S’il veut bénéficier de fortes économies d’échelle externes, un « petit pays » n’a d’autre choix que de devenir un « grand pays », en procédant à une intégration économique avec d’autres « petits pays », dans le but d’augmenter la taille de son marché. L’enjeu d’une politique publique est alors de stimuler la taille critique du secteur, en augmentant la demande adressable. Dans le cas de l’Europe, cela passe d’abord par une politique de décloisonnement des marchés nationaux, dans le but de créer un grand marché intérieur. Différents outils peuvent contribuer à accélérer la mise en place d’un grand marché, par exemple une harmonisation des législations et des standards technologiques entre les pays de l’Union européenne mais aussi une politique coordonnée d’achats publics. Autrement dit, une politique de rattrapage doit se penser au niveau européen et donc s’accompagner d’une politique d’achèvement du marché unique.
Les conditions de succès d’une politique de rattrapage
| Idée 18 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que l’innovation technologique dans le secteur soit mature et n’expose pas au risque d’avoir toujours un « train de retard ». |
Voir Eduardo Luzio et Shane Greenstein, « Measuring the Performance of a Protected Infant Industry: The Case of Brazilian Microcomputers », The Review of Economics and Statistics, 77, n° 4, novembre 1995, p. 622-633.
Le succès d’une politique de rattrapage suppose que l’industrie dans laquelle il s’opère soit mature sur le plan technologique et ne connaisse pas une innovation continue et rapide. En effet, si l’industrie est en permanente évolution, à l’image par exemple des produits électroniques, avec des cycles de vie des produits très courts, le risque est que le pays qui rattrape ait toujours un « train de retard » sur les pays leaders.
Ce cas de figure n’a rien de théorique et peut être illustré par le cas du Brésil, qui a mis en œuvre une politique de rattrapage au cours des années 1980 dans le secteur de la production d’ordinateurs personnels 49. Cette politique a été un échec : en effet, l’industrie brésilienne d’ordinateurs a bien vu ses performances technologiques augmenter mais n’a jamais réussi à rattraper le retard avec les leaders du secteur (à savoir les entreprises américaines IBM et Apple), compte tenu de l’évolution permanente de la performance des ordinateurs. Le graphique ci-après représente le ratio prix/performance des ordinateurs américains et brésiliens au cours de la période 1982-1992. Bien que dans les deux cas la performance des ordinateurs s’améliore au cours du temps (ce qui se traduit par une diminution de la courbe), il existe toujours un écart entre les deux pays, de trois à six ans. Par exemple, nous voyons que le ratio prix/performance des ordinateurs brésiliens en 1990 est égal à celui obtenu par les ordinateurs américains en 1984, soit un écart de six ans.
Si l’innovation est soutenue mais prévisible, consistant par exemple à lancer des générations de produits de plus en plus perfectionnés le long de la même trajectoire technologique (à l’image des semi-conducteurs), il est préférable de ne pas rattraper la technologie existante mais de pratiquer plutôt la stratégie du leapfrogging (« saute-mouton »). Le but est alors de se positionner sur la prochaine génération de produits pour éviter d’avoir en permanence ce « train de retard ». Cette stratégie suppose toutefois que l’on puisse faire abstraction des compétences passées pour pouvoir fabriquer la génération ultérieure de produits. Telle est la stratégie annoncée en septembre 2020 par l’Europe dans le domaine des supercalculateurs. L’enjeu n’est pas seulement de déployer des systèmes existants mais aussi d’être les premiers à finaliser, d’ici à 2023, un supercalculateur exaflopique (la prochaine génération) et de préparer la prochaine frontière technologique, celle des ordinateurs quantiques. Si l’innovation est soutenue mais imprévisible, il est préférable de ne pas faire de rattrapage et de miser plutôt sur des innovations de rupture. En effet, dans ce cas, les cartes peuvent être rebattues dans un secteur avec l’arrivée d’une nouvelle technologie très différente de la précédente, et le rattrapage est alors dangereux puisque le pays risque de se retrouver seul sur la technologie en déclin.
Ratio prix/performance des ordinateurs aux États-Unis et au Brésil (1982-1992)
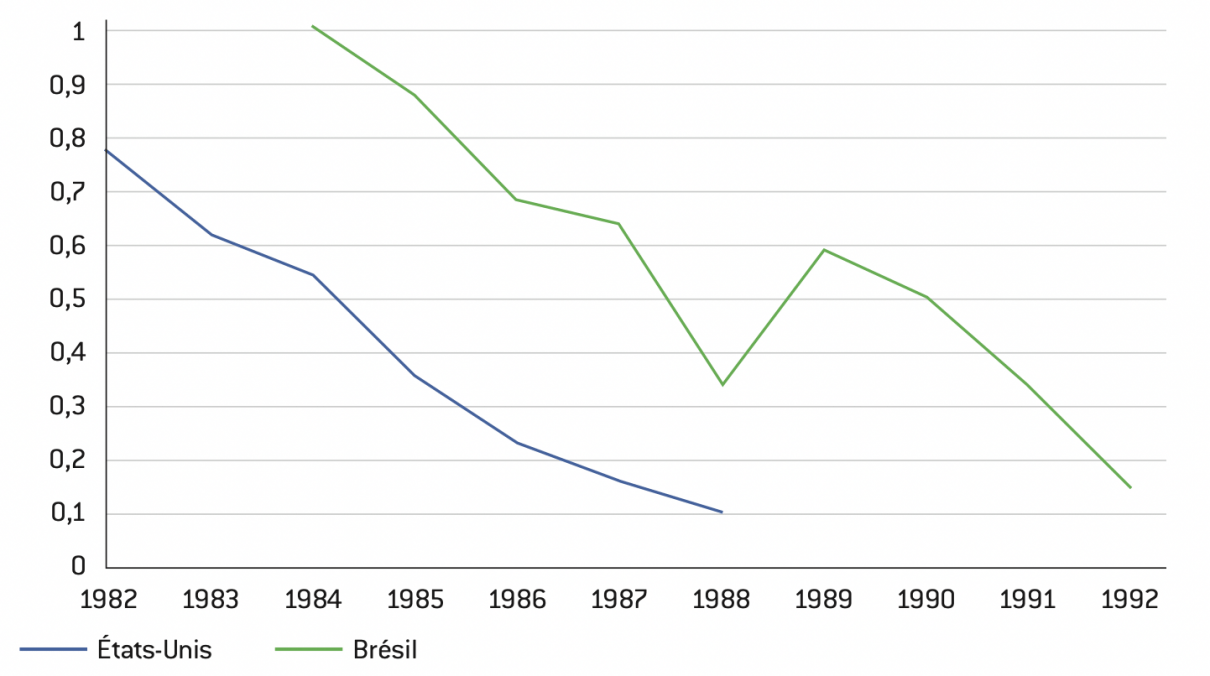
Source :
Eduardo Luzio et Shane Greenstein, « Measuring the Performance of a Protected Infant Industry: The Case of Brazilian Microcomputers »,The Review of Economics and Statistics, vol. 77, n° 4, novembre 1995, p. 630.
| Idée 19 : Le succès d’une politique de rattrapage suppose que les acteurs soient convaincus que la politique d’aide sera limitée dans le temps. |
Une seconde condition de succès d’une politique de rattrapage est qu’elle soit strictement limitée dans le temps. Les pouvoirs publics doivent annoncer clairement dès le départ que l’aide est temporaire, le temps que l’industrie rattrape son retard. Sinon, le risque est que les entreprises subventionnées, anticipant la possibilité d’une prorogation du « protectionnisme éducateur », soient moins incitées à être efficaces et à rattraper rapidement la frontière technologique. Cependant, l’engagement ex ante sur la temporalité peut être insuffisant car peu crédible dans la mesure où il repose sur une simple promesse (cheap talk). Toute la question est alors de savoir comment les pouvoirs publics peuvent crédibiliser leur engagement.
On retrouve ici un sujet classique en économie, celui d’incohérence temporelle des politiques publiques et de crédibilité des annonces, très délicat à résoudre. Une première solution consiste à confier le contrôle opérationnel du programme à une agence gouvernementale indépendante, avec un mandat étroit et qui ne soit pas sensible aux pressions des entreprises et/ou des politiques locaux. On peut également faire appel à des experts en évaluation des politiques publiques. Une autre solution réside dans l’annonce, dès le départ, d’un calendrier clair de réduction progressive et automatique de la protection et/ou de la subvention, avec une date butoir de libéralisation du secteur. Ainsi, au Japon, le puissant ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie japonais (MITI), dont le prestige et le pouvoir sont incontestés, a par exemple protégé temporairement, dans les années 1960-1970, l’industrie automobile japonaise. Il a toutefois annoncé dès le départ que cette protection serait temporaire, en fixant à l’avance un calendrier impératif de diminution progressive des droits de douane sur les importations d’automobiles : le tarif est ainsi passé de 40% en 1968 à 6,4% en 1972, puis a été aboli en 1978.
| Idée 20 : Le succès d’une politique de rattrapage est d’autant plus probable que le secteur n’est pas en situation de monopole sur le marché domestique. |
Il faut aussi, et c’est sans doute le plus important, que l’industrie subventionnée ne se retrouve pas en situation de monopole sur le marché domestique. Il faut éviter à tout prix les situations de picking winners (« choix des gagnants »), dans lesquelles le gouvernement désigne à l’avance une seule entreprise à qui incombera la mission d’opérer le rattrapage technologique. En situation de monopole, à l’abri de la concurrence domestique et étrangère, l’entreprise subventionnée est peu incitée à être efficace, surtout si elle anticipe que la protection pourra être prolongée. On aboutit alors à l’effet inverse de celui recherché. De plus, l’entreprise va tenter de conserver la rente de monopole – de source légale – en se livrant à une activité de recherche de rente (rent seeking), qui peut prendre de multiples formes, légales ou illégales, telles que le versement de pots-de-vin ou de subventions à un parti politique. Il est donc essentiel de maintenir ou de créer sur le marché domestique protégé une certaine concurrence pour s’assurer que le phénomène d’apprentissage aura bien lieu. Cette concurrence peut prendre la forme d’une concurrence pour le marché (appel d’offres) ou sur le marché.
Le cas du Japon au cours des années 1950-1990 est à cet égard instructif : le « miracle japonais » résulte d’une politique volontariste de construction d’avantages comparatifs basés sur un protectionnisme éducateur, accompagné d’une forte concurrence sur le marché intérieur entre les entreprises japonaises (voir encadré ci-dessous).
|
Le rôle de la concurrence domestique dans le rattrapage japonais Dans une étude parue en 2004*, des chercheurs ont distingué deux types d’industries au Japon (voir tableau ci-dessous) :
Les auteurs de l’étude en tirent la conclusion suivante : « En fait, les industries où la concurrence était limitée étaient celles où le Japon ne réussissait pas sur le plan international. Dans les industries à succès international, la concurrence domestique au Japon était invariablement féroce**. » * Michael E. Porter et Mariko Sakakibara, « Competition in Japan », Journal of Economic Perspectives, vol. 18, n° 1, hiver 2004, p. 27-50. ** « In fact, those industries in which competition was restricted prove to be those where Japan was not successful internationally. In the internationally successful industries, internal competition in Japan was invariably fierce » (ibid., p. 27-28). |
La politique industrielle japonaise : le rôle clé de la concurrence domestique (1950-1990)
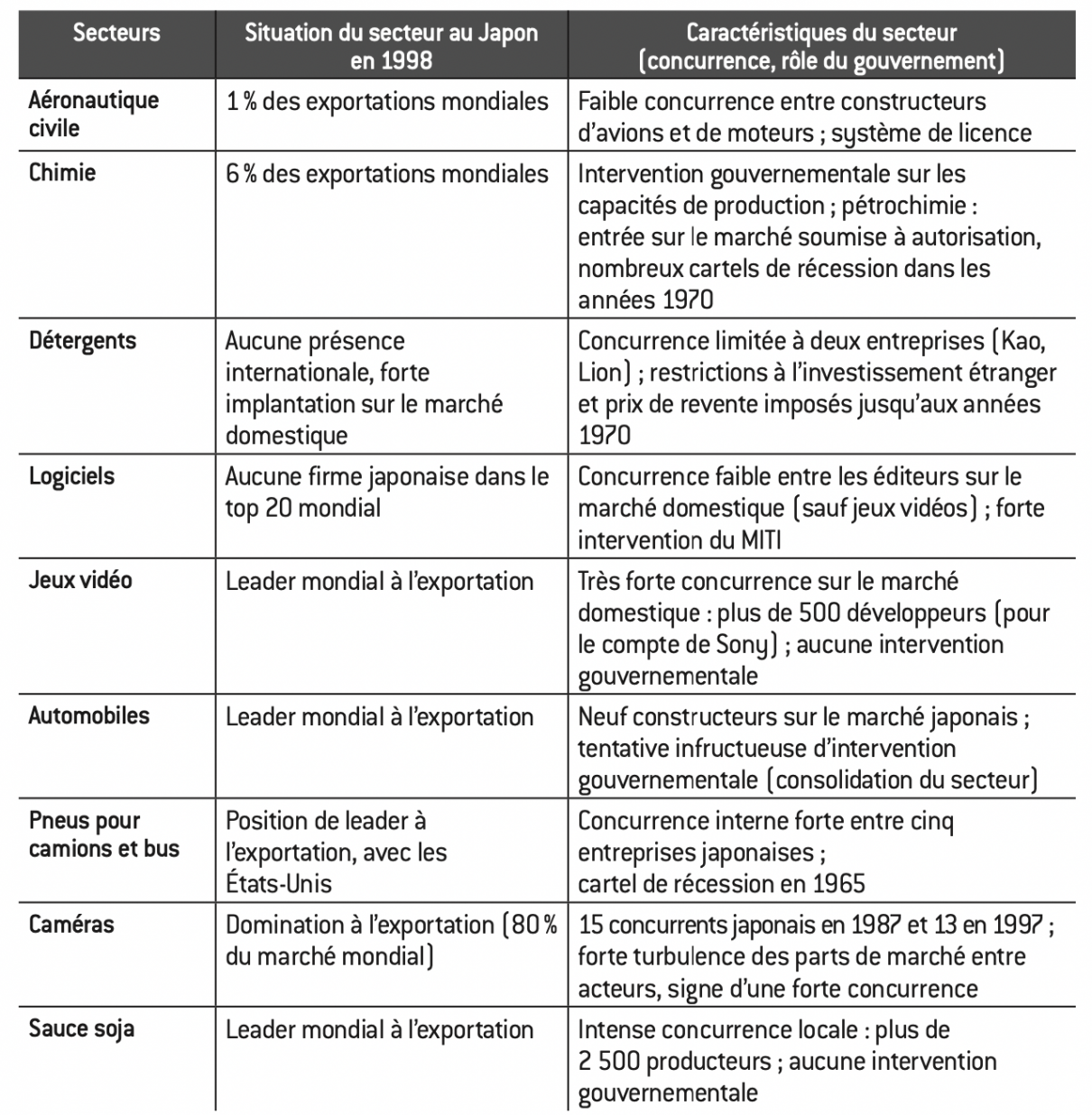
Source :
Michael E. Porter et Mariko Sakakibara, « Competition in Japan », Journal of Economic Perspectives, vol. 18, n° 1, hiver 2004, p. 27-50.
Voir Philippe Aghion, Jing Cai, Mathias Dewatripont, Luosha Du, Ann Harrison et Patrick Legros, « Industrial Policy and Competition », American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, p. 1-32.
Plus récemment, dans le cas de la Chine, des chercheurs ont montré que la politique industrielle chinoise de ciblage sectoriel s’avère d’autant plus efficace que le secteur est concurrentiel ou que le ciblage porte sur un grand nombre d’entreprises, qui vont devenir concurrentes. Les auteurs ont testé cette hypothèse sur un échantillon d’entreprises chinoises au cours de la période 1998-2007 et trouvent une relation positive entre les gains de productivité et des mesures de soutien à l’industrie, lorsque ces dernières sont allouées à des secteurs très concurrentiels 50.
Il est important de noter que le maintien d’une structure concurrentielle ne doit pas porter uniquement en aval sur le produit directement subventionné. Il faut également s’assurer qu’en amont la structure de marché n’est pas monopolistique. Ainsi, dans le cas de la politique brésilienne en matière d’ordinateurs, s’il y avait bien dix producteurs domestiques, le marché des inputs (transistors, etc.) était lui aussi protégé mais très concentré ; cette situation a conduit à des prix des composants deux à cinq fois plus élevés qu’aux États-Unis.
| Idée 21 : Le cloud constitue un bon exemple d’activité essentielle nécessitant un rattrapage des Européens. |
Voir Paul-Adrien Hyppolite, op. cit., p. 39-44.
Le terme « cloud » désigne les infrastructures numériques permettant de stocker les données numériques. Il se compose d’infrastructures de réseaux, donc virtuelles, qui se distinguent des infrastructures physiques de serveurs. Le service de cloud offre des espaces de stockage mais aussi d’ordonnancement des données. Il s’accompagne le plus souvent de logiciels de transfert, de récupération, de traitement des données et de partage. Aujourd’hui, les infrastructures de cloud en Europe sont dominées par les géants américains Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et Google 51. En 2019, aucune firme européenne ne figurait dans le top 5 des entreprises du cloud, en termes de revenus (voir tableau ci-dessous). Il existe bien des acteurs européens offrant des services de cloud – le plus gros d’entre eux étant le français OVH –, mais ils n’ont pas atteint la taille critique de leurs concurrents américains. Ceux-ci ont dix ans d’avance et ont créé des relations de clientèle (avec toute l’inertie des habitudes qu’elles comportent) avec de très gros clients européens, de l’administration allemande aux grands industriels européens. Ainsi, par exemple, Volkswagen travaille avec Amazon et Microsoft, tandis que SAP recourt aux services de Microsoft.
Les cinq premières entreprises mondiales du cloud en termes de revenus (2019)
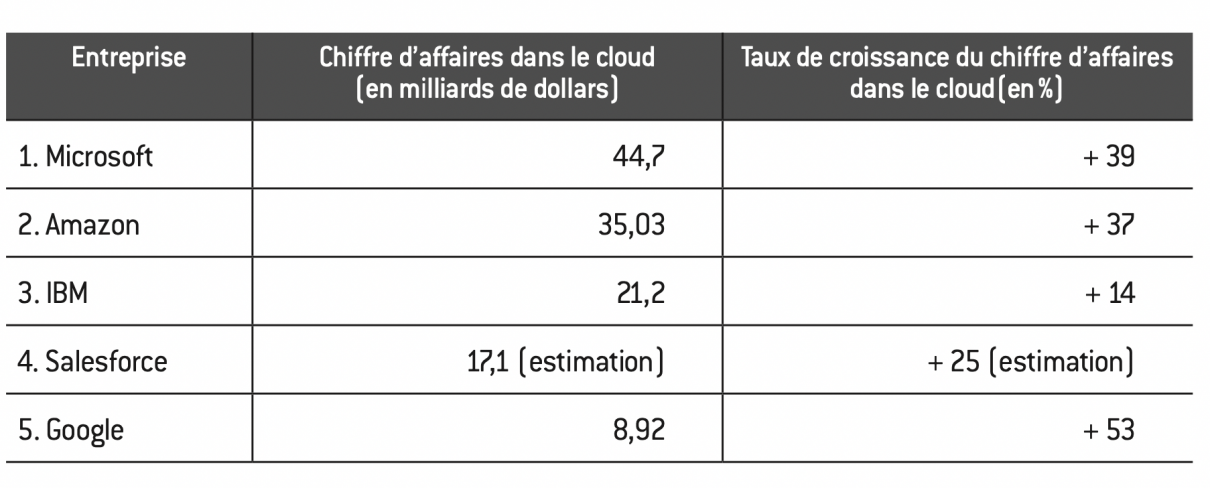
Source :
Bob Evans, « Who Are the World’s Top 5 Cloud Vendors Ranked by 2019 Revenue? », cloudwars.co, 18 février 2020.
Voir Raphaël Gauvain, Claire d’Urso et Alain Damais, « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale », rapport à la demande de Édouard Philippe, Premier Ministre, Assemblée nationale, 26 juin 2019.
Voir Florence G’sell, « Remarques sur les aspects juridiques de la “souveraineté numérique” », Revue des juristes de Sciences Po, n° 19, octobre 2020, p. 52-60.
Voir Commission européenne, « Une stratégie européenne pour les données », 19 février 2020.
Selon la Commission européenne, l’ambition de cette stratégie européenne pour les données « est de permettre à l’UE de devenirl’économie habile à tirer parti des données la plus attrayante, la plus sûre et la plus dynamique du monde » (ibid., 30).
L’activité de cloud est stratégique à plusieurs égards. Il s’agit tout d’abord d’une activité qui répond à un besoin critique croissant des entreprises et des administrations pour organiser la transformation numérique et la gestion de leurs données. Aucune organisation ne va pouvoir s’en passer et ce besoin va constituer une part de plus en plus importante de leurs dépenses informatiques. Ensuite, c’est une activité qui engage la sécurité et la compétitivité des organisations (entreprises, administrations…), c’est dans la qualité de la gestion de leurs données qu’elles vont assurer l’exploitation compétitive des données qu’elles collectent mais aussi assurer la sécurité de leurs actifs intellectuels. Enfin, c’est une activité stratégique parce qu’elle confie à l’organisation qui gère l’infrastructure une ressource inestimable d’informations. Dès lors, la confiance dans le système, qui repose notamment sur les institutions politico-juridiques, est indispensable. À cet égard, l’entrée en vigueur aux États-Unis du Cloud Patriot Act en mars 2018 constitue une véritable menace pour l’Europe : cette loi prévoit que les autorités judiciaires américaines puissent obtenir la communication des données non personnelles des personnes morales de toute nationalité, dès lors qu’elles utilisent les infrastructures « nuagiques » d’opérateurs américains.
Le problème est sérieux 52 et appelle trois niveaux de réponses possibles. Une première réponse, d’ordre juridique et à l’échelle européenne consiste à contester l’extraterritorialité du Cloud Patriot Act 53. Il s’agit toutefois d’une réponse de long terme. Une deuxième réponse est d’ordre réglementaire : les Européens peuvent contraindre les acteurs américains à se soumettre au Règlement général sur la protection des données (RGPD), en contrepartie de leur accès au marché européen. Mais les marges de négociation de l’Europe sont limitées, compte tenu de l’absence d’acteur européen de taille équivalente aux géants américains. Une troisième réponse passe par une politique de rattrapage, mais son dimensionnement géographique apparaît déterminant dans sa réussite. On relèvera à cet égard que la France a tenté, seule, de soutenir en 2012 l’activité de cloud, avec les projets Cloudwatt (qui rassemblait Orange et Thales) et Numergy (avec Bull et SFR). L’État s’est toutefois désengagé assez rapidement de ces projets, qui ont échoué faute d’avoir atteint une taille critique. Le bon niveau de rattrapage se situe à l’évidence à l’échelle de l’Union européenne. C’est dans cet esprit que l’Allemagne et la France ont lancé, en juin 2020, le projet Gaia-X, qui vise à créer un espace européen des données, une infrastructure commune au travers de laquelle plusieurs acteurs européens offriraient leurs services et assureraient leur interopérabilité. Les membres fondateurs de Gaia-X sont Orange, OVH, Atos, EDF, Deutsche Telekom, Siemens, Bosch et SAP. Ce projet est soutenu par l’Union européenne, qui prévoit d’y investir 2 milliards d’euros 54. Bien que pavée plus de bonnes intentions 55 que d’argent, la stratégie européenne pour les données présente l’intérêt, au lieu de créer un champion européen, d’agréger les forces existantes, c’est-à-dire les entreprises qui offrent des services autour du cloud, et de rendre leurs services interopérables et conformes à l’ensemble des régulations européennes sur la protection et la sécurité numérique. Le pari est que c’est dans cette opérabilité et dans cette assurance normative que se créera l’avantage comparatif européen. Encore faut-il que tous les acteurs y adhèrent.
Outre la taille critique et le soutien financier, il est nécessaire que les pouvoirs publics impulsent une dynamique de la demande dans la mesure où les entreprises privées seront attentistes et préféreront rester à court terme avec leurs fournisseurs américains. Il en résultera un processus classique d’excès d’inertie : chaque client privé a intérêt à attendre que l’offre de cloud bascule du côté des entreprises européennes avant de s’engager, mais comme tous les clients ont le même comportement d’attentisme, le marché ne décolle jamais. Dans ces conditions, les administrations publiques ont un rôle essentiel à jouer : celui de donner une impulsion au marché, en confiant leur cloud à des entreprises européennes. On peut s’interroger à cet égard sur la cohérence de la politique menée par la France qui, en parallèle avec le lancement de Gaia-X, a évincé OVH au profit du cloud Azure de Microsoft pour le fonctionnement de l’application de surveillance de l’épidémie de Covid-19 et le stockage des données de santé, tandis que BPI France a sollicité les services de AWS pour gérer les prêts garantis par l’État.
Une politique de rattrapage s’avère un exercice délicat dans la mesure où, même pour une administration, il peut être préférable, pour des raisons d’efficacité, de choisir un acteur étranger. Cependant, une politique industrielle – ici de création d’un cloud européen – n’a de chances de réussir qu’à la condition que convergent toutes les dimensions du marché, la demande comme l’offre, et que la puissance publique qui impulse la politique donne l’exemple pour exprimer clairement son engagement de long terme qui fera ensuite s’engager les acteurs privés (politique de commitment).
| Idée 22 : Toute politique de rattrapage implique un coût d’opportunité pour la collectivité. Il est nécessaire que les pouvoirs publics l’explicitent. |
Une politique de rattrapage, qu’elle soit motivée par des économies d’apprentissage ou des économies d’échelle externes, implique nécessairement un coût à court terme pour les consommateurs, qui doit être compensé à long terme par un gain pour la collectivité. L’expérience montre que ce coût d’opportunité peut être très élevé si la politique de rattrapage échoue. Ainsi, pour le cas du Brésil, déjà évoqué plus haut, qui a essayé en vain de construire une industrie d’ordinateurs personnels durant les années 1980, le surprix payé par rapport à une situation d’importation d’ordinateurs s’est chiffré à 143,3 millions de dollars par an, pendant cinq ans, ce qui représente 33% de la dépense annuelle en ordinateurs 56. De leur côté, les producteurs brésiliens ont connu une hausse de leur profit de 13% par rapport à la dépense annuelle en ordinateurs. On en déduit que le coût d’opportunité de la politique d’industrie naissante a été de 20% sur la période 1984-1988 57. Pour autant, ce coût d’opportunité est le prix à payer pour disposer d’une forme de souveraineté sur des biens et services jugés essentiels. À cet égard, le cas du cloud met l’Europe face à un véritable dilemme : le rattrapage dans ce domaine est critique pour notre souveraineté numérique mais il aura un coût élevé à court terme, prenant la forme d’une baisse de la qualité et de l’efficacité du service dans la période de transition. Il y a donc un arbitrage politique à faire, entre une situation hybride de collaboration avec les acteurs américains dominants, au risque de ne pas insuffler assez de demande aux acteurs européens, et une situation plus radicale d’exclusivité européenne maximisant les chances de rattrapage mais au prix d’une baisse d’efficacité à court terme.
Conclusion
En repartant des racines du concept de souveraineté économique et en étudiant les politiques qui peuvent être mises enœuvre pour surmonter le défaut de souveraineté, nous avons analysé les marges de manœuvre étroites dont disposent les pouvoirs publics pour donner une réelle consistance à cette notion. Entre une autarcie impossible et un mercantilisme hasardeux, l’impératif de souveraineté économique se résume à la reconquête de quelques productions jugées stratégiques, au moyen de relocalisations ou d’une politique de rattrapage technologique.
Ce faisant, nous soulignons qu’il convient d’avancer avec prudence sur un tel sujet, non seulement parce que les cas de défauts de souveraineté nécessitant une intervention publique sont assez rares mais aussi parce que le succès de telles politiques est soumis à certaines conditions. En matière de souveraineté économique, comme ailleurs en économie, les meilleures intentions ne suffisent souvent pas, le diable se cache dans les détails et la réussite d’une politique de souveraineté réside essentiellement dans les modalités de son exécution.
Si l’on veut donner une pleine consistance à la notion de souveraineté économique, il nous semble que celle-ci doive s’apprécier à l’aune de la capacité d’un pays à satisfaire les besoins de l’ensemble de sa population, dans le respect de ses préférences présentes et futures. À cet égard, le pouvoir d’achat est tout autant un objectif de souveraineté que la maîtrise des technologies pour la production. Les deux vont de pair si les rémunérations augmentent avec les qualifications technologiques.
De même, toutes les politiques qui renforcent l’attractivité du territoire participent à la consolidation de la souveraineté économique. Enfin, à moyen-long terme, la souveraineté passe par le dépassement des situations de dépendance au moyen de l’innovation et de la substitution de technologie.
Autrement dit, la souveraineté économique durable se construit aujourd’hui sur l’investissement dans le capital humain et le financement d’innovations de rupture pour demain. Nul besoin de vouloir construire de nouvelles filières dans leur totalité, ce qui compte, c’est d’investir dans des segments prometteurs de nouvelles technologies, c’est de se spécialiser dans certaines productions pour devenir un maillon incontournable dans la chaîne de valeur.
L’horizon de cette véritable souveraineté économique nous semble devoir être l’Union européenne qui, par la profondeur deson marché, est seule en mesure de rivaliser avec les géants américains et chinois. La souveraineté de demain sera européenne ou ne sera pas.













Aucun commentaire.