Souveraineté, maîtrise industrielle et transition énergétique (1)
Les conditions de réussite du programme nucléaire français de 1945 à 1975Liste des abréviations et acronymes utilisés dans le premier volume
Introduction
Sortir des idées reçues
Le récit habituel
Une histoire différente
La transition rapide de la France
Le détour par l’histoire : 1945-1975
De 1945 à 1960, de la science aux prototypes : le rôle central du CEA l’apprentissage d’EDF et du tissu industriel
De 1960 à 1971, des démonstrateurs industriels au choix de la filière à déployer
De 1972 à 1975, les chocs pétroliers et la préparation industrielle d’un déploiement massif et standardisé sur la filière eau pressurisée
Une préparation collective exigeante soutenue par l’État
Prises de risque, échecs et succès dans une perspective de puissance économique et de souveraineté
La souveraineté et l’efficacité économique par la maîtrise industrielle et des coopérations internationales ciblées
Résumé
Les sujets énergétiques sont des enjeux de prospérité et de souveraineté des États. Les années 1945-1990 en France illustrent comment il a été possible d’explorer des voies nouvelles et de déployer à la fois massivement et rapidement des technologies innovantes adaptées à ces enjeux essentiels pour notre pays. Les dernières décennies en Chine ou aux États-Unis témoignent également de l’efficacité de cette méthode. Elle repose sur le rôle majeur joué par l’État dans la maîtrise des conditions de la réussite industrielle et peut permettre de relancer le secteur et de retrouver la puissance et la prospérité qui lui sont attachées, à condition qu’une vision politique soit commune aux différents acteurs.
Dans la première partie de cette étude, Jean-Paul Bouttes nous entraîne dans l’histoire afin de mettre au jour les principales caractéristiques de la période qui a vu la France devenir pionnière dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Dans la deuxième partie, l’auteur élargit la problématique à la transition énergétique, à partir d’exemples étrangers et plus récents de réussite industrielle, tels les panneaux photovoltaïques en Chine ou la version américaine (Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E) des Programmes d’investissements d’avenir (PIA). L’étude se conclut sur la situation française, dont les deux dernières décennies ont été marquées par un recul de nos compétences industrielles, en particulier de nos points forts traditionnels (le nucléaire, le thermique à flamme, le réseau), par les difficultés d’EDF, d’Areva, de Framatome, d’Alstom et, plus préoccupant, par les échecs de tentatives industrielles dans le photovoltaïque et les éoliennes terrestres.
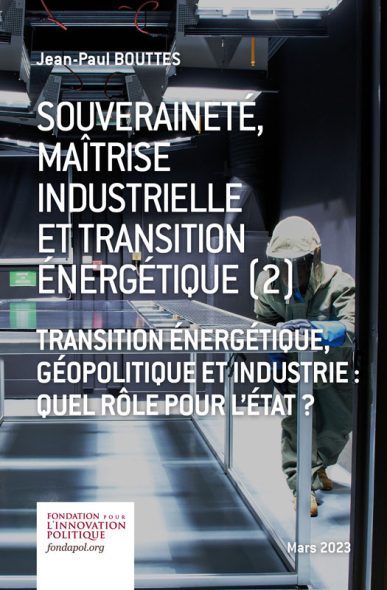
Souveraineté, maîtrise industrielle et transition énergétique (2)
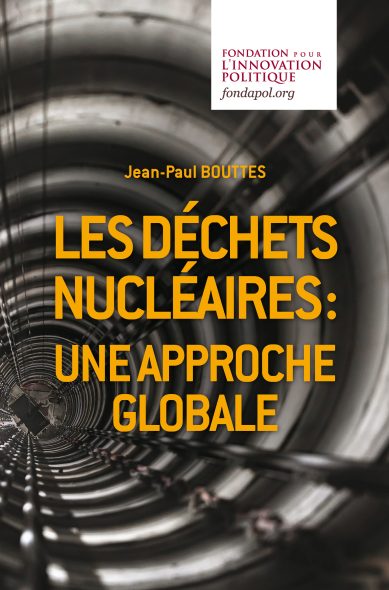
Coffret « Les déchets nucléaires : une approche globale »

Coffret de cinq études - Impératif climatique : le retour de la fée électricité
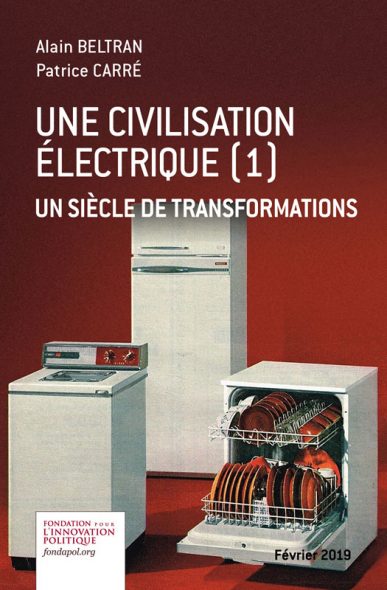
Une civilisation électrique (1) un siècle de transformations

Une civilisation électrique (2) vers le réenchantement

Vers une société post-carbone

Énergie-climat en Europe : pour une excellence écologique

Relocaliser en décarbonant grâce à l'énergie nucléaire

Énergie nucléaire : la nouvelle donne internationale

Good COP21, Bad COP21 (1) : le Kant européen et le Machiavel chinois
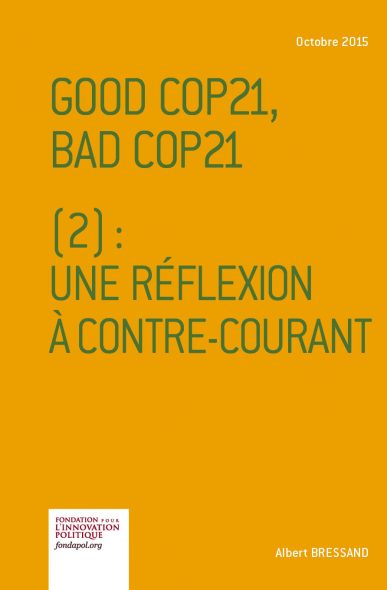
Good COP21, Bad COP21 (2) : une réflexion à contre-courant
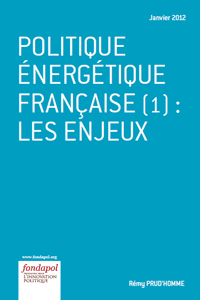
Politique énergétique française (1) : les enjeux

Politique énergétique française (2) : les stratégies

Énergie-climat : pour une politique efficace
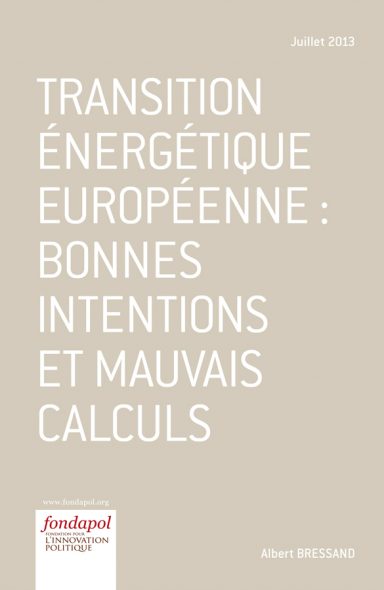
Transition énergétique européenne : bonnes intentions et mauvais calculs

Copyright :
EDF archives
Source :
En 1958, le général de Gaulle visite le centre atomique de Marcoule, dans le Gard, où il constate le chemin parcouru depuis 1945, date à laquelle il signa l’acte de naissance de l’industrie nucléaire en France. À ses côtés, Maurice Pascal (à droite du général de Gaulle sur la photographie), alors chef des études des piles au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), explique au chef de l’État les détails de la salle de commande du réacteur G2. Ancien élève de l’École polytechnique, Maurice Pascal (1920-1996) a commencé sa carrière à la délégation ministérielle pour l’Armement. Il a été placé en position hors cadre au CEA en 1954. Il fut chargé de la politique industrielle à compter de 1964.
| Remerciements
Ce travail doit beaucoup aux échanges partagés avec de nombreux acteurs de l’histoire du nucléaire français. Je tiens particulièrement à remercier ici Bernard Esambert pour sa lecture attentive, ainsi que Gilles Bellamy, Lorraine Bouttes, Yves Bréchet, Michel Clavier, Pierre Daurès, Sylvain Hercberg, Bruno Lescoeur, Bernard Tinturier et Gilles Zask pour leurs commentaires et suggestions. Cependant, bien entendu, je porte la seule responsabilité des analyses et des opinions exprimées dans cet ouvrage. Jean-Paul Bouttes |
Liste des abréviations et acronymes utilisés dans le premier volume
AGR : Advanced Gas-cooled Reactor.
AHEF : Association pour l’histoire de l’électricité en France.
AIE : Agence internationale de l’énergie.
ARPA-E : Advanced Research Projects Agency-Energy.
ASN : Autorité de sûreté nucléaire.
CEA : Commissariat à l’énergie atomique.
CEE : Communauté économique européenne.
CEEA/Euratom : Communauté européenne de l’énergie atomique.
CEGB : Central Electricity Generating Board.
CGE : Compagnie générale d’électricité.
Cigre : Conférence internationale des grands réseaux électriques.
CME : Conseil mondial de l’énergie.
COP : Conférence des parties.
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de radioprotection.
DSIN : Direction de la sûreté nucléaire.
EDF : Électricité de France.
ENA : École nationale d’administration.
EPR : European Pressurized Reactor.
INSTN : Institut national des sciences et techniques nucléaires.
IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire.
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
PEON : production d’électricité d’origine nucléaire.
REP : réacteur à eau pressurisée.
SCSIN : Service central de sécurité des installations nucléaires.
Sfac : Société des forges et ateliers du Creusot.
SENA : Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes.
UKAEA : United Kingdom Atomic Energy Authority.
UNGG : uranium naturel, graphite et gaz.
Unipede : Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique.
Introduction
La première partie de ce document s’intéresse à l’histoire du nucléaire civil de 1945 à 1975 en France. L’auteur s’appuie particulièrement sur le livre de Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, L’Énergie de la France. De Zoé aux EPR, l’histoire du programme nucléaire (Éditions François Bourin, 2013), qui propose une histoire
du programme nucléaire sur la base non seulement de documents historiques mais aussi d’entretiens menés avec de nombreux acteurs de cette aventure. Marcel Boiteux et Philippe Boulin sont à l’origine de ce projet que l’auteur de ce document a pu mettre en œuvre et accompagner.
Avec, bien sûr, la mobilisation et le développement de toutes les autres énergies renouvelables pertinentes : biomasse, géothermie, énergies marines…
AIE, Energy Technology Perspectives 2006. In support of the G8 Plan of Action, OECD, 2006.
Le terme basic design désigne le dessin d’ensemble de la centrale, qui doit être complété par les plans détaillés de l’installation (detailed design). Il est élaboré sur la base d’une première esquisse au niveau de la conception, le conceptual design.
La situation économique préoccupante de l’Europe et de la France, en raison de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, nous rappelle l’importance centrale, aussi bien pour notre prospérité que pour notre sécurité, d’une énergie compétitive répondant à deux critères supplémentaires : une disponibilité garantie et des impacts limités sur l’environnement1. Pour en disposer, la maîtrise industrielle des technologies de production et de transformation de l’énergie, et la capacité à anticiper le mix énergétique le mieux adapté à nos besoins à long terme sont les deux facteurs principaux de réussite. Ces enjeux seront encore plus forts si l’on souhaite mettre en œuvre la transition énergétique nécessaire au cours des prochaines décennies pour relever le défi du réchauffement climatique tout en tenant compte d’un contexte géopolitique durablement préoccupant.
Pour atteindre ces objectifs, oubliant les leçons de l’histoire et les caractéristiques technico-économiques et industrielles de l’énergie, en particulier celles de l’électricité, les États européens ont misé presque exclusivement sur les marchés européens (concernant le gaz et l’électricité) ou internationaux (pour les équipements ou les matières premières). La tâche était impossible pour les seuls marchés et, confrontés à la résistance du réel, les États membres de l’Union européenne et l’Union européenne elle-même ont réagi en multipliant les lois, les objectifs, les réglementations, mais sans assumer clairement leur rôle. Ces interventions incohérentes face « aux limites des marchés » (market failures) ont débouché sur un échec majeur des pouvoirs publics.
Cet échec est encore surmontable dès lors que l’on dispose du bon diagnostic sur le rôle des États et que ceux-ci corrigent leurs défauts et ceux des marchés. Il s’agit de mobiliser les compétences industrielles, scientifiques et de prospectives nécessaires, de mettre en place une organisation de la sphère publique légère et fondée sur la responsabilité, de favoriser les initiatives, aussi bien celles du secteur privé que celles des collectivités locales, dans le cadre de règles du jeu simples et efficaces. Les exemples présentés ici concernant les enjeux de maîtrise industrielle dans les domaines de technologies majeures pour la décarbonation, comme le nucléaire ou les panneaux photovoltaïques, montrent que ceci a été mis en œuvre avec succès en France dans les années 1950-1990, et en Chine ou aux États-Unis lors de ces trente dernières années. À nous de trouver aujourd’hui la voie française et la voie européenne qui nous permettent, avec un diagnostic partagé et rigoureux qui ne se contente pas de mots trop souvent détournés de leur sens, de faire les changements structurels nécessaires en termes d’organisation de l’État et de règles du jeu européennes pour redresser la situation aussi rapidement que possible au cours de la prochaine décennie.
Face au dérèglement climatique, nous devons engager à l’échelle du monde une transition énergétique d’une ampleur inédite, avec des objectifs « zéro émission nette » à l’horizon du milieu du siècle. Pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, il va donc falloir d’abord décarboner la production d’électricité et électrifier massivement les usages énergétiques, tout en mettant en œuvre une politique ambitieuse d’économie d’énergie. Pour l’essentiel, nous connaissons les technologies qu’il nous faut développer et déployer : du côté de la production, le nucléaire, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, la capture-stockage du CO2 émis, l’hydraulique2 ; du côté des usages, les batteries et les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les processus industriels électriques… Cette feuille de route est bien connue, depuis une vingtaine d’années, comme le montrent, par exemple, les déclarations du sommet du G8 présidé par Tony Blair en 2005 à Gleneagles, le premier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) de 2006, Energy Technology Perspectives3, concernant les relations énergie-climat, ou les propositions de feuilles de route sectorielles discutées lors de la Conférence des parties (COP) de Montréal, en 2005. Pourtant, à ce jour, les résultats en termes de décarbonation sont décevants. L’une des raisons principales tient à l’oubli des enjeux industriels et à la perte de maîtrise industrielle dans le secteur de l’énergie, en particulier pour ces dernières décennies en Europe et en France. Le déploiement massif de ces technologies très capitalistiques exige en effet d’en maîtriser les coûts pour concilier climat et développement économique, ainsi que les maillons clés des chaînes de valeur (équipements à valeur ajoutée, matériaux critiques, numérique) dans un contexte de retour de la géopolitique. La maîtrise des enjeux industriels liés à la fabrication et à la construction de ces technologies capitalistiques est au cœur de ces objectifs, inséparables, que sont l’efficacité économique, la compétitivité, la souveraineté économique et l’autonomie stratégique. Atteindre ces objectifs suppose de passer par de solides coopérations internationales.
Dans cette perspective, la France peut offrir un exemple de succès dans la conduite d’une transition fondée sur la maîtrise de ces enjeux industriels. Entre 1974 et 1990, elle a su mettre en œuvre l’une des transitions les plus rapides dans le monde de l’énergie, en substituant le nucléaire aux centrales charbon et fioul, lui permettant, au terme de cette transition, de bénéficier d’un mix électrique décarboné à 90% (75% nucléaire, 15% hydraulique), des prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe, des coûts d’investissement deux fois moins élevés que ceux relevés aux États-Unis au même moment et de la maîtrise industrielle de la filière des réacteurs à eau pressurisée. Le programme nucléaire civil français a bien constitué une réussite en termes économiques et de souveraineté : le pays s’est libéré de la dépendance aux combustibles fossiles importés, dont le pétrole, dans la production d’électricité, et il a maîtrisé la chaîne de valeur nucléaire, y compris l’enrichissement, tout en faisant levier sur des coopérations internationales fortes (licence Westinghouse francisée, usine Eurodif d’enrichissement à Tricastin, participations d’électriciens européens dans des centrales nucléaires françaises…). En outre, par son ampleur (chaque année, pendant dix ans, quatre à six tranches de 900 à 1 300 MW ont été mises en service), ce programme a permis une importante électrification des usages résidentiels (chauffe-eau, chauffage…) et industriels en satisfaisant une consommation électrique deux fois plus importante en 1990 qu’en 1973, au moment où la sobriété énergétique, mise en place dans le cadre de la « chasse au gaspi » après les deux chocs pétroliers, entraînait une quasi-stagnation de la consommation finale d’énergie. Ces mouvements vont exactement dans le sens du scénario actuel de l’AIE de « zéro émission nette » qui repose à la fois sur la sobriété énergétique et sur une multiplication par deux et demi de la production d’électricité à l’horizon 2050.
On a souvent en tête les conditions de réussite industrielle du déploiement massif de 1974 à 1990, après le premier choc pétrolier : décision politique en 1974-1975 offrant une visibilité à long terme concrétisée par un programme, basic design4 finalisé sur un produit robuste et simple à construire (les réacteurs à eau pressurisée de Westinghouse), des séries standardisées, un tissu industriel de qualité et un architecte industriel clairement responsable et compétent, à savoir EDF. Tout ceci est juste mais ne suffit pas à expliquer la réussite de ce déploiement. Il a été préparé de façon tout aussi déterminante au cours de la période allant de 1945 à 1974, combinant tâtonnements, vision à long terme et détermination sans faille dans l’action. Ces trois décennies ont en effet été caractérisées par la capacité d’une génération d’acteurs, souvent issus de la Résistance et de la France Libre, à prendre des risques, à essayer quasiment toutes les filières – rapides, eau lourde, graphite gaz, eau légère –, à accepter tâtonnements et échecs, avec la volonté de trouver rapidement des solutions efficaces et d’aboutir. La figure et la personnalité du général de Gaulle ont marqué cette période, d’abord directement en 1945, au travers de la création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et du processus de nationalisation de l’électricité, avec la création d’EDF en 1946 ; ensuite, indirectement, au travers d’hommes clés partageant les mêmes objectifs pendant la IVe République (Félix Gaillard, Raoul Dautry, Gaston Palewski, Pierre Guillaumat, Jules Horowitz, Pierre Taranger, Pierre Ailleret…) ; et, enfin, à nouveau, au moment clé du passage au stade industriel et du débat sur le choix de la filière à uranium naturel, graphite et gaz (UNGG) versus eau pressurisée ou eau bouillante, entre 1958 et 1975, avec Georges Pompidou, Premier ministre puis président de la République, Pierre Messmer, Bernard Esambert, Pierre Massé, Francis Perrin, Claude Fréjacques, Georges Besse, André Giraud, André Decelle, Paul Delouvrier, Marcel Boiteux, Michel Hug, Philippe Boulin, Maurice Aragou, Jean-Claude Leny…
Dans la première partie de cette note, nous reviendrons à l’histoire afin d’identifier les principales caractéristiques de cette période et d’en tirer quelques enseignements utiles. En deuxième partie, on élargira la problématique à la transition énergétique qu’il faut conduire aujourd’hui à partir d’exemples plus récents de réussite industrielle concernant d’autres technologies de l’énergie et d’autres pays, comme les panneaux photovoltaïques en Chine ou la version américaine (Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E) des programmes d’investissements d’avenir (PIA). Enfin, on reviendra sur la situation française, dont les deux dernières décennies ont été marquées par un recul des compétences industrielles, en particulier sur ce qui constituait nos points forts traditionnels : le nucléaire, le thermique à flamme, le réseau, avec les difficultés d’EDF, d’Areva, de Framatome, d’Alstom, et, plus préoccupant encore, par les échecs des tentatives industrielles dans le photovoltaïque et les éoliennes terrestres, filières où la France semble se contenter pour l’essentiel de l’installation et de services à faible valeur ajoutée malgré une recherche de qualité dans ces domaines industriels.
Les années 1945-1990 en France ou les dernières décennies en Chine ou aux États-Unis montrent comment il a été possible tout à la fois d’ouvrir des options, d’explorer des voies nouvelles et de déployer massivement et rapidement des technologies adaptées aux enjeux des pays concernés. Sur ces sujets énergétiques qui engagent la prospérité et la souveraineté des pays, ces exemples illustrent bien le rôle majeur joué par des États dans la maîtrise des conditions de la réussite industrielle, y compris dans la diversité des voies possibles en fonction des institutions et des traditions des différents pays. La capacité des États à assumer leur rôle afin de permettre la mobilisation de tous les acteurs semble déterminante. Ceci suppose de pouvoir nommer clairement nos faiblesses, si possible avant de connaître une situation trop dégradée, et de le faire en se laissant interpeller par notre passé ou par d’autres expériences actuelles. Les compétences et les bonnes volontés ne manquent pas. Elles pourraient permettre de réformer en profondeur le secteur et de préparer la décennie qui vient à condition qu’une vision politique soit commune aux acteurs.
Sortir des idées reçues
Le récit habituel
Pour comprendre l’histoire du nucléaire français, il faut accepter de remettre en cause le récit habituel, généralement exprimé de la façon suivante :
- le programme se décide en 1974-1975 en réaction à un événement : le premier choc pétrolier de 1973 ;
- il se réduit à une décision prise entre un tout petit nombre de décideurs politiques : l’abandon de la filière nationale de centrales à l’uranium naturel graphite gaz (UNGG) au profit de la filière Westinghouse de centrales à l’uranium enrichi et l’eau légère ;
- il est réalisé grâce au simple transfert du savoir-faire américain sans avoir eu besoin de se confronter à la « frontière technologique » ;
- il illustre la tradition française – et le « génie français » – de l’intervention colbertiste de l’État dans l’économie par de grands programmes.
Une histoire différente
La lecture de l’histoire défendue ici est différente. L’image projetée par le récit habituel est trompeuse, car les affirmations qui le construisent traduisent une profonde méconnaissance de ce qu’est une industrie de haute technologie comme le nucléaire.
Tout d’abord, la décision de s’appuyer sur un programme nucléaire civil est un objectif clair dès le début des années 19605, malgré la baisse des prix du fioul lourd sur cette décennie. Cette décision procède d’une vision partagée de la sécurité d’approvisionnement du pays à long terme et des perspectives de compétitivité du nucléaire au vu des premiers démonstrateurs industriels.
Par ailleurs, la nécessité d’avoir plusieurs fers au feu, dont l’eau légère, et d’essayer plusieurs filières est à l’œuvre dès 1958 avec la décision de construire Chooz A, prototype franco-belge sur la base de la première génération des réacteurs à eau pressurisée de Westinghouse, prise par le général de Gaulle dès son retour au pouvoir en 1958. Cette décision vient en complément des démonstrateurs UNGG engagés à Chinon entre 1957 et 1961.
Il faudra attendre 1975 pour renoncer à la filière eau bouillante de General Electric, portée en France par la Compagnie générale d’électricité (CGE) d’Ambroise Roux, et se concentrer sur la seule filière eau pressurisée de Westinghouse, non sans regrets pour les acteurs qui souhaitaient conserver une émulation entre au moins deux fournisseurs pour les composants clés. La décision d’abandonner l’UNGG et de faire une première série de réacteurs à eau pressurisée (REP) est prise au moment où les prix du fioul lourd sont encore au plus bas entre 1969 et 1971 ; c’est alors qu’est décidée la construction de deux tranches à Fessenheim et de deux tranches au Bugey, d’où leur mise en service dès 1977 et 1978. Ces décisions ont été prises par Georges Pompidou, dès le début de son mandat de président de la République.
Westinghouse n’aurait jamais accepté de coopérer avec les Français ni permis la francisation de la licence si la France n’avait pas montré l’excellence de ses compétences industrielles, en particulier dans la fabrication des cuves au Creusot, et l’excellence des compétences scientifiques du CEA qui travaillait non seulement sur l’UNGG, mais aussi sur les REP pour la propulsion militaire. Entre 1950 et 1970, la France était bien parvenue à la frontière technologique par elle-même, et c’est probablement ce qui a permis d’utiliser avec succès la technologie Westinghouse.
Enfin, le rôle clé de l’État dans la maîtrise et le déploiement du nucléaire n’a rien de spécifiquement français. Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’exemple américain avec le programme de l’amiral Rickover, initialement focalisé sur la propulsion militaire, et mobilisant ensemble des grands laboratoires fédéraux américains (analogues au CEA) avec Westinghouse et General Electric (le CEA, puis EDF mobiliseront aussi les grands industriels français les plus capables d’abord sur l’UNGG, puis sur les REP). Le Royaume-Uni, le Canada, la Chine, le Japon ou la Corée du Sud pourraient illustrer également, chacun à leur manière, ce rôle de l’État stratège, impliqué dans les dimensions scientifiques et industrielles. Ajoutons que si, en France, l’État a joué auparavant un rôle d’impulsion dans le développement de certains grands réseaux, comme les chemins de fer6, dont atteste par exemple le plan Freycinet de 1879, et un rôle important dans la réglementation technique de certains secteurs industriels, tel le contrôle technique des forges, la France des années 1830-1940 est d’abord un pays libéral en matière économique et industrielle, conformément à l’héritage de la Révolution française.
La transition rapide de la France
De 1945 à 1990, la France a donc réussi une transition parmi les plus rapides dans les technologies de l’énergie, de la recherche fondamentale au déploiement industriel. La découverte de la fission et de la réaction en chaîne date des années 1930, avec les travaux d’Enrico Fermi, Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Strassmann, puis de Frédéric Joliot-Curie, avec Hans Halban et Lew Kowarski en 1939. C’est sur la base de ces derniers travaux que le CEA va faire l’apprentissage des différentes filières nucléaires – UNGG, eau lourde, réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, réacteurs à eau légère – et réaliser des prototypes, en particulier sur la filière UNGG, dans les années 1950 et au début des années 1960. Le CEA et EDF seront alors en mesure de réaliser ensemble, dans les années 1960, des démonstrateurs à l’échelle industrielle dans la filière graphite gaz (Chinon A1, A2 et A3) et dans la filière REP (Chooz A puis Tihange), avec nos partenaires belges sur la base de la filière Westinghouse. Il faudra ensuite seulement vingt ans, entre 1970 et 1990, pour déployer massivement le parc nucléaire et produire les trois quarts de l’électricité pour la France, avec, comme nous l’avons vu, des performances bien meilleures en termes de coûts que celles des États-Unis, de l’Angleterre, de l’Allemagne ou du Japon sur des technologies analogues au même moment.
Ce furent des défis particulièrement difficiles à relever. Des obstacles successifs ont dû être franchis avec persévérance, les uns après les autres. Les défis ont différé selon les périodes et les circonstances, qu’il s’agisse du moment de la recherche et des prototypes (1945-1960), du moment des démonstrateurs industriels et du choix de la filière à déployer (1960-1971), puis du moment du déploiement massif (initié en 1972-1975 et qui ira jusqu’en 1990 pour l’essentiel). Il a fallu penser d’emblée en termes de système industriel, avec la maîtrise de l’ensemble du cycle du combustible, de la mine au retraitement et à la gestion des déchets, avec la fabrication du combustible, ainsi qu’avec l’enrichissement de l’uranium nécessaire dans les technologies à eau légère, et la maîtrise du réacteur et de ses composants clés : pièces forgées du primaire, thermohydraulique et neutronique, sciences des matériaux, automatismes et contrôle-commande, groupe turbo-alternateur, génie civil…
Le terme de « filière nucléaire » peut être trompeur, car il s’agit en fait de mobiliser des compétences et des métiers très divers relevant de différentes filières industrielles, avec des exigences de qualité particulièrement fortes dans la mesure où la sûreté est dans ce cas évidemment un point central. Il a également fallu affronter et résoudre de nombreux problèmes techniques au moins aussi délicats que ceux que nous connaissons depuis une quinzaine d’années sur la mise au point des réacteurs de troisième génération comme l’EPR en France et en Finlande, ou l’AP 1000 aux États-Unis. La réactivité la détermination des collectifs de scientifiques et d’ingénieurs ont été remarquables pour proposer des « solutions de réparation », tout en gardant toujours la capacité à ouvrir en même temps d’autres options techniques (enceinte en acier ou en béton précontraint…), jusqu’à des voies plus radicales, comme l’exploration d’autres filières. Enfin, au-delà de la gestion efficace des échecs techniques récurrents qui sont une caractéristique incontournable de ces grands projets technologiques, le contexte international et politique a été particulièrement chahuté : la guerre froide à partir de 1947, la décolonisation, la crise de Suez en 1956, la création de la Communauté économique européenne (CEE) et du traité Euratom en 1958, la crise de Mai-68 ou encore les chocs pétroliers de 1973-1974 après une longue période de baisse des prix du fioul lourd. Les coopérations internationales ont dû se frayer un chemin en tenant compte des enjeux géopolitiques et de souveraineté. C’est ce dont témoignent l’opposition des États-Unis à toute coopération dans le domaine nucléaire, avec la loi McMahon de 1946, la crise de Suez qui a mis en évidence la vulnérabilité d’une France ne maîtrisant pas le nucléaire ou encore les opportunités ouvertes par le traité Euratom.
La principale interrogation que nous voulons ici mettre en évidence porte sur cette étonnante capacité de rebond au fil du temps, une capacité à réaliser des changements en adoptant une vision systémique, avec le souci d’une mise en œuvre rapide, afin de garder le cap fixé concernant le développement d’une industrie nucléaire. Il s’agit donc de repérer les traces de ce travail collectif, de l’État avec ses composantes politiques et leurs appuis – les conseillers, l’administration, le Plan –, mais aussi du CEA et d’EDF, du tissu industriel et des partenaires internationaux. Il importe de comprendre les ressorts de cette efficacité dans la longue durée. Ce regard sur le passé doit nous aider à déterminer quelle organisation et quelles compétences industrielles au cœur de l’appareil d’État, quelles relations entre celui-ci et le tissu industriel privé, quelles stratégies de coopération internationale ont permis d’élaborer une vision commune, de long terme dont nous pourrions nous inspirer pour prendre à notre tour les décisions nécessaires au fil du temps.
Le détour par l’histoire : 1945-1975
De 1945 à 1960, de la science aux prototypes : le rôle central du CEA l’apprentissage d’EDF et du tissu industriel
Dans cette partie, on s’appuie en particulier sur l’ouvrage déjà cité de Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres ainsi que sur les entretiens menés avec les acteurs du programme nucléaire dans le cadre du projet de leur livre, sur le livre de Georges Lamiral, Chroniques de trente années d’équipement nucléaire à Électricité de France, Association pour l’histoire de l’électricité en France (AHEF), 2 vol., 1988, et sur le livre de Dominique Grenèche, Histoire et techniques des réacteurs nucléaires et de leurs combustibles, EDP Sciences, 2016.
Les États-Unis vont progressivement ouvrir la possibilité de coopération avec les pays européens à partir de la fin des années 1950, mais toujours sous conditions restrictives de la souveraineté et de la maîtrise industrielle des pays concernés.
Malgré leurs réserves, il y aura des contacts avec les États-Unis sur certains sujets scientifiques et industriels. Par ailleurs, il est clair que, dans ce contexte, le programme nucléaire civil avec les UNGG a également été particulièrement soutenu en lien avec le programme militaire. Les compétences du CEA développées sur les réacteurs à eau pressurisée pour la propulsion ont aussi été précieuses.
On peut souligner le caractère multi-partisan de cette volonté et du rôle d’animation, pour ne pas dire de leadership, que doit jouer l’État dans cette perspective, qui s’est traduite par la création du Commissariat général du Plan ou celle du CEA ou d’EDF. Le Front populaire avait déjà, pour une part dans cet esprit, tenté d’organiser la recherche française – le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sera créé un peu plus tard, en octobre 1939 – et engagé une politique de réarmement.
Voir Bertrand Goldschmidt, Le Complexe atomique. Histoire politique de l’énergie nucléaire, Fayard, 1980, p. 71.
Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 38.
Charles de Gaulle, « Discours du 14 juin 1960 », archives de l’INA, ina.fr.
Voir Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 56.
Voir Henri Morel (dir.), Histoire de l’électricité, Fayard, 1996, t. 3, p. 143 sqq.
Voir Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 68.
Le contexte et les enjeux7
Les deux guerres mondiales furent pour une grande part un affrontement entre des puissances industrielles et énergétiques. Dans ses écrits parus dans les années 1930, le futur général de Gaulle pressentait déjà l’importance des chars et des avions pour la puissance des armées, préconisant une doctrine d’emploi novatrice, et, plus largement par la suite, en 1940, prévoyant un conflit dont l’issue serait dominée par l’entrée en scène de la grande puissance industrielle et énergétique américaine. Après la guerre, les élites politiques, administratives et industrielles françaises, pour une large part issues de la Résistance et de la France Libre, entendaient rattraper le retard scientifique, industriel, économique de la France, conséquence de la crise des années 1930 et des destructions de la guerre. Les responsables avaient aussi conscience de l’impératif d’une sécurité d’approvisionnement en énergie et à des coûts maîtrisés. Dépourvue de pétrole, la France souffrait depuis le XIXe siècle d’une faible dotation en charbon bon marché, à la différence du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou des États-Unis. Sa sidérurgie a longtemps fonctionné grâce au charbon de bois des forêts françaises et à l’hydraulique « mécanique » permis par les cours d’eau. Puis la « houille blanche », l’eau, est devenue un impératif national dans l’entre-deux-guerres et dans les années 1950 et 1960, avec les grands programmes hydroélectriques qui ont permis de produire environ la moitié de l’électricité sur cette période, mais qui se sont progressivement ralentis en raison de la limitation du nombre de sites.
Dès 1945-1950, l’énergie nucléaire est donc un objectif à long terme, porté par des hommes politiques comme Félix Gaillard ou Gaston Palewski. Très vite, on s’interroge sur la présence de mines d’uranium sur le territoire national. Les réserves limitées perçues dans la première étape de l’histoire du nucléaire civil et l’attente de découvertes de nouveaux gisements amènent, dès l’après-guerre, à travailler sur des prototypes de surgénérateurs pour utiliser non seulement l’uranium 235 (0,7% de l’uranium naturel) mais aussi tout le potentiel d’uranium 238 (99,3% de l’uranium).
Les États-Unis, largement dotés en pétrole et en charbon, lancent alors un programme de réacteurs nucléaires, d’abord conçus pour la propulsion militaire. L’amiral Rickover va faire travailler les laboratoires fédéraux américains avec les grands industriels de l’électricité, General Electric et Westinghouse, afin de mettre au point les filières à eau légère qui doivent permettre de faire des réacteurs plus simples et robustes mais exigeant la maîtrise de l’enrichissement, qui est alors l’apanage des États-Unis. Ceux-ci, dans le contexte de l’émergence progressive de la guerre froide, vont mettre un embargo à tout transfert technologique sur le nucléaire avec la loi McMahon de 1946, avec quelques exceptions pour leurs partenaires anglais et canadiens du projet Manhattan8.
La France doit donc démarrer presque seule9 De plus, à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, le pays a pris du retard, comme le Royaume-Uni, dans la course pour la révolution industrielle de l’électricité par rapport aux États-Unis et à l’Allemagne, malgré une recherche et des scientifiques de haut niveau. Son tissu industriel est fragmenté et souvent dépendant de licences américaines. Il faut donc s’appuyer au début essentiellement sur des entités publiques à caractère scientifique et industriel : le CEA, puis EDF. Le Royaume-Uni, pour les mêmes raisons, s’appuie sur l’United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), l’équivalent du CEA, et sur le Central Electricity Generating Board (CEGB), l’équivalent d’EDF. Nos voisins britanniques sont également préoccupés par le coût de plus en plus élevé de son charbon et par les enjeux de sécurité d’approvisionnement en pétrole. Le Royaume-Uni est donc particulièrement motivé par le nucléaire civil et il va développer sa filière nationale Magnox, graphite-gaz analogue à la filière UNGG française, plus vite encore que la France : le premier prototype de réacteur est mis en service à Calder Hall en 1956, quelques mois avant le premier prototype de réacteur du CEA G1 à Marcoule, et la puissance installée en Magnox sera d’environ 5 000 MW en 1970, deux fois plus que les UNGG français.
Le politique : vision à long terme et décisions structurantes
Informés par les scientifiques et les industriels, et à l’écoute du contexte international, les politiques vont alors prendre d’importantes décisions sous la IVe République et au début de la Ve République. Pour eux, le mix énergétique et électrique de la France doit lui permettre d’accéder au rang de puissance industrielle et économique et lui assurer l’autonomie stratégique et la souveraineté10.
En juillet 1944, lors d’une visite à Ottawa, le général de Gaulle est informé de la portée des travaux menés sur les piles atomiques et sur la bombe nucléaire par Pierre Auger, Jules Guéron et Bertrand Goldschmidt, les scientifiques français impliqués dans ces études11. Après des interactions avec Raoul Dautry et Frédéric Joliot-Curie, et un dossier remis par Raoul Dautry au chef du gouvernement provisoire, le général de Gaulle crée le CEA par ordonnance, en octobre 1945, avec pour missions la recherche, le nucléaire civil et les applications militaires : l’objectif est de « poursuivre les recherches scientifiques et techniques en vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans divers domaines de la science, de l’industrie et de la Défense nationale12 ». Revenu au pouvoir en 1958, le Général va accélérer les travaux de la filière UNGG et il accepte le projet de réacteur à eau légère sous licence américaine dans le cadre du traité Euratom qui vient d’être mis en place (à la double condition que le réacteur soit situé en France et que EDF en détienne 50%). Son allocution radiotélévisée du 14 juin 1960 traduit bien sa vision des enjeux industriels et énergétiques pour la France : « Étant le peuple français, il nous faut ou bien accéder au rang d’un grand État industriel ou bien nous résigner au déclin. Notre choix est fait. Notre développement est en cours. […] Naturellement, c’est à la doter [la France] des sources d’énergie qui lui manquaient que d’abord nous nous appliquerons. […] Énergie atomique que des installations modèles ont commencé à fournir13. »
Félix Gaillard, résistant et député radical-socialiste en 1946, s’intéresse à l’énergie atomique. Il visite le CEA et discute longuement avec Frédéric Joliot-Curie. Secrétaire d’État à la présidence du Conseil en 1951, Félix Gaillard est chargé des questions nucléaires. En juillet 1952, il présente aux députés le premier plan quinquennal nucléaire qui donne les moyens au CEA et à son administrateur général Pierre Guillaumat pour passer au stade des premiers prototypes (G1, suivi de G2 et G3 à Marcoule) et à la mise en place des premiers éléments du cycle du combustible.
Félix Gaillard est ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan quand le deuxième plan quinquennal nucléaire est adopté, en juillet 1957, à une large majorité. Ce plan préconise d’atteindre une puissance installée de 850 MW en 1965 et de 2 500 MW en 1970, ce qui sera pratiquement fait. Président du Conseil de novembre 1957 à mai 1958, il donne en mars 1958 le feu vert pour construire à Pierrelatte une usine d’enrichissement d’uranium à des fins militaires. L’attitude des Américains lors de la crise de Suez et dans l’OTAN pousse la France à accélérer les travaux sur le nucléaire militaire afin de garantir son autonomie stratégique. La décision est importante. Elle ouvrira la voie à l’utilisation des réacteurs à eau légère en gardant la maîtrise du combustible une décennie plus tard14.
Gaston Palewski, ancien chef de cabinet de Paul Reynaud et gaulliste historique est, en 1955, ministre délégué à la présidence du Conseil, chargé de la Coordination de la défense nationale, de la Recherche scientifique, des Affaires atomiques et des Affaires sahariennes. Il va, avec son gouvernement, augmenter les dotations du CEA pour passer à la vitesse supérieure sur les UNGG et sur la propulsion nucléaire. Le 21 avril 1955, il crée la commission pour la Production d’électricité d’origine nucléaire (commission PEON), qui jouera un rôle important jusqu’aux années 1980. Elle réunit les représentants du Plan, de l’État (ministère de l’Économie et des Finances, ministère de l’Industrie…), du CEA et d’EDF au plus haut niveau. Il s’agit d’examiner les dimensions économiques des moyens de production d’électricité, puis de proposer des orientations concernant la politique nucléaire française.
Le CEA, principal artisan du passage de la science à l’industrie
Dès ses origines, le CEA va s’appuyer sur une équipe de grands scientifiques dans le domaine de la physique nucléaire, tels Frédéric Joliot-Curie, Francis Perrin, Bertrand Goldschmidt ou encore Pierre Auger. Il va d’emblée constituer des équipes de chercheurs de haut niveau dans l’ensemble des disciplines nécessaires, avec des compétences fortes en neutronique, physique mathématiques, métallurgie, chimie, automatique… Le département « Étude de piles » est plus particulièrement en charge de la conception des futurs réacteurs, avec des personnalités comme Jacques Yvon, Jules Horowitz, Georges Vendryes et Jean Bourgeois, lequel sera un acteur important pour l’élaboration et la prise en compte des enjeux de sûreté de la conception à l’exploitation. Avec ces compétences scientifiques de haut niveau, la France pourra presque faire jeu égal avec les États-Unis. En revanche, le passage au stade industriel est plus délicat.
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, la France n’a pas su faire émerger de grands acteurs industriels, à l’image de General Electric et de Westinghouse, capables de maîtriser la conception de systèmes complexes tels que de nouvelles centrales nucléaires, même si un grand patron comme Charles Schneider (Creusot-Loire et groupe Schneider) a compris l’importance du sujet.
De façon plus générale, à la suite de la longue crise économique des années 1930 puis de la guerre, on doit partir d’un tissu industriel français certes presque complet et qui « sait faire par expérience » mais fragmenté et artisanal, en retard sur les techniques, avec de faibles capacités d’études, peu de liens avec le monde scientifique et souvent dépendant de licences américaines. Pierre Guillaumat, polytechnicien et ingénieur du corps des Mines, engagé dans la Résistance, va s’attaquer à ce problème comme administrateur général du CEA de 1951 à 1958. Le CEA va alors accueillir dans ses équipes des ingénieurs de l’industrie et d’EDF, et les former au génie atomique. Pierre Guillaumat crée également une direction industrielle au CEA en 1952 pour réaliser les premiers prototypes d’UNGG G1, G2 et G3 à Marcoule, et appelle Pierre Taranger, issu du secteur pétrolier, à la tête de cette direction industrielle.
L’enjeu pour le CEA – comme ensuite pour EDF – est bien de traiter dès cette première phase deux échecs de marché (« externalités négatives ») en mettant en place deux modes de coordination clés pour l’innovation et l’efficacité économique dans la durée :
- rapprocher scientifiques, bureaux d’études et usines ;
- faire travailler ensemble des entreprises industrielles appartenant à des domaines de compétences techniques très variés pour concevoir et construire ces systèmes complexes et exigeants en termes de sûreté et de qualité que sont les centrales nucléaires et le cycle du combustible associé.
Au sein même du CEA, Pierre Guillaumat va donc faire travailler des scientifiques de haut niveau avec des industriels et former des générations d’ingénieurs de l’industrie, et le CEA va faciliter la formation de groupements industriels et leur montée en compétences en s’appuyant sur les points forts de l’industrie française : Pechiney et la maîtrise du graphite pur, Saint-Gobain et la chimie du retraitement, Le Creusot avec ses compétences en métallurgie et ses forges. Responsable de la réalisation de cette première génération de réacteurs, le CEA va également préparer la maîtrise technique de l’ensemble du cycle, en particulier l’enrichissement de l’uranium, important à court terme pour la propulsion nucléaire et l’arme atomique, et à plus long terme pour s’ouvrir l’option eau légère pour le nucléaire civil, en mobilisant des ingénieurs des poudres (Georges Fleury, Claude Fréjacques) et en recrutant Georges Besse (polytechnicien et ingénieur du corps des Mines) en 1952, précisément pour travailler sur l’enrichissement de l’uranium. Georges Besse sera en charge de Pierrelatte dans les années 1960, puis d’Eurodif dans les années 1970.
Avec la maîtrise technique et économique, l’enjeu pour le CEA est aussi, bien sûr, d’assurer la souveraineté industrielle. Assurer cette souveraineté impose durant ces premières années d’être seuls sur la frontière technologique, tant dans le domaine civil que militaire, en raison de l’attitude des États-Unis. Mais la maîtrise recherchée est aussi un objectif dans la durée si l’on veut garantir l’autonomie stratégique et la sécurité d’approvisionnement. Sans exclure des coopérations internationales, y compris dans les domaines sensibles, cela suppose de maîtriser, pour le cycle du combustible, les mines d’uranium – on va trouver des gisements en France et les exploiter, en particulier dans le Limousin –, la fabrication du combustible, la chimie nucléaire sophistiquée du retraitement – Bertrand Goldschmidt au CEA et Saint-Gobain – et, à terme, l’enrichissement de cet uranium. Cela suppose également de maîtriser quelques maillons industriels clés pour la centrale : la fabrication du graphite pur, le contrôle-commande, ainsi que la métallurgie des cuves-caissons qui suppose des forges de qualité, la maîtrise de la science des matériaux et des techniques de soudure. Les équipes du Creusot sauront aussi faire appel à l’expertise de l’armement, avec en particulier les compétences de la fonderie d’Indret et l’expérience d’Yvon Bonnard, ingénieur du génie maritime.
L’apprentissage d’EDF, préparer avec les acteurs industriels le passage au démonstrateur à l’échelle industrielle en s’ouvrant des options : UNGG-eau légère
Lors de la nationalisation de l’électricité, les responsables d’EDF sont également habités par l’« ardente obligation » de permettre la reconstruction et la prospérité du pays grâce à une électricité économique, contribuant à la sécurité d’approvisionnement du pays. C’est leur mission principale. De 1946 à 1957, Pierre Ailleret, polytechnicien, ancien élève de l’École nationale des ponts et chaussées et de Supélec, est le directeur de la direction des Études et Recherche d’EDF qu’il va contribuer à créer, avant de devenir directeur général adjoint d’EDF, de 1958 à 1968. C’est un homme du métier, qui a été responsable de chantiers hydrauliques et de la construction de réseaux d’interconnexion. Convaincu de l’importance des avancées scientifiques pour l’énergie, il suit avant la guerre les cours de physique nucléaire de Jean Perrin, et il va pousser la direction des Études et Recherches à ne pas se contenter d’appuyer les autres directions d’EDF sur leurs enjeux opérationnels à court terme mais à ouvrir toutes les pistes possibles de voies nouvelles concernant l’énergie en se rapprochant du monde scientifique et en s’ouvrant à l’international : énergies éolienne, marémotrice, thermique des mers, turbines et compresseurs à gaz… et le nucléaire15.
Nommé en 1950 au conseil scientifique et au comité (conseil d’administration) du CEA16, Il envoie des jeunes ingénieurs d’EDF, comme Denis Gaussot, futur directeur du Service d’études et projets thermiques et nucléaires (Septen), puis directeur adjoint de l’Équipement, se former au CEA à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). Il suggère en 1953 que l’on fasse de l’électricité à partir de la vapeur de G1 à Marcoule, et la décision est prise par le CEA d’en confier la responsabilité à EDF.
Le déploiement massif du nucléaire au moment où sa maturité économique sera acquise devra être de la responsabilité d’un industriel comme EDF, et non d’un organisme scientifique comme le CEA. En revanche, la question se pose de la responsabilité de l’étape intermédiaire des démonstrateurs industriels UNGG entre les étapes des prototypes G1, G2, G3 de Marcoule (mis en service à la fin des années 1950) et du déploiement à plus long terme. La discussion est d’abord difficile entre le CEA et EDF, mais Pierre Taranger, du CEA, est convaincu qu’EDF sera le mieux placé pour augmenter significativement les tailles unitaires et prendre des risques sur des solutions innovantes qui permettront de tester vraiment le potentiel économique de la technologie et d’obtenir ainsi les gains nécessaires lors du déploiement.
En 1954, la décision est prise rapidement entre Pierre Guillaumat et Roger Gaspard (directeur général d’EDF) : EDF sera le maître d’œuvre et l’exploitant des trois tranches de Chinon : Chinon A1, engagé en 1957, 70 MW ; Chinon A2, en 1959, 210 MW ; Chinon A3, en 1961, 460 MW. Le CEA est responsable de la partie nucléaire et les deux entités doivent travailler ensemble sur tous les sujets. EDF va assumer son rôle d’architecte industriel maître d’œuvre sur le mode « hydraulique » non standardisé, avec une adaptation du dimensionnement de l’ouvrage à la géographie du site, ainsi qu’une liberté de choix des fournisseurs donnée à chaque région d’équipement d’EDF. C’est d’ailleurs encore largement le cas dans le thermique classique où, si l’on a bien une politique de paliers dont les tailles sont standardisées – 125 MW, puis 250 MW, avant les 600 MW charbon et fioul, et les 700 MW fioul –, les régions d’équipement d’EDF sont très autonomes concernant l’adaptation aux sites et le faisceau de contrats et de fournisseurs industriels. Cette décentralisation de la direction de l’équipement, pour une part héritée de l’histoire fragmentée du secteur électrique avant la nationalisation de 1946, s’accompagne d’une mise en concurrence forte des fournisseurs sur la base de découpage en centaines de lots. On retrouve là aussi l’héritage d’un tissu industriel peu concentré, qu’il va falloir continuer à faire monter en compétence et en capacité de prendre la responsabilité de sous-systèmes plus vastes.
Le contexte international évolue et les acteurs français vont se mettre en capacité de réagir rapidement pour tirer parti des circonstances favorables. Les Américains changent d’attitude et, à la fin des années 1950, se montrent favorables à des coopérations avec les alliés européens dans le nucléaire civil ; ils sont prêts à fournir le combustible enrichi nécessaire pour utiliser les nouvelles technologies à eau légère et les premiers démonstrateurs industriels stationnaires sont alors mis en service aux États-Unis : pour la filière eau pressurisée, la centrale de Shippingport de 60 MW est mise en service fin 1957 (dérivée directement du sous-marin Nautilus), et Yankee Rowe (170 MW), d’où sera issu le design de Chooz A, est mise en service en 1960. C’est la toute première génération du nucléaire civil aux États-Unis.
La Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) est créée par un traité spécifique signé à Rome, en même temps que celui instaurant la CEE en 1957, et entre en vigueur en janvier 1958. Elle vise à favoriser les coopérations européennes dans le cadre du nucléaire civil. Du début 1958 à février 1959, elle sera présidée par Louis Armand, polytechnicien et ingénieur du corps des Mines, résistant, directeur général, puis président de la SNCF, grand ingénieur, professeur à l’École nationale d’administration (ENA) sur les enjeux industriels et énergétiques de 1945 à 1967.
Les Belges sont particulièrement intéressés par la technologie eau légère. Ils souhaitent la mettre en œuvre avec les Français. EDF, en particulier Pierre Ailleret, a une forte implication dans les associations internationales – Conférence internationale des grands réseaux électriques (Cigre), Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique (Unipede), Conseil mondial de l’énergie (CME)… Raymond Giguet, ancien directeur de l’Équipement et à l’origine, avec Pierre Massé, de la Note bleue, un outil économique d’aide au choix d’investissements, directeur général adjoint d’EDF, est très favorable à cette option en plus de l’UNGG, compte tenu de la simplicité et de la robustesse de sa conception. Pierre Ailleret, tout en étant plutôt partisan au sein d’EDF de l’UNGG, est lui aussi partant pour regarder de plus près les solutions américaines séduisantes mises au point par General Electric et Westinghouse. Les ingénieurs de Creusot-Schneider, qui s’intéressent beaucoup au nucléaire, sous l’impulsion de Charles Schneider et de l’ingénieur Maurice Aragou, sont un peu sceptiques quant à la qualité des premières réalisations américaines (à juste titre), mais sont prêts à s’investir compte tenu de la relation historique forte avec Westinghouse dont ils détiennent déjà nombre de licences dans plusieurs domaines.
La Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) est constituée en 1960 par EDF et plusieurs électriciens belges pour la construction et l’exploitation de la centrale en se mettant dans le cadre Euratom. Le général de Gaulle donne son accord de principe à condition que le site soit localisé en France et que EDF en soit propriétaire à 50% et en assure l’exploitation. Un consortium est constitué en 1959, pour répondre à l’appel d’offres lancé par la SENA, afin d’exploiter la licence Westinghouse, sur le modèle de la centrale de Yankee Rowe, aux États-Unis, et en visant une puissance installée de 250 MW : Framatome, une société franco-américaine de construction atomique présidée par Maurice Aragou (de Creusot-Schneider), et au départ détenue à 60% par Schneider, à 30% par Empain et à 10% par Westinghouse. Le consortium gagne l’appel d’offres et le génie civil démarre en 1962. Tout cela va permettre à EDF de faire ses premiers pas, avec les Belges, dans la filière à eau pressurisée et d’expérimenter des rapports contractuels et techniques différents avec les industriels responsables des grands systèmes de la centrale.
De 1960 à 1971, des démonstrateurs industriels au choix de la filière à déployer
Il s’agit d’une rupture nette d’un matériau sans déformation plastique macroscopique sous l’action d’une contrainte et dans certaines circonstances spécifiques (existence d’un défaut, conditions de température-pression, etc.).
Voir Georges Lamiral, op. cit., vol. 1, p. 87-88.
Voir Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 137.
Siemens et AEG sont traditionnellement liés à Westinghouse et General Electric, et capables de construire des centrales.
Georges Lamiral, op. cit., vol. 1, p. 355-356.
Ibid., p. 145-146.
Bernard Esambert restera en fonction en 1968 avec Maurice Couve de Murville comme Premier ministre, puis rejoindra Georges Pompidou devenu président de la République en juin 1969. Il jouera un rôle important dans les grands programmes industriels de cette période impulsés par Georges Pompidou (voir Bernard Esambert, Pompidou, capitaine d’industries, Odile Jacob, 1994).
Voir Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 165-166.
Voir la note au Plan de Jacques Lacoste et la lettre d’André Decelle évoquées plus haut.
Voir Boris Dänzer-Kantof et Félix Torres, op. cit., p. 165-166
Les doutes et les débats entre ingénieurs et industriels
Cette longue décennie de construction de démonstrateurs industriels sous la responsabilité d’EDF et avec une forte implication industrielle du CEA sur la partie nucléaire illustre les défis techniques et industriels qu’il faut affronter. Les problèmes techniques vont être récurrents et importants, avec des conséquences significatives sur les durées de construction et les indisponibilités des tranches les premières années. C’est particulièrement le cas sur les trois tranches UNGG de Chinon, mais aussi pour Chooz A.
Une fissure d’une dizaine de mètres de longueur se développe brutalement sur le caisson en acier (les suivants seront en béton précontraint) lors de la construction de la centrale de Chinon A1 en février 1959, avec les caractéristiques du phénomène de « rupture fragile17 ». On mobilise Yvon Bonnard, ingénieur en chef du génie maritime, qui sollicite les compétences du laboratoire de métallurgie de la Marine nationale, à Indret. Des problèmes similaires apparaissent également aux États-Unis sur les cuves en acier de grande taille des centrales à eau légère au début des années 1960 et les solutions trouvées vont permettre de monter significativement les tailles unitaires des filières à eau légère.
Au début de son fonctionnement, Chinon A3 va connaître une série d’incidents qui vont empêcher la visite prévue par le général de Gaulle à l’automne 1966 et repousser de deux ans sa mise en service. Ces incidents sont en particulier liés à la complexité du système de manutention du combustible et de détection de rupture de gaine des combustibles avec une mauvaise conception de l’installation (insuffisante prise en compte des dilatations et contraintes thermiques des tubes en acier inoxydable utilisés pour les prélèvements nécessaires pour détecter les ruptures de gaines)18.
Chooz A va aussi connaître plusieurs incidents sérieux qui vont repousser de deux ans sa mise en service (1970 au lieu de 1967-1968) avec en particulier des vis d’assemblage du cœur du réacteur qui se sont desserrées en raison de vibrations provoquées par le flux hydraulique19.
Grâce à la qualité de l’organisation et des coopérations industrielles et techniques entre les acteurs industriels (EDF, CEA, fournisseurs et bureaux d’études), et aux compétences constituées durant la décennie qui précède, ces problèmes multiples sont l’occasion de progresser collectivement dans la compréhension des phénomènes physiques et dans la capacité à trouver et à mettre en œuvre rapidement des solutions. Mais la filière UNGG apparaît très compliquée comparée aux centrales à eau légère (cf. le système de déchargement-rechargement en continu d’une myriade d’éléments combustibles), et, avec des cuves déjà de très grandes tailles (avec le graphite comme modérateur pour pouvoir utiliser l’uranium naturel), il semble a priori très difficile de monter les tailles unitaires au-delà de 500 MW (les REP sont plus compacts pour une même puissance installée).
En 1964, la décision de principe de déployer massivement l’UNGG dans la décennie est cependant actée en conseil restreint à Matignon, sous la présidence de Georges Pompidou, alors Premier ministre. Le prix du fioul est encore élevé, les leçons des difficultés de l’UNGG ne sont pas encore analysées collectivement et les performances des premières centrales américaines à eau légère ne sont pas excellentes. Les trois tranches UNGG Saint-Laurent-des-Eaux A1 et A2 et Bugey 1 (de 500 à 550 MW) sont engagées en 1964 et 1965, et ce seront les dernières en France.
Un an plus tard, lors de la réunion-programmes CEA-EDF du 14 décembre 1965, sous la présidence de l’administrateur général Robert Hirsch et du haut-commissaire du CEA Francis Perrin, du directeur général André Decelle et du président d’EDF Pierre Massé, Francis Perrin et André Decelle s’interrogent sur l’intérêt d’ouvrir l’option des réacteurs à eau légère au vu des éléments nouveaux rassemblés récemment. Aux États-Unis, Westinghouse et General Electric ont tiré les leçons des problèmes rencontrés dans la première génération de réacteurs et proposent aux électriciens américains, mais aussi européens, des centrales de seconde génération à des prix très attractifs (et de tailles unitaires plus importantes). Washington est prêt à proposer du combustible enrichi dans des conditions économiques intéressantes compte tenu des surcapacités américaines. C’est cette même année 1964 que le Royaume-Uni décide d’abandonner sa filière à uranium naturel (Magnox) compte tenu des coûts excessifs dans un contexte de prix du fioul à la baisse. Le gouvernement britannique va choisir la filière Advanced Gas-cooled Reactor (AGR), perfectionnement des Magnox avec un combustible d’uranium enrichi de conception différente, et les dirigeants du Central Electricity Generating Board’s (CEGB) font clairement savoir à leurs homologues d’EDF que c’est une erreur de ne pas avoir retenu plutôt les filières à eau légère américaines. Les électriciens allemands, qui démarrent avec les technologies américaines20, proposent en 1965 à EDF de réaliser ensemble une étude économique comparant UNGG et eau légère pour examiner l’opportunité de mener avec les Français un projet commun UNGG à Fessenheim. À l’issue de cette étude, l’eau légère apparaît nettement plus économique.
La question de la souveraineté des filières eau légère fait l’objet d’appréciations différentes en raison de l’évolution des données concernant deux points essentiels : l’enrichissement et la possibilité de « franciser » la licence Westinghouse. L’usine d’enrichissement militaire de Pierrelatte entre progressivement en service entre 1964 et 1967 (sous la direction de Georges Besse). Philippe Boulin, pour Creusot-Schneider et la filière eau pressurisée Westinghouse, et Ambroise Roux, pour la CGE et la filière eau bouillante de General Electric, sont convaincus que la deuxième génération, en déploiement rapide aux États-Unis et proposée aux Européens, est économiquement et techniquement plus performante. La réalisation de la cuve de Chooz A par la Société des forges et ateliers du Creusot (Sfac), du groupe Creusot-Schneider, a été une réussite industrielle. Les compétences métallurgiques des Français ont particulièrement intéressé et impressionné Westinghouse, et les Américains vont leur commander dans la foulée sept cuves de réacteurs à eau pressurisée. Les forges du Creusot auront en particulier utilisé pour la première fois la « méthode de calcul aux éléments finis » (à la pointe des méthodes de calcul scientifique et technique) et sollicité les conseils d’Yvon Bonnard pour améliorer la composition de l’acier. Comme le souligne Georges Lamiral en analysant le fonctionnement des industriels français sur cette période : « Il arrive aux Français de commettre des erreurs et de connaître des insuccès, mais une de leurs principales qualités est de savoir réagir rapidement21. » Les performances des forges du Creusot, du tissu industriel français et les compétences CEA-EDF-Framatome concernant les réacteurs à eau pressurisée rendent possible la perspective de francisation de la licence Westinghouse.
En trois années, de 1963 à 1966, les acteurs industriels français vont ainsi débattre du choix des filières dans les instances de travail collectif au plus haut niveau (commission PEON, comités EDF-CEA, etc.), de façon à la fois professionnelle et conflictuelle, et se convaincre collectivement qu’il faut ouvrir concrètement les deux options, UNGG et eau légère. La « fracture » passe au sein même d’EDF et du CEA : André Decelle, directeur général d’EDF, pousse pour l’eau légère, tandis que Pierre Ailleret, directeur général adjoint d’EDF, soutient l’UNGG. La vigueur des discussions va de pair avec leurs qualités techniques et économiques, et la prise en compte des nouvelles données internationales comme celles des enjeux industriels et de souveraineté. Leur « relative » convergence est donc plutôt rapide. Le 7 mars 1966, André Decelle (EDF) envoie une lettre à Robert Hirsch (CEA) pour lui expliciter ces interrogations. Le 4 mai 1966, le directeur général d’EDF et l’administrateur général du CEA lancent la commission Cabanius-Horowitz (du nom respectivement du directeur de l’Équipement d’EDF et du directeur des Piles atomiques du CEA), avec la mission de réaliser un rapport de synthèse comparant UNGG, eau légère (pressurisée et bouillante) et thermique fioul. Ce rapport commun EDF-CEA devra servir de base aux discussions en commission PEON, en charge de conseiller le gouvernement sur la stratégie dans le domaine du nucléaire civil. Le rapport EDF-CEA, favorable aux filières à eau légère, est remis en juin 1967, et la commission PEON préconise en avril 1968 de poursuivre la construction des UNGG avec les deux prochaines tranches à Fessenheim, et surtout de tester l’eau légère en vraie grandeur en engageant rapidement une nouvelle unité en France.
Un premier appel d’offres sur deux tranches UNGG à Fessenheim, lancé par EDF en octobre 1968, s’avère beaucoup trop cher. Il traduit la réticence des industriels à s’engager sur les performances de cette filière. Fin 1969, un second appel d’offres eau légère est lancé à Fessenheim, après le feu vert de Georges Pompidou, devenu président de la République. Framatome remettra alors une offre crédible sur le plan industriel, avec des prix compétitifs. Un appel d’offres similaire suit rapidement pour deux tranches au Bugey. Le politique va ainsi disposer, de 1967 à 1971, des éléments de souveraineté et technico-économiques nécessaires pour faire le choix de la filière nucléaire, avec des arguments convaincants pour préférer l’eau légère. Mais les centrales thermiques au fioul sont à court terme plus attractives que le nucléaire, y compris à eau légère, avec des prix du fioul toujours à la baisse. Cependant, Jacques Lacoste, conseiller de Marcel Boiteux, devenu directeur général d’EDF en 1967 après en avoir dirigé les Études économiques générales, fera une note importante et prémonitoire qu’il adressera au Plan pour souligner les risques géopolitiques à terme impliqués par la dépendance excessive de la France au pétrole, et en conséquence la nécessité de donner de la visibilité et des perspectives à la filière nucléaire. Et celle-ci n’aura pas donc d’engagement de nouvelles tranches de 1966 à 1971. Au cours de cette période, la filière sera donc l’arme au pied, dans l’attente des décisions politiques. Pour s’en convaincre, il suffit de lire la lettre du 7 novembre 1968 d’André Decelle, alors conseiller d’État, adressée à André Bettencourt, ministre de l’Industrie, proposant un plan de relance rapide pour préserver les compétences de la filière nucléaire et du tissu industriel22.
La réflexion et les décisions politiques concernant le choix des filières : 1966-1971
Entre 1966 à 1969, le point de vue du général de Gaulle va évoluer progressivement en faveur de la technique de l’eau légère. En septembre 1967, il exprime son insatisfaction vis-à-vis d’EDF face au retard et aux difficultés du programme UNGG (la visite de Chinon A3, annulée en 1966, est remplacée par celle de l’usine marémotrice de la Rance) et face aux échecs dans le déploiement du palier 250 MW thermique, liés en particulier à une standardisation insuffisante, à l’origine de dépassements de coûts et des délais de réalisation. André Decelle et Pierre Ailleret, directeur général et directeur général adjoint d’EDF, sont remplacés par Marcel Boiteux et Charles Chevrier. Georges Pompidou, renommé Premier ministre après les élections législatives du printemps 1967, est plutôt favorable à la technique de l’eau légère, contrairement à Maurice Schumann, ministre d’État chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales.
Lors du conseil interministériel du 7 décembre 1967, le général de Gaulle exprime à nouveau son insatisfaction au président d’EDF, Pierre Massé, présent sur place. Il est décidé de lancer à Fessenheim la construction de deux réacteurs UNGG et, pour garder l’option eau légère ouverte, de mettre à l’étude une usine d’enrichissement à des fins civiles qui serait indispensable pour la souveraineté du pays s’il devait utiliser de façon significative la filière eau légère. Il est également décidé d’autoriser EDF à participer à la construction avec les Belges d’une centrale eau légère de seconde génération à Tihange, en Belgique. Ce sera de l’eau pressurisée sur le modèle de Beaver Valley, retenu ensuite pour Fessenheim. Il faut savoir que l’étude d’une autre centrale à eau légère, avec les Suisses, qui devait être une centrale à eau bouillante, venait alors d’être autorisée à Kaiseraugst en juillet 1967, mais ce projet sera finalement abandonné.
En septembre 1967, Bernard Esambert, jeune haut fonctionnaire du corps des Mines, est nommé conseiller industriel du Premier ministre Georges Pompidou23. La décision prise en décembre 1967 de faire deux UNGG à Fessenheim est en décalage avec ce qui commence à être la vision presque partagée des responsables d’EDF et du CEA avec le rapport Cabanius-Horowitz. Ce sujet est complexe, très controversé et peu maîtrisé au niveau politique. Le rôle des conseillers dans les cabinets ministériels ou à l’Élysée n’est pas alors de se substituer aux services de l’État ou aux entités publiques, mais de s’appuyer sur leurs compétences en s’ouvrant à des regards externes pour donner de l’épaisseur au diagnostic et permettre aux responsables politiques d’entrer dans le fond du sujet. Ce travail permet à Georges Pompidou, ainsi qu’à quelques-uns de ses ministres qui resteront en poste avec Maurice Couve de Murville, de s’approprier le diagnostic : la filière eau légère possède le meilleur potentiel, il est désormais possible de « franciser » les technologies américaines, et si les autres Européens ne facilitent pas l’implication d’EDF sur l’ultracentrifugation pour l’enrichissement, il faudra développer une usine civile avec la technologie française de la diffusion gazeuse en proposant aux Européens intéressés de s’y associer. Georges Pompidou va faire passer ces éléments au général de Gaulle, sans retour positif. Il quitte ses fonctions début juillet 1968 (Maurice Couve de Murville devient alors Premier ministre), mais reviendra comme président de la République en juin 1969 avec cette même conviction.
Le rapport de la commission PEON remis en avril 1968 au gouvernement souligne l’intérêt de l’eau légère par rapport à l’UNGG, il préconise d’engager en France une unité à eau légère après les deux UNGG de Fessenheim pour tester cette nouvelle génération et vérifier son intérêt pour la suite. Un conseil des ministres décisif sur ce sujet a lieu en juillet 1968, avec Maurice Couve de Murville, Premier ministre, André Bettencourt, ministre de l’Industrie, et Robert Galley, ministre délégué chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales. André Bettencourt prend le temps de rentrer dans le fond du sujet du dossier (en s’appuyant en particulier sur les éléments préparés par Roger Ginnochio, ancien directeur délégué de la production/transport d’EDF et membre de son cabinet) pour en rendre compte au général de Gaulle en conseil des ministres24. Le Général écoute avec intérêt et indique qu’il faut remettre les choses à plat et reconsidérer la décision des deux tranches UNGG à Fessenheim. À cette date, l’usine d’enrichissement de Pierrelatte est achevée.
En octobre 1968, le retour de l’appel d’offres UNGG à Fessenheim présente des clauses inacceptables et des prix trop élevés pour EDF. Les industriels se couvrent sur une technologie qui leur paraît risquée. Par ailleurs, les prix du fioul lourd sont au plus bas et très attractifs. Dans le contexte de difficultés de financement public à la suite des événements de Mai-68, il est donc tentant de surseoir à tout engagement nucléaire supplémentaire au profit du fioul pendant quelques années. Cependant, les acteurs industriels attirent l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de donner une visibilité à moyen-long terme aux industriels pour préserver les compétences en l’absence d’engagement dans de nouvelles centrales depuis 1966 et de garder l’option nucléaire prête face aux risques géopolitiques sur le pétrole25. En janvier 1969, le général de Gaulle, recevant Pierre Delouvrier au moment où celui-ci s’apprête à remplacer Pierre Massé à la présidence d’EDF, lui aurait indiqué son accord sur l’eau légère, à condition de mettre en place une usine civile d’enrichissement26.
Georges Pompidou, élu président de la République en juin 1969 et déjà convaincu en 1968 comme Premier ministre par l’intérêt de l’eau légère, décide en février 1971 de la déployer sur la prochaine décennie. Au conseil interministériel restreint du 13 novembre 1969, il décide l’abandon des deux tranches UNGG prévues à Fessenheim au vu des résultats de l’appel d’offres conduit par EDF. L’entreprise publique devra engager à Fessenheim deux tranches à eau légère, pressurisée ou bouillante.
EDF lance en février 1970 un nouvel appel d’offres pour Fessenheim auprès de Framatome-Sfac pour la technologie Westinghouse, et de CGE pour la technologie General Electric. La proposition de Framatome se fonde, comme à Tihange, sur la deuxième génération de réacteurs à eau pressurisée bien plus performante que Chooz A (sur la base du design de la centrale de Beaver Valley commandée aux États-Unis en 1967). Philippe Boulin, responsable de Creusot-Loire, fait avec son équipe le pari de proposer des prix anticipant la construction d’une série de centrales, ce qui permet de réduire les coûts. Son offre, bien meilleure que celle de CGE, est donc retenue. Un second appel d’offres suivra rapidement pour Bugey, où Framatome sera à nouveau retenu.
En novembre 1970, la commission PEON recommande d’engager de 1971 à 1975 8 000 MW nucléaire (de huit à dix tranches) en eau légère. Un conseil restreint réuni à l’Élysée le 26 février 1971 va dans ce sens, en autorisant l’engagement de trois tranches nouvelles pour 1971 et 1972. EDF se prépare pour un rythme d’engagement d’une à deux tranches par an sur la décennie, le rythme prévu par le contrat de programme signé entre EDF et l’État, à la suite du rapport Nora, étant de deux tranches par an. Cinq tranches auront été engagées sur les années 1971, 1972 et 1973, avant le premier choc pétrolier.
De 1972 à 1975, les chocs pétroliers et la préparation industrielle d’un déploiement massif et standardisé sur la filière eau pressurisée
Là aussi, les points de vue étaient contrastés au sein des acteurs industriels, même si, à EDF, Michel Hug était peu favorable au bouillant (il avait travaillé sur les problèmes de cavitation), et Marcel Boiteux et Paul Delouvrier privilégiaient la standardisation plutôt que la concurrence entre deux filières (sur cette « bataille des filières nucléaires », voir Marcel Boiteux, Haute tension, Odile Jacob, 1993, p. 137-156).
Voir la note du 5 décembre 1973 de Michel Hug qui définit les nouvelles règles du jeu et crée le
Comité des chefs d’étude qui sera animé d’abord par Denis Gaussot, directeur du Septen de 1972 à 1976 (Georges Lamiral, op. cit., vol. 2, p. 127).
Voir Cyril Foasso, Histoire de la sûreté de l’énergie nucléaire civile en France (1945-2000) : technique d’ingénieur, processus d’expertise, question de société, thèse de doctorat, université Lyon-II, 28 octobre 2003.
La réaction structurante et de grande ampleur du politique face au choc pétrolier et l’abandon de la filière à eau bouillante
Les chocs pétroliers d’octobre 1973 et de janvier 1974 conduisent à une multiplication par quatre du prix du baril en moins de quatre mois : en quelques jours, le coût de l’importation du pétrole par la France est passé de moins de 1,5% du PIB à près de 5%. Le 22 novembre 1973, le conseil interministériel présidé par Pierre Messmer, Premier ministre, entérine le projet d’une usine d’enrichissement à Tricastin, Eurodif, dirigée par Georges Besse qui en lance la réalisation début 1974. Pierre Messmer s’adresse aux Français le 30 novembre 1973 pour leur annoncer une série de mesures d’économies d’énergie. C’est le début d’une opération « chasse au gaspi » qui va permettre de stabiliser la consommation énergétique du pays sur une décennie. Le 6 mars 1974, le conseil interministériel présidé par Georges Pompidou décide ce qu’on appellera le « plan Messmer » élaboré sur la base des propositions de la commission PEON : engagement de six tranches nucléaires d’environ 1 000 MW en 1974, puis sept tranches en 1975, en maintenant l’objectif d’avoir une coexistence et une émulation entre les deux filières à eau légère (Westinghouse et General Electric). En août 1975, compte tenu de sa faiblesse industrielle sur l’îlot nucléaire par rapport à Creusot-Loire-Framatome, CGE renonce au développement de la filière bouillante de General Electric. Le gouvernement va faire le deuil de la concurrence sur la chaudière et le groupe turbo-alternateur, et EDF va s’atteler avec les industriels et le CEA à mettre l’industrie en ordre de bataille face à cette nouvelle période et ces défis inédits associés à un déploiement de très grande ampleur sur plus d’une décennie (1975-1990)27.
L’industrie en ordre de bataille pour une transition énergétique inédite
Tous les acteurs ont à l’esprit la nécessité de changer à nouveau de logiciel par rapport aux périodes précédentes, tant en termes d’organisation que de modes de fonctionnement et face aux nouveaux défis industriels et économiques liés à la mise en œuvre d’un programme de construction particulièrement ambitieux.
En 1967, la direction de l’Équipement d’EDF, en raison de son histoire, comporte une quinzaine de régions d’équipement jalouses de leur autonomie, chacune disposant de ses bureaux d’études et habituée à mettre en concurrence sur des centaines de lots une industrie fragmentée et peu dotée de capacités d’étude. Dès 1967-1968, l’entreprise va se préparer à un déploiement standardisé en tirant les leçons du démarrage difficile du palier thermique 250 MW lié à cette absence de doctrine technique et à cette décentralisation excessive. C’est en même temps la fin progressive des grands programmes hydrauliques – les sites sont pour la plupart équipés –, qui relevaient naturellement d’approches « sur mesure ». Charles Chevrier, directeur général adjoint, crée en 1968 le Septen, qui aura la responsabilité technique de la conception des équipements thermiques et nucléaires. De 1972 à 1976, Michel Hug, directeur de l’Équipement, réorganise les régions d’équipement, et crée en 1973 le comité des chefs d’études des régions d’équipement28 : ce comité contrôle et décide, par délégation du directeur de l’Équipement, tous les sujets clés concernant la conception des paliers techniques ; il est présidé par le chef du Septen et décide sur la base d’un consensus technique qui s’impose ensuite à toutes les régions. Certaines régions sont responsables des lots principaux des têtes de palier, en particulier la chaudière nucléaire et le groupe turbo-alternateur.
EDF va également adapter ses relations contractuelles à un tissu industriel plus concentré, mieux équipé en bureaux d’études et capable de prendre la responsabilité de sous-systèmes techniques plus vastes. L’entreprise va surtout renoncer à la mise en concurrence de ses fournisseurs sur deux grands lots : la chaudière nucléaire, avec Framatome, et le groupe turbo-alternateur, avec Alsthom. Des programmes de formation très importants sur l’ensemble des compétences nécessaires pour construire ces tranches et les exploiter vont être mis en place avec les écoles des métiers, et on va mobiliser les savoir-faire des anciens de l’hydraulique, du thermique et de la filière UNGG. Il va falloir donner une visibilité dans la durée au tissu industriel, avec un contrôle technique exigeant de la fabrication des pièces clés et un contrôle de l’évolution des coûts. EDF met également en chantier de façon cohérente le développement du réseau très haute tension, en particulier du 400 kV, indispensable pour acheminer l’électricité des nouveaux sites de production vers les usages en forte croissance.
L’industrie se concentre et se restructure autour de Framatome-Creusot-Loire sur la chaudière nucléaire (qui absorbe les compétences des groupements industriels UNGG, G3A, Indatom) et autour de CGE-Alsthom en charge de la partie turbo-alternateur. Framatome construit une nouvelle usine à Saint-Marcel, dans la Saône-et-Loire, en dix-huit mois et qui est opérationnelle fin 1975. Avec ses deux usines, Creusot-Loire-Framatome va disposer d’une capacité de fabrication annuelle de huit cuves et de dix-huit à vingt-quatre générateurs de vapeur, et des meilleures compétences pour réaliser les composants clés du circuit primaire (la partie « nucléaire » de la centrale). Le pari de ses dirigeants, Philippe Boulin, Maurice Aragou et Jean-Claude Leny, de faire levier sur leur crédibilité industrielle et sur l’engagement du politique et d’EDF dans une série de tranches est gagné. Cela va permettre, avec l’attitude coopérative de Westinghouse et la maîtrise scientifique du CEA (liée en particulier à sa maîtrise de l’eau légère pour la propulsion nucléaire), de « franciser » en quelques années la technologie Westinghouse. Dans ce cadre, le CEA va monter au capital de Framatome en 1975.
André Giraud, administrateur général du CEA de 1970 à 1978, réorganise les activités du CEA en adaptant les règles de gestion et les structures juridiques à ses différentes missions. En 1976 à partir du département de sûreté nucléaire, Jean Bourgeois, pionnier de la sûreté, crée au CEA l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), devenu aujourd’hui Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), support technique de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le CEA crée des filiales sur certaines parties industrielles comme TechnicAtome en 1972 (à partir du département de construction des piles) et la Cogema sur l’aval du cycle en 1976. Le CEA s’investit tout particulièrement dans la maîtrise industrielle de l’ensemble du cycle du combustible de la filière eau pressurisée, de l’amont, avec la fabrication du combustible et surtout l’enrichissement (construction d’Eurodif), à l’aval, avec le retraitement des combustibles et la gestion des déchets nucléaires. Parmi les personnalités ayant joué un rôle important à cette époque avec André Giraud, on peut citer Claude Fréjacques, responsable au CEA des études sur l’enrichissement dès 1957, puis directeur de la chimie du CEA dans les années 1970, avant de devenir président du CNRS en 1981.
Le contrôle de la sûreté est un point central de la réussite du programme nucléaire. Une nouvelle organisation de la sûreté est mise en place au début des années 1970 avec la création, en 1973, du Service central de sécurité des installations nucléaires (SCSIN) au sein du ministère de l’Industrie, et non plus intégré au CEA. Il pourra s’appuyer largement sur les compétences de sûreté du CEA qui sont rassemblées en 1976, comme on vient de l’évoquer, dans l’IPSN sous la direction de Jean Bourgeois29. En 1991, le SCSIN deviendra la Direction de la sûreté nucléaire (DSIN), rattachée au ministère de l’Industrie et de l’Environnement, puis, en 2002, la Direction générale de la sûreté nucléaire et de radioprotection (DGSNR), qui dépend aussi du ministère de la Santé, avant de devenir, en 2006, l’ASN, autorité administrative indépendante.
Une préparation collective exigeante soutenue par l’État
Prises de risque, échecs et succès dans une perspective de puissance économique et de souveraineté
Sur cette période, voir Fondation Charles-de-Gaulle, Défendre la France. L’héritage de
De Gaulle à la lumière des enjeux actuels. Actes de colloque, Nouveau Monde Éditions/Ministère des Armées, 2020 ; Collectif, Puissance et faiblesses de la France industrielle XIXe-XXe siècle, Seuil, coll. « Points histoire », 1997 ; Marc Bloch, L’Étrange défaite [1946], Gallimard, coll. « Folio histoire », 1990 ; Gaston Berger, Jacques de Bourbon-Busset et Pierre Massé, De la prospective. Textes fondamentaux de la Prospective française 1955-1966, L’Harmattan, 2007 ; Jean-François Sirinelli, Les Vingt Décisives. Le passé proche de notre avenir (1965-1985), Fayard, 2007 (rééd. coll. « Pluriel », avec une préface inédite, 2012).
Le plus surprenant est sans doute le contraste entre, d’un côté, les résultats remarquables du déploiement massif du programme dans les années 1975-1990, avec des coûts d’investissement deux à trois fois moins élevés qu’aux États-Unis et la maîtrise industrielle de l’ensemble de la chaîne de valeur (souveraineté et économie), et, de l’autre, les tâtonnements et les difficultés qui les ont précédés de 1945 à 1975, trente années dont nous avons vu à la fois les difficultés, les tâtonnements, les déboires techniques et économiques parfois considérables, et la diversité des défis selon les périodes – recherche et prototypes, démonstrateurs industriels et choix de la (ou des) filière, préparation du déploiement de séries standardisées –, diversité des défis qui sollicitaient des organisations et des compétences bien différentes30. La clé de l’énigme réside sans doute dans la compréhension de cette capacité de rebond et de résilience sur plusieurs décennies, basée sur le choix d’accepter et d’assumer ces tâtonnements, ces prises de risque, avec une allocation des responsabilités et des organisations adaptées, et le choix de personnalités engagées et compétentes pour l’action.
Dans cet esprit, quatre ingrédients principaux ou « quatre éléments » nous semblent pouvoir expliquer cette résilience et cette capacité de rebond qui ont permis une réussite exceptionnelle :
- une vision politique de long terme et bipartisane des enjeux énergétiques fondée sur les sciences et l’industrie ;
- un État qui assume son rôle pour la modernisation du pays dans les secteurs clés comme l’énergie ;
- une organisation et un fonctionnement de l’État qui responsabilisent quant aux résultats, et qui facilitent l’action collective ;
- un État qui mobilise les meilleures compétences industrielles et scientifiques pour la décision et l’action.
Une vision à long terme et une ambition portées par des responsables politiques, partagées avec les élites scientifiques, industrielles et la haute fonction publique : la souveraineté économique, énergétique, le progrès économique et social, grâce aux sciences et à une industrie efficace et puissante
Cette vision de long terme n’a d’intérêt et d’efficacité in fine que parce qu’elle s’accompagne de l’attention et de la priorité accordées à la qualité de la mise en œuvre industrielle, au résultat délivré, à l’écoute des professionnels et à la mobilisation de leur savoir-faire, y compris dans l’élaboration des stratégies, et à l’écoute des opportunités liées aux événements y compris géopolitiques.
Une vision relayée par la conception d’un État « déterminé et mesuré »,
engagé pour la modernisation économique et industrielle du pays
Pour la plupart des acteurs, il est clair, au vu de l’histoire, en particulier de la période des deux guerres mondiales et de la décennie de crise économique des années 1930, que l’on ne peut pas simplement compter sur les secteurs privés et les marchés pour assurer la sécurité des nations face aux risques géopolitiques et géoéconomiques, ni pour assurer la prospérité économique dès qu’il y a « échec des marchés » lié à la présence de monopoles naturels (réseaux d’énergie ou de transport), ou « externalités positives31 » dues au rapprochement laboratoire-usine ou aux coordinations industrielles sur la maîtrise à long terme de systèmes sociotechniques complexes, tels que les réseaux d’énergie ou d’électricité, ou la filière nucléaire.
Polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Massé a été successivement directeur de l’équipement à EDF, commissaire général au Plan de 1959 à 1965, puis président d’EDF de 1965 à 1969 ; Marcel Boiteux, normalien, mathématicien et économiste, a été chef des études économiques générales, directeur général d’EDF de 1967 à 1979, puis président d’EDF de 1979 à 1987. Tous deux ont animé, au sein d’EDF comme dans les travaux du Plan, la réflexion sur les outils économiques pertinents pour mettre en œuvre les politiques de l’État et envoyer aux acteurs économiques les bons signaux économiques : le taux d’actualisation pour intégrer de façon cohérente le coût du financement dans les choix des investissements publics, la programmation dynamique stochastique pour optimiser le choix des investissements en prenant en compte les incertitudes et le long terme, la tarification au coût marginal de long terme pour envoyer les bonnes incitations au consommateur en termes d’investissements dans les usages, la Note bleue pour décentraliser les choix d’investissement et de dimensionnement dans l’hydraulique (importance de pouvoir faire du « sur-mesure »).
Le Plan va structurer ces travaux pour les remettre dans le cadre systémique d’une prospective à long terme intégrant l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, syndicats de salariés et patronaux, collectivités locales, et les complexités comme les incertitudes. Cette « ardente obligation » de la planification en France est souvent mal connue et mal comprise. On oublie en particulier souvent la grande diversité des profils mobilisés, de Pierre Massé, grand ingénieur et scientifique, à Gaston Berger, directeur général de l’enseignement supérieur de 1953 à 1960 et philosophe, qui fut l’un des premiers phénoménologues en France à écrire sur Husserl et Heidegger avec Emmanuel Levinas. Gaston Berger a lui aussi joué un rôle décisif dans les travaux de prospective en France en accordant une grande importance à l’éducation et à la culture bien sûr, comme au rôle central des acteurs, de leur liberté et de leurs contraintes.
L’un de ces grands ingénieurs, Louis Armand, responsable de la SNCF puis d’Euratom, à la fois industriel, scientifique et serviteur de l’État, fera sur plus de deux décennies des cours remarquables de pédagogie et de précision concrète aux élèves de l’ENA sur les enjeux techniques, économiques et sociaux de l’énergie et de l’industrie pour la France. Il n’est pas sûr que les décennies suivantes aient offert une approche aussi approfondie et systémique aux promotions qui ont suivi à l’ENA ou à l’École polytechnique. La réussite de tous ces objectifs ambitieux sur le plan du développement économique et social était bien loin d’être assurée, après les trois décennies de guerre, de crises et de déclin de la France. La plupart de ces acteurs étaient habités par l’importance des incertitudes et la nécessité de rester modestes et prudents, tout en étant déterminés à sortir des comportements souvent malthusiens, égoïstes et tournés vers le passé qu’a si bien analysés Marc Bloch. C’est davantage dans les années 1970 et 1980 que cette modestie sera trop souvent abandonnée, et laissera parfois place à des technocraties confondant sciences et scientisme, et transformant l’espérance de progrès en certitude.
Une organisation de l’État pour l’action et la mise en œuvre de grands projets industriels d’intérêt général
Cette organisation s’appuyait notamment sur :
- des entités industrielles et/ou scientifiques comme le CEA et EDF, ou des services de l’État comme la Direction de l’énergie et des matières premières (DGEMP), d’abord nommée Secrétariat général de l’énergie de 1963 à 1973, puis Délégation générale à l’énergie de 1974 à 1978. Jean Blancard sera ainsi délégué général pour l’énergie en 1974-1975 après avoir été délégué ministériel pour l’armement de 1968 à 1974, avec des responsabilités fortes sur des domaines cohérents et assez vastes pour se sentir réellement en charge à long terme de l’avenir de ces domaines pour le pays en intégrant les dimensions systémiques et industrielles. Les créations par le général de Gaulle en 1961 du Centre national d’études spatiales (Cnes) dans le spatial et de la Délégation ministérielle pour l’armement (DMA), qui deviendra plus tard la Direction générale de l’armement (DGA), s’inscrivent dans la même logique : il s’agit bien de faire, de « transformer le monde », et les services de l’État sont responsables de la cohérence des règles du jeu concrètes avec les objectifs ;
- un fonctionnement de l’État efficace sous l’autorité du politique, qui polarise les énergies, écoute les acteurs et décide de façon pragmatique. Il s’agit d’aller vite aux solutions via des institutions de gestion des conflits et de confrontation des points de vue au niveau des compétences pertinentes : conseils ministériels restreints, Plan et commission PEON, comités CEA-EDF, comité des chefs d’étude des régions d’équipement au sein d’EDF…
Un État doté des meilleures compétences industrielles et scientifiques.
L’État s’appuie ainsi, tant en interne qu’en externe, sur les meilleures compétences industrielles et scientifiques portées par des hommes habités par cette vision collective et formés pour l’action et la mise en œuvre : EDF est créé par la nationalisation de plus d’un millier d’entreprises en 1946, la plupart de ses dirigeants ont conduit eux-mêmes des chantiers, construit des centrales et des réseaux, dans le cadre des entreprises privées de l’entre-deux-guerres (Pierre Massé, Pierre Ailleret, André Decelle). Le CEA est dirigé par des industriels comme Pierre Guillaumat ou Pierre Taranger, et de grands scientifiques comme Francis Perrin et Jules Horowitz. Et les industriels fournisseurs comme Creusot-Schneider (Charles Schneider, Philippe Boulin, Maurice Aragou, Jean-Claude Leny), CGE ou Saint-Gobain sont parties prenantes et impliqués dans les réflexions. Ces hommes, par leur passé industriel, et aussi, pour nombre d’entre eux, par leur passé de résistants et de Français libres, sont habitués à s’engager, à ne pas éviter le conflit, à prendre des risques et à se sentir responsables individuellement et collectivement de l’ensemble.
On voit ainsi se dessiner clairement une conception forte et précise du rôle de l’État sur la maîtrise industrielle au service de la souveraineté et de la puissance économique avec une organisation de l’État ramassée, cohérente et responsabilisante, et, au cœur de l’État, des compétences industrielles et scientifiques dotées d’une expérience de l’action et du souci de la mise en œuvre opérationnelle. Cette organisation et ces compétences industrielles et scientifiques sont en interaction directe avec le politique qui les sollicite et les implique dans ses processus de décision. Les politiques donnent la vision, attendent des industriels des résultats, mais aussi des initiatives et une gestion coopérative des conflits entre eux. Et, in fine, ce sont eux qui, à l’écoute des enjeux géopolitiques et des circonstances, décident des options stratégiques aux moments clés, et des coopérations internationales.
La souveraineté et l’efficacité économique par la maîtrise industrielle et des coopérations internationales ciblées
On oppose souvent la souveraineté énergétique à l’efficacité économique permise grâce aux échanges et aux coopérations internationales. Dans cette optique, toute politique industrielle impliquerait protectionnisme, réglementations et subventions, avec d’importants surcoûts pour l’économie et les contribuables. L’analyse de l’histoire du programme nucléaire français montre bien que ceci, loin d’être une fatalité, peut exactement être l’inverse si l’on comprend d’abord que la maîtrise industrielle d’une filière clé par le tissu industriel d’un pays est un facteur commun de progrès économique et social et d’autonomie stratégique. On réalise aussi que si cette maîtrise industrielle impose l’intervention de l’État dans des secteurs comme le système électrique et le nucléaire, ce n’est pas n’importe laquelle : une intervention ciblée sur les enjeux de souveraineté et les « échecs de marché », et fondée sur une compétence industrielle de haut niveau au service de l’intérêt général. On a bien vu que cette intervention, tout en prenant des formes différentes selon les périodes (prototypes/démonstrateurs industriels/déploiement à grande échelle), doit toujours articuler les deux préoccupations : la souveraineté et l’efficacité économique. Il est clair que le déploiement à grande échelle d’une technologie de production électrique moins compétitive que celle des autres grands pays signerait la fin de la puissance économique et donc de la souveraineté : comme l’a souvent rappelé le général de Gaulle, la puissance industrielle et économique d’un pays dans les domaines structurants que sont l’énergie, les transports ou la défense est la condition de l’autonomie stratégique. Il faut donc, comme nous l’avons évoqué, la capacité de repérer d’une part les maillons clés de la chaîne de valeur qui relèvent de la souveraineté, et d’autre part les « échecs de marché industriels » qui appellent de la part de l’État une action informée et ciblée, et non une myriade de subventions, de réglementations et d’objectifs non hiérarchisés.
Les coopérations internationales sont bien sûr très utiles sur ces filières de haute technologie, les économies d’échelle sont en effet importantes tant au niveau des prototypes et des démonstrateurs que pour la fabrication des équipements en phase de déploiement. Mais il faut faire attention aux dimensions sensibles liées, d’une part, à l’aspect dual de la technologie nucléaire (non-prolifération et contrôle des matières) et, d’autre part, à l’autonomie stratégique sur les maillons clés pour la maîtrise industrielle et économique tout en veillant à conserver des avantages comparatifs associés. La première dimension concerne d’abord la chaîne du combustible, en particulier l’enrichissement et le retraitement ; la seconde concerne la sécurité d’approvisionnement en combustible (mines d’uranium diversifiées, stocks stratégiques dans l’ensemble du cycle), ainsi que la maîtrise du contrôle-commande ou celle de la fabrication de composants clés (cuves, métallurgie et soudures, diesels de secours) pour les réacteurs (en particulier la sûreté). Il s’agit de mettre en place, dans le cadre d’une vision à long terme des risques industriels et géopolitiques, un approvisionnement diversifié qui peut articuler une base française, un complément plus ou moins important acheté à des fournisseurs étrangers, et les stocks stratégiques nécessaires, tout en protégeant les secrets de fabrication et les avantages comparatifs liés à certaines innovations. Les partenariats durables exigent donc d’articuler des considérations industrielles et économiques précises avec les enjeux géopolitiques. Là encore, si le politique a une vision articulant les enjeux géopolitiques et de politique étrangère avec les enjeux industriels, et s’il peut s’appuyer au sein de l’État sur des compétences intégrant prospective géopolitique et industrielle, on saura mettre en œuvre en fonction du contexte des coopérations fortes, y compris, avec des alliés historiques, sur les maillons de souveraineté comme l’enrichissement (comme dans le cas d’Eurodif avec des alliés européens) ou le retraitement (dans le cas de la coopération avec le Japon).
L’histoire du nucléaire civil illustre bien ces quelques remarques. Si les Français partent seuls sur l’UNGG dans les années 1950, ce n’est pas volontairement, mais en raison de l’attitude des États-Unis qui refusent alors de partager leurs savoirs technologiques et les travaux en cours entre les grands laboratoires publics et Westinghouse ou General Electric (loi McMahon de 1946). Dès que la possibilité est ouverte au regard de l’évolution de l’attitude des États-Unis et de la création d’Euratom à la fin des années 1950, le général de Gaulle lui-même autorise la participation d’EDF à la construction de Chooz A avec les Belges et la technologie de Westinghouse. Les premiers réacteurs de série eau légère, et même UNGG, feront l’objet de partenariat avec d’autres électriciens : Vandellos, UNGG en Espagne ; Tihange avec les Belges ; la participation des Allemands et des Suisses dans les deux tranches de Fessenheim à eau pressurisée. On a déjà évoqué les coopérations sur l’enrichissement et le retraitement avec des partenaires européens ou japonais, mais on peut également mentionner la présence du japonais MHI aujourd’hui au capital de Framatome, lequel est par ailleurs un acteur industriel majeur non seulement en France mais à l’international, en particulier aux États-Unis sur la maintenance des centrales existantes.
Le risque peut venir d’abord d’un changement dans la stratégie nucléaire civile de l’un des partenaires, comme cela a été le cas de l’Allemagne qui a abandonné le nucléaire au début des années 2000, ce qui a fragilisé le projet franco-allemand de génération 3, l’EPR. Il peut aussi venir d’une évolution du contexte géopolitique, et du comportement de partenaires potentiels, par exemple avec l’attitude négative des États-Unis au début de la guerre froide. Cette question des partenaires durables dans la mise au point de technologies clés comme le nucléaire est bien sûr importante pour l’avenir avec la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, et la guerre entre la Russie et l’Ukraine.













Aucun commentaire.